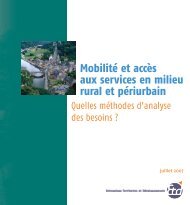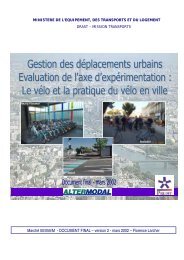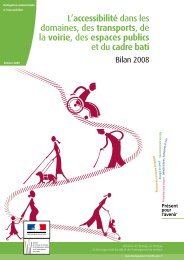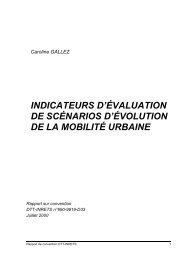Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>du</strong> grand hypermarché <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie (Ascher, 1995, p.122). C<strong>et</strong>te multiplicité d’optionsoffertes par la métropolisation a une conséquence principale sur les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>sindivi<strong>du</strong>s : l’indivi<strong>du</strong>ation. Cela se r<strong>et</strong>rouve par exemple au sein <strong>de</strong>s familles : même lorsquela solidarité <strong>et</strong> le lien familial restent très forts, chaque indivi<strong>du</strong> a tendance à gagner enautonomie <strong>et</strong> à construire sa propre vie. Chacun possè<strong>de</strong> son propre cercle d’amis, <strong>de</strong>parcours, d’activités <strong>et</strong> <strong>de</strong> lieux <strong>de</strong> vie. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’univers familial, les relations <strong>de</strong>proximité ten<strong>de</strong>nt à perdre <strong>de</strong> l’importance au profit d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie beaucoup plusindivi<strong>du</strong>aliste : le voisin est <strong>de</strong> moins en moins un ami ou un collègue <strong>de</strong> travail. En fait, l<strong>et</strong>erritoire social urbain <strong>de</strong> chaque indivi<strong>du</strong> (Ascher, 1998) est progressivement passé <strong>de</strong>l’échelle <strong>du</strong> quartier à l’échelle <strong>de</strong> la métropole. Cela a été ren<strong>du</strong> possible par l’augmentationgénéralisée <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> communication fournie par les différents réseaux <strong>de</strong> la métropole,qu’ils soient physiques (<strong>transports</strong>) ou virtuels (TIC).tel-00588787, version 1 - 26 Apr 2011En réaction aux profon<strong>de</strong>s mutations <strong>du</strong> <strong>système</strong> <strong>de</strong>s relations sociales <strong>et</strong> surtout <strong>du</strong><strong>système</strong> <strong>de</strong>s localisations, le <strong>système</strong> <strong>de</strong> <strong>transports</strong> a évolué au cours <strong>du</strong> 20 ème siècle. Leprocessus historique <strong>de</strong> la métropolisation décrit précé<strong>de</strong>mment peut ainsi être mis enparallèle avec la transition urbaine, c'est-à-dire le passage <strong>de</strong> la ville pé<strong>de</strong>stre à la villeautomobile (Wiel, 1999). C<strong>et</strong>te transformation s’est effectuée en respectant globalement laconjecture <strong>de</strong> Zahavi (Zahavie, Talvitie, 1980), qui stipule que le temps quotidien passé dansles <strong>transports</strong> reste constant <strong>et</strong> qu’en conséquence tout gain en vitesse se tra<strong>du</strong>it par unallongement <strong>de</strong>s distances parcourues.Sur le plan <strong>de</strong> la mobilité quotidienne, <strong>et</strong> en rapport avec les évolutions <strong>du</strong> sous<strong>système</strong> <strong>de</strong>s relations sociales, il y a <strong>de</strong>ux conséquences : une baisse <strong>de</strong> la proportion <strong>de</strong>sdéplacements liés au travail, au profit <strong>de</strong>s déplacements <strong>de</strong> loisirs ou liés aux affairespersonnelles, <strong>et</strong> surtout une forte croissance <strong>de</strong> la distance <strong>de</strong> ces déplacements (Orfeuil,2000a). Toutefois les migrations alternantes continuent à structurer fortement les pratiquesquotidiennes <strong>de</strong>s personnes <strong>et</strong> restent très pertinentes pour analyser l’inscription spatiale <strong>de</strong>spratiques <strong>de</strong> mobilité <strong>et</strong> l’analyse <strong>de</strong>s liens entre forme urbaine <strong>et</strong> mobilité (Aguiléra, 2010).Dans ce contexte, les impacts <strong>de</strong> la métropolisation sur la mobilité quotidienne <strong>de</strong>sménages sont particulièrement importants. Globalement, c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière a connu une fortecroissance. Cependant, on a aussi constaté une augmentation <strong>de</strong>s inégalités, <strong>de</strong>s dépenses <strong>et</strong><strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> gaz à eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> serre qui lui sont associées.2.3.a Croissance <strong>de</strong> la mobilité quotidienneComme on l’a vu précé<strong>de</strong>mment, la métropolisation a accéléré le processusd’étalement, <strong>de</strong> concentration <strong>et</strong> <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s agglomérations au cours <strong>de</strong> cestrois <strong>de</strong>rnières décennies. La mobilité <strong>de</strong>s ménages a profondément changé avec cesmodifications <strong>de</strong> configuration urbaine. En France, entre 1960 <strong>et</strong> 2000, le parc automobile aété multiplié par 5 <strong>et</strong> la circulation automobile par 9 (Orfeuil, 2004). La phénomèned’étalement urbain initié par la métropolisation a con<strong>du</strong>it les ménages à fréquenter <strong>de</strong>sterritoires plus divers <strong>et</strong> plus éloignés (Orfeuil, 2000a). La forte croissance d’utilisation <strong>de</strong>l’automobile s’est surtout effectuée en périphérie <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s agglomérations, au sein <strong>de</strong>zones peu <strong>de</strong>nses <strong>et</strong> peu accessibles en <strong>transports</strong> en commun. On observe en particulier uneforte croissance <strong>de</strong>s distances parcourues. Ainsi, en périphérie <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s aires <strong>urbaines</strong> <strong>de</strong>plus <strong>de</strong> 300 000 habitants, le taux <strong>de</strong> motorisation a augmenté <strong>de</strong> 32% <strong>et</strong> les distancesquotidiennes parcourues en voiture ont crû <strong>de</strong> 62% entre 1982 <strong>et</strong> 1994 (Gallez <strong>et</strong> al. 1997).La relative stabilité <strong>du</strong> budg<strong>et</strong>-temps <strong>de</strong>s ménages a logiquement con<strong>du</strong>it à une fortecroissance <strong>de</strong>s vitesses <strong>de</strong> déplacements, permise par l’usage généralisé <strong>de</strong> la voiture16