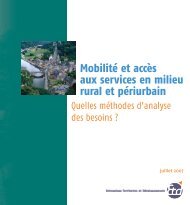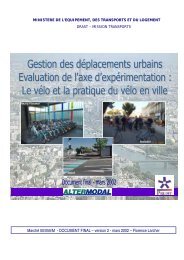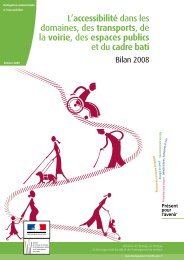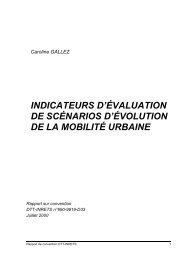Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Léon Walras (1874) fut le premier à poser clairement le problème en montrant quel'équilibre général se tra<strong>du</strong>isait par un <strong>système</strong> comportant autant d'inconnues que d'équations.Les conditions nécessaires à l'existence d'une solution ont été i<strong>de</strong>ntifiées par Arrow <strong>et</strong> Debreuen 1950. Cependant, ces <strong>de</strong>rnières sont très restrictives, notamment la rationalité <strong>du</strong>consommateur, la concurrence pure <strong>et</strong> parfaite <strong>et</strong> l'absence <strong>de</strong> coûts fixes. Par conséquent,l'équilibre général est irréalisable en pratique. Il constitue cependant, selon les néoclassiques,un « idéal » vers lequel il faut tendre.1.2 L’optimum économique dans l’approche néoclassique…tel-00588787, version 1 - 26 Apr 2011Tout le problème <strong>du</strong> paradigme néoclassique repose en fait sur la question suivante :étant donnée une répartition initiale <strong>de</strong>s ressources entre tous les consommateurs <strong>et</strong> tous lespro<strong>du</strong>cteurs, quelle est l'allocation <strong>de</strong>s biens qui con<strong>du</strong>it à une maximisation <strong>du</strong> surplus pourla société ?Dans un premier temps, les utilitaristes ont défini l'optimum économique comme étantl'état <strong>du</strong> plus « grand bonheur pour le plus grand nombre ». Ce critère consiste simplement àmaximiser la somme <strong>de</strong>s utilités <strong>de</strong> tous les indivi<strong>du</strong>s. Cependant, c<strong>et</strong>te définition <strong>de</strong>l'optimalité comporte <strong>de</strong>ux inconvénients majeurs : la nécessaire mesure cardinale <strong>de</strong>s utilités(sommation) <strong>et</strong> la possibilité <strong>du</strong> sacrifice <strong>du</strong> bien-être <strong>de</strong> quelques-uns si le bien-êtreaugmente collectivement. Or les indivi<strong>du</strong>s ne sont pas capables <strong>de</strong> fournir une estimationquantitative <strong>de</strong> leur bien-être. Ils sont au mieux capables <strong>de</strong> comparer <strong>et</strong> <strong>de</strong> classer <strong>de</strong>s paniers<strong>de</strong> biens. De plus, selon le principe indivi<strong>du</strong>aliste <strong>du</strong> paradigme néoclassique, chaque indivi<strong>du</strong>peut chercher librement à maximiser son utilité, ce qui contredit la notion <strong>de</strong> sacrifice.Afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te liberté <strong>de</strong> choix indivi<strong>du</strong>elle <strong>et</strong> le refus <strong>de</strong> tout sacrifice,V. Par<strong>et</strong>o a proposé une autre définition <strong>de</strong> l'optimum économique : une allocation <strong>de</strong>sressources est optimale au sens <strong>de</strong> Par<strong>et</strong>o lorsque qu'elle ne perm<strong>et</strong> plus d'améliorer lasituation d'un indivi<strong>du</strong> sans détériorer celle d'un autre. Ce critère est conforme au principeindivi<strong>du</strong>aliste car « il garantit la souverain<strong>et</strong>é <strong>de</strong> chaque indivi<strong>du</strong> » (Defalvard, 2005, p.172).Même si le critère <strong>de</strong> Par<strong>et</strong>o constitue un progrès par rapport au critère <strong>de</strong>maximisation <strong>de</strong> l’utilité collective, il reste avant tout un critère d’efficacité pour la société <strong>et</strong>non d’équité entre les indivi<strong>du</strong>s. En eff<strong>et</strong>, une situation où un seul indivi<strong>du</strong> possè<strong>de</strong> toutes lesrichesses est jugée Par<strong>et</strong>o-optimale.Ce constat a poussé les théoriciens à bâtir une fonction <strong>de</strong> bien-être social (guidant leschoix collectifs) afin <strong>de</strong> choisir, parmi l’ensemble <strong>de</strong>s choix optimaux, celui qui serait le pluséquitable. Bergson (1938) <strong>et</strong> Samuelson (1947) ont été les premiers à conceptualiser c<strong>et</strong>teapproche. La fonction <strong>de</strong> bien-être social peut être vue comme un ensemble <strong>de</strong> courbesd’indifférences représentant toutes les utilités <strong>de</strong>s indivi<strong>du</strong>s qui composent la société. Elle estcensée pouvoir opérer un classement entre les différents choix Par<strong>et</strong>o-optimaux (intersectionentre la courbe d’indifférence la plus élevée <strong>et</strong> la courbe représentant l’ensemble <strong>de</strong>s choixoptimaux). Sous certaines hypothèses, Harsanyi (1955) a montré que c<strong>et</strong>te fonctions’exprimait comme la somme pondérée <strong>de</strong>s utilités indivi<strong>du</strong>elles. Cependant, d’autresexigences plus fortes sont apparues dans la formalisation <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te fonction : les utilités doiventêtre cardinales, ou correspondre aux préférences d’un dictateur. Dans le premier cas, c<strong>et</strong>tefonction est inutilisable pour gui<strong>de</strong>r les choix collectifs car les indivi<strong>du</strong>s sont incapables <strong>de</strong>donner une valeur à leur utilité, tout au plus peuvent-ils les classer. Dans le second cas, lasituation est incompatible avec la liberté que chaque indivi<strong>du</strong> est sensé possé<strong>de</strong>r. Enfin, onpeut également s’interroger sur les critères <strong>de</strong> justice qui définissent la valeur <strong>de</strong>spondérations <strong>de</strong>s utilités pour chaque indivi<strong>du</strong>. Ces critères doivent résulter d’un choixcollectif. Cependant, les théorèmes d’impossibilité <strong>de</strong> Arrow <strong>et</strong> <strong>de</strong> Sen montreront que <strong>de</strong>schoix publics efficaces <strong>et</strong> cohérents ne peuvent être issus <strong>de</strong> l’agrégation <strong>de</strong>s préférences28