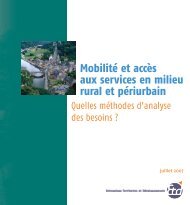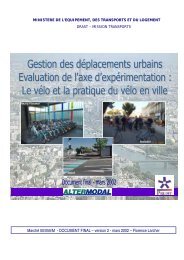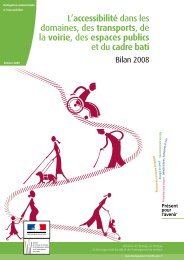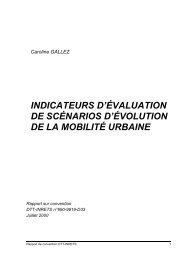Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pour conclure, les aspects sociaux, bien qu’explicitement présents dans les loisd’aménagement <strong>du</strong> territoire, ne disposent pas <strong>de</strong>s outils évaluation adéquats pour être mis enapplication dans l’évaluation <strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s.(iii) Mise en application <strong>du</strong> principe d’équité dans le domaine <strong>de</strong>s choixcollectifs…tel-00588787, version 1 - 26 Apr 2011La mise en place <strong>de</strong>s principes d’équité dans l’élaboration <strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> transport peutêtre délicate car suj<strong>et</strong>te à diverses interprétations. Dans tous les cas, seule une étu<strong>de</strong>désagrégée <strong>de</strong>s impacts d’une politique <strong>de</strong> transport par type <strong>de</strong> population est susceptible <strong>de</strong>fournir une idée <strong>de</strong> l’équité ou <strong>de</strong> l’iniquité d’un proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> transport. Cependant, l’appréciation<strong>du</strong> caractère équitable d’une mesure dépend <strong>de</strong> l’indicateur que l’on utilise.Banister (1993) étudie l’impact d’une hausse <strong>de</strong>s taxes <strong>de</strong> carburant selon le revenu<strong>de</strong>s ménages en décile. En termes <strong>de</strong> dépense absolue, une hausse <strong>de</strong>s taxes pourrait êtreconsidérée comme progressive car ce sont les ménages les plus aisés qui ont la contributionfinancière la plus importante. Mais en termes <strong>de</strong> dépenses par rapport au revenu global, lesménages pauvres supportent une hausse <strong>de</strong> 1,9 % tandis que les ménages aisés ne subissentqu’une hausse <strong>de</strong> 1,1 %.Le péage urbain illustre très bien c<strong>et</strong>te contradiction. Dans une revue <strong>de</strong> la littératuresur l’équité <strong>du</strong> péage urbain, S. Souche (2003) constate que l’on peut parvenir à <strong>de</strong>sconclusions différentes selon le point <strong>de</strong> vue. D’un côté, le péage urbain n’est pas équitablecar il peut exclure une partie <strong>de</strong>s automobilistes pauvres ou alourdir leurs charges financières.De plus, le péage urbain peut créer une inégalité entre les territoires où il est appliqué <strong>et</strong> ceuxoù il ne l’est pas. A l’inverse, le péage urbain est équitable dans le sens où les sommesréinvesties dans les <strong>transports</strong> collectifs seraient à l’avantage <strong>de</strong>s plus pauvres. En réalité,l’équité d’un proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> transport est difficilement mesurable tant les impacts sont nombreux.<strong>Une</strong> manière <strong>de</strong> juger si une mesure est équitable ou pas est d’en apprécier l’acceptabilité <strong>de</strong>la part <strong>de</strong> la population. Raux <strong>et</strong> Souche (2001) examinent les conditions d’acceptabilité <strong>de</strong> lamise en place <strong>du</strong> péage urbain au sein <strong>de</strong> cinq gran<strong>de</strong>s agglomérations. Les critères adoptésconcernent l’efficacité économique <strong>et</strong> l’équité sous ses trois dimensions (horizontale, verticale<strong>et</strong> territoriale). Les auteurs constatent que si les critères d’équité verticale <strong>et</strong> territoriale nesont pas respectés, la mesure est globalement rej<strong>et</strong>ée <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> la population. C’est laraison pour laquelle le péage <strong>du</strong> boulevard périphérique nord <strong>de</strong> Lyon (TEO) a été un échec àses débuts, notamment à cause <strong>de</strong>s restrictions imposées sur les voies parallèles àl’infrastructure à péage.(iv)… <strong>et</strong> dans le domaine <strong>de</strong>s inégalités <strong>de</strong> mobilité au niveau indivi<strong>du</strong>elAu cours <strong>de</strong> notre chapitre intro<strong>du</strong>ctif (I), nous avons mentionné un certain nombre d<strong>et</strong>ravaux portant sur les inégalités d’accès à la voiture particulière. Ces <strong>de</strong>rnières sont fortementliées à <strong>de</strong>s inégalités <strong>de</strong> revenus (Paulo, 2006). Le non-accès à une voiture particulière peutposer <strong>de</strong>s problèmes en termes d’accessibilité aux emplois (Wenglenski, 2003) <strong>et</strong> aux services(Caubel, 2006). C’est pourquoi d’autres travaux se sont focalisés sur le rôle <strong>de</strong>s <strong>transports</strong>collectifs pour limiter ces inégalités d’accès, notamment en matière <strong>de</strong> tarification (Rosales-Montano, Harzo, 1994). Parmi les ménages motorisés, les travaux <strong>de</strong> C. Paulo (2006) ontmontré que les inégalités <strong>de</strong> mobilité quotidienne étaient considérablement ré<strong>du</strong>ites <strong>et</strong> nedépendaient quasiment plus <strong>du</strong> revenu <strong>de</strong>s ménages. En outre, les travaux <strong>de</strong> D. Caubel(2006) ont montré que les inégalités d’accès (accessibilité potentielle) aux services sontfaibles à partir <strong>du</strong> moment où le ménage est motorisé au sein <strong>de</strong> l’aire urbaine lyonnaise.En revanche, les inégalités en termes <strong>de</strong> dépense pour les ménages motorisés existentbel <strong>et</strong> bien dans le champ <strong>de</strong> la mobilité quotidienne (Orfeuil, Polacchini, 1998 ; Nicolas <strong>et</strong> al.42