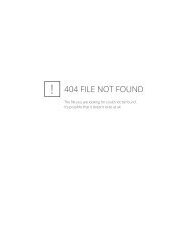L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’interv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> <strong>petite</strong> <strong>en</strong>fance : <strong>pour</strong> <strong>une</strong> éducation développem<strong>en</strong>taleLe défi del’interv<strong>en</strong>tion consisteà r<strong>en</strong>dre accessible, àla Personne, le pluslarge év<strong>en</strong>tail d’av<strong>en</strong>uespossibles de développem<strong>en</strong>t,de façon à luipermettre des choixsignifiants de son pointde vue, tout <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>antet <strong>en</strong> assurantson intégration sociale.malgré le souti<strong>en</strong> d’un expert (professionnel de l’interv<strong>en</strong>tion psychosociale), est laplus vulnérable et a le moins de ressources <strong>pour</strong> assumer le changem<strong>en</strong>t prescrit.Cette proposition de changem<strong>en</strong>t, dégagée à partir d’<strong>une</strong> analyse normative, est souv<strong>en</strong>tpeu signifiante <strong>pour</strong> quelqu’un qui se caractérise justem<strong>en</strong>t par son écart à lanorme ou <strong>en</strong>core, par des aspects de son contexte de vie jugés non favorables. Lesfaibles taux de réussite des interv<strong>en</strong>tions psychosociales et les effets de stigmatisationrapportés, sont éloqu<strong>en</strong>ts à cet égard (Hurtubise et Vatz Laaroussi, 1996a). Ensomme, le changem<strong>en</strong>t proposé offre peu de garanties de correspondance avec lecontexte de vie de la Personne ciblée et donc, r<strong>en</strong>d difficile le mainti<strong>en</strong> et la généralisationdes acquis. C’est à cette idéologie dominante, que Hurtubise et Vatz Laaroussi(1996a) nomm<strong>en</strong>t « idéologie du problème », que se bute toute proposition de valorisationet de développem<strong>en</strong>t du pot<strong>en</strong>tiel d’action de la Personne.Par ailleurs, au-delà des catégorisations habituelles des approches prév<strong>en</strong>tives(Landry et Guay, 1987), l’approche de valorisation reconnaît à priori le pot<strong>en</strong>tieladaptatif de la Personne comme seule base solide de changem<strong>en</strong>t (Bouchard, 1989;Hurtubise et Vatz Laaroussi, 1996b). Cette approche repose sur l’énoncé tautologique,aux antipodes d’<strong>une</strong> perspective normative, qui veut que tout être humain estadapté puisqu’il est vivant. L’expert n’est donc plus à l’extérieur du microsystème,mais bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>raciné dans le microsystème des interactions humaines, puisque le véritableexpert ne peut être que la Personne elle-même.Par conséqu<strong>en</strong>t, le défi de l’interv<strong>en</strong>tion consiste à r<strong>en</strong>dre accessible, à laPersonne, le plus large év<strong>en</strong>tail d’av<strong>en</strong>ues possibles de développem<strong>en</strong>t, de façon à luipermettre des choix signifiants de son point de vue, tout <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ant et <strong>en</strong> assurantson intégration sociale. Or, cet élargissem<strong>en</strong>t des perspectives passe par <strong>une</strong>description significative de la diversité des modes d’adaptation et des phénomènesassociés au développem<strong>en</strong>t. Ainsi, le pot<strong>en</strong>tiel individuel défini à partir d’un jugem<strong>en</strong>tfondé sur la qualité d’être, sert de point d’ancrage à l’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t de laPersonne. Enfin, l’approche de valorisation n’est pas alim<strong>en</strong>tée par les recherches <strong>en</strong>psychopathologie développem<strong>en</strong>tale, mais s’appuie sur les recherches descriptivesdu développem<strong>en</strong>t normal. La valeur c<strong>en</strong>trale d’<strong>une</strong> telle perspective est la valorisationdes différ<strong>en</strong>ces comme source d’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t individuel et collectif.La contribution et le rôle de la recherche dans tout ça…Les défis <strong>pour</strong> la recherche sont de taille. En effet, comm<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>dre compte detoute la complexité du développem<strong>en</strong>t? De notre point de vue, la recherche doit serec<strong>en</strong>trer sur l’étude du développem<strong>en</strong>t humain <strong>en</strong> tant que phénomène historique,c’est-à-dire sur les processus. Ceci implique de reconnaître d’<strong>une</strong> part, notre difficultéà id<strong>en</strong>tifier des facteurs causaux d’adaptation ou d’inadaptation et d’autre part,notre incapacité à prédire l’issue du développem<strong>en</strong>t d’<strong>une</strong> Personne ou d’un groupespécifique de Personnes, d’<strong>une</strong> communauté spécifique. Le nombre de variablesimpliquées et les facteurs contextuels toujours changeants demand<strong>en</strong>t que l’on s’attardedavantage à la description empirique des phénomènes.volume XXXIII:2, automne 200535www.<strong>acelf</strong>.ca