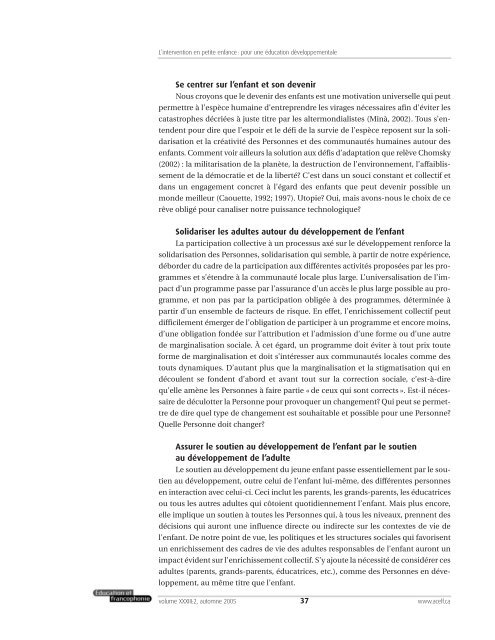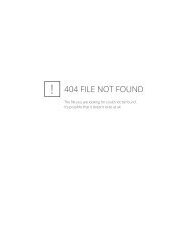L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
L'intervention en petite enfance : pour une éducation ... - acelf
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’interv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> <strong>petite</strong> <strong>en</strong>fance : <strong>pour</strong> <strong>une</strong> éducation développem<strong>en</strong>taleSe c<strong>en</strong>trer sur l’<strong>en</strong>fant et son dev<strong>en</strong>irNous croyons que le dev<strong>en</strong>ir des <strong>en</strong>fants est <strong>une</strong> motivation universelle qui peutpermettre à l’espèce humaine d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre les virages nécessaires afin d’éviter lescatastrophes décriées à juste titre par les altermondialistes (Minà, 2002). Tous s’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<strong>pour</strong> dire que l’espoir et le défi de la survie de l’espèce repos<strong>en</strong>t sur la solidarisationet la créativité des Personnes et des communautés humaines autour des<strong>en</strong>fants. Comm<strong>en</strong>t voir ailleurs la solution aux défis d’adaptation que relève Chomsky(2002) : la militarisation de la planète, la destruction de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, l’affaiblissem<strong>en</strong>tde la démocratie et de la liberté? C’est dans un souci constant et collectif etdans un <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t concret à l’égard des <strong>en</strong>fants que peut dev<strong>en</strong>ir possible unmonde meilleur (Caouette, 1992; 1997). Utopie? Oui, mais avons-nous le choix de cerêve obligé <strong>pour</strong> canaliser notre puissance technologique?Solidariser les adultes autour du développem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>fantLa participation collective à un processus axé sur le développem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>force lasolidarisation des Personnes, solidarisation qui semble, à partir de notre expéri<strong>en</strong>ce,déborder du cadre de la participation aux différ<strong>en</strong>tes activités proposées par les programmeset s’ét<strong>en</strong>dre à la communauté locale plus large. L’universalisation de l’impactd’un programme passe par l’assurance d’un accès le plus large possible au programme,et non pas par la participation obligée à des programmes, déterminée àpartir d’un <strong>en</strong>semble de facteurs de risque. En effet, l’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t collectif peutdifficilem<strong>en</strong>t émerger de l’obligation de participer à un programme et <strong>en</strong>core moins,d’<strong>une</strong> obligation fondée sur l’attribution et l’admission d’<strong>une</strong> forme ou d’<strong>une</strong> autrede marginalisation sociale. À cet égard, un programme doit éviter à tout prix touteforme de marginalisation et doit s’intéresser aux communautés locales comme destouts dynamiques. D’autant plus que la marginalisation et la stigmatisation qui <strong>en</strong>découl<strong>en</strong>t se fond<strong>en</strong>t d’abord et avant tout sur la correction sociale, c’est-à-direqu’elle amène les Personnes à faire partie « de ceux qui sont corrects ». Est-il nécessairede déculotter la Personne <strong>pour</strong> provoquer un changem<strong>en</strong>t? Qui peut se permettrede dire quel type de changem<strong>en</strong>t est souhaitable et possible <strong>pour</strong> <strong>une</strong> Personne?Quelle Personne doit changer?Assurer le souti<strong>en</strong> au développem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>fant par le souti<strong>en</strong>au développem<strong>en</strong>t de l’adulteLe souti<strong>en</strong> au développem<strong>en</strong>t du je<strong>une</strong> <strong>en</strong>fant passe ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t par le souti<strong>en</strong>au développem<strong>en</strong>t, outre celui de l’<strong>en</strong>fant lui-même, des différ<strong>en</strong>tes personnes<strong>en</strong> interaction avec celui-ci. Ceci inclut les par<strong>en</strong>ts, les grands-par<strong>en</strong>ts, les éducatricesou tous les autres adultes qui côtoi<strong>en</strong>t quotidi<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>fant. Mais plus <strong>en</strong>core,elle implique un souti<strong>en</strong> à toutes les Personnes qui, à tous les niveaux, pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t desdécisions qui auront <strong>une</strong> influ<strong>en</strong>ce directe ou indirecte sur les contextes de vie del’<strong>en</strong>fant. De notre point de vue, les politiques et les structures sociales qui favoris<strong>en</strong>tun <strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t des cadres de vie des adultes responsables de l’<strong>en</strong>fant auront unimpact évid<strong>en</strong>t sur l’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t collectif. S’y ajoute la nécessité de considérer cesadultes (par<strong>en</strong>ts, grands-par<strong>en</strong>ts, éducatrices, etc.), comme des Personnes <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t,au même titre que l’<strong>en</strong>fant.volume XXXIII:2, automne 200537www.<strong>acelf</strong>.ca