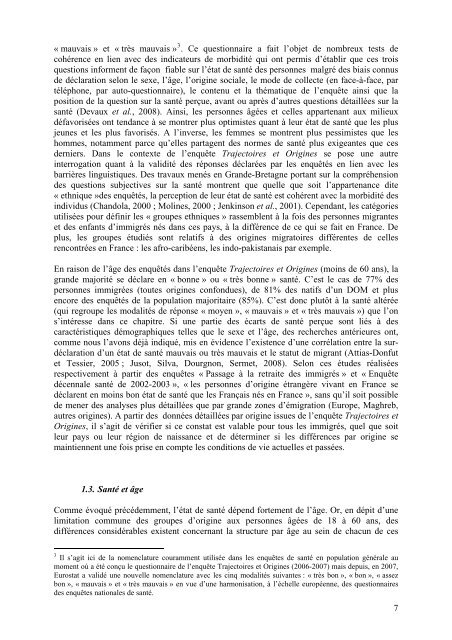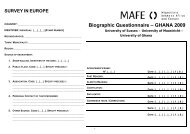Chapitre 10 : L'expérience de la migration, santé perçue et ... - Ined
Chapitre 10 : L'expérience de la migration, santé perçue et ... - Ined
Chapitre 10 : L'expérience de la migration, santé perçue et ... - Ined
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
« mauvais » <strong>et</strong> « très mauvais » 3 . Ce questionnaire a fait l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> nombreux tests <strong>de</strong>cohérence en lien avec <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> morbidité qui ont permis d’établir que ces troisquestions informent <strong>de</strong> façon fiable sur l’état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> <strong>de</strong>s personnes malgré <strong>de</strong>s biais connus<strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration selon le sexe, l’âge, l’origine sociale, le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte (en face-à-face, partéléphone, par auto-questionnaire), le contenu <strong>et</strong> <strong>la</strong> thématique <strong>de</strong> l’enquête ainsi que <strong>la</strong>position <strong>de</strong> <strong>la</strong> question sur <strong>la</strong> <strong>santé</strong> <strong>perçue</strong>, avant ou après d’autres questions détaillées sur <strong>la</strong><strong>santé</strong> (Devaux <strong>et</strong> al., 2008). Ainsi, les personnes âgées <strong>et</strong> celles appartenant aux milieuxdéfavorisées ont tendance à se montrer plus optimistes quant à leur état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> que les plusjeunes <strong>et</strong> les plus favorisés. A l’inverse, les femmes se montrent plus pessimistes que leshommes, notamment parce qu’elles partagent <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> <strong>santé</strong> plus exigeantes que ces<strong>de</strong>rniers. Dans le contexte <strong>de</strong> l’enquête Trajectoires <strong>et</strong> Origines se pose une autreinterrogation quant à <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s réponses déc<strong>la</strong>rées par les enquêtés en lien avec lesbarrières linguistiques. Des travaux menés en Gran<strong>de</strong>-Br<strong>et</strong>agne portant sur <strong>la</strong> compréhension<strong>de</strong>s questions subjectives sur <strong>la</strong> <strong>santé</strong> montrent que quelle que soit l’appartenance dite« <strong>et</strong>hnique »<strong>de</strong>s enquêtés, <strong>la</strong> perception <strong>de</strong> leur état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> est cohérent avec <strong>la</strong> morbidité <strong>de</strong>sindividus (Chando<strong>la</strong>, 2000 ; Molines, 2000 ; Jenkinson <strong>et</strong> al., 2001). Cependant, les catégoriesutilisées pour définir les « groupes <strong>et</strong>hniques » rassemblent à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s personnes migrantes<strong>et</strong> <strong>de</strong>s enfants d’immigrés nés dans ces pays, à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> ce qui se fait en France. Deplus, les groupes étudiés sont re<strong>la</strong>tifs à <strong>de</strong>s origines migratoires différentes <strong>de</strong> cellesrencontrées en France : les afro-caribéens, les indo-pakistanais par exemple.En raison <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong>s enquêtés dans l’enquête Trajectoires <strong>et</strong> Origines (moins <strong>de</strong> 60 ans), <strong>la</strong>gran<strong>de</strong> majorité se déc<strong>la</strong>re en « bonne » ou « très bonne » <strong>santé</strong>. C’est le cas <strong>de</strong> 77% <strong>de</strong>spersonnes immigrées (toutes origines confondues), <strong>de</strong> 81% <strong>de</strong>s natifs d’un DOM <strong>et</strong> plusencore <strong>de</strong>s enquêtés <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion majoritaire (85%). C’est donc plutôt à <strong>la</strong> <strong>santé</strong> altérée(qui regroupe les modalités <strong>de</strong> réponse « moyen », « mauvais » <strong>et</strong> « très mauvais ») que l’ons’intéresse dans ce chapitre. Si une partie <strong>de</strong>s écarts <strong>de</strong> <strong>santé</strong> <strong>perçue</strong> sont liés à <strong>de</strong>scaractéristiques démographiques telles que le sexe <strong>et</strong> l’âge, <strong>de</strong>s recherches antérieures ont,comme nous l’avons déjà indiqué, mis en évi<strong>de</strong>nce l’existence d’une corré<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> surdéc<strong>la</strong>rationd’un état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> mauvais ou très mauvais <strong>et</strong> le statut <strong>de</strong> migrant (Attias-Donfut<strong>et</strong> Tessier, 2005 ; Jusot, Silva, Dourgnon, Serm<strong>et</strong>, 2008). Selon ces étu<strong>de</strong>s réaliséesrespectivement à partir <strong>de</strong>s enquêtes « Passage à <strong>la</strong> r<strong>et</strong>raite <strong>de</strong>s immigrés » <strong>et</strong> « Enquêtedécennale <strong>santé</strong> <strong>de</strong> 2002-2003 », « les personnes d’origine étrangère vivant en France sedéc<strong>la</strong>rent en moins bon état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> que les Français nés en France », sans qu’il soit possible<strong>de</strong> mener <strong>de</strong>s analyses plus détaillées que par gran<strong>de</strong> zones d’é<strong>migration</strong> (Europe, Maghreb,autres origines). A partir <strong>de</strong>s données détaillées par origine issues <strong>de</strong> l’enquête Trajectoires <strong>et</strong>Origines, il s’agit <strong>de</strong> vérifier si ce constat est va<strong>la</strong>ble pour tous les immigrés, quel que soitleur pays ou leur région <strong>de</strong> naissance <strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer si les différences par origine semaintiennent une fois prise en compte les conditions <strong>de</strong> vie actuelles <strong>et</strong> passées.1.3. Santé <strong>et</strong> âgeComme évoqué précé<strong>de</strong>mment, l’état <strong>de</strong> <strong>santé</strong> dépend fortement <strong>de</strong> l’âge. Or, en dépit d’unelimitation commune <strong>de</strong>s groupes d’origine aux personnes âgées <strong>de</strong> 18 à 60 ans, <strong>de</strong>sdifférences considérables existent concernant <strong>la</strong> structure par âge au sein <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong> ces3 Il s’agit ici <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture couramment utilisée dans les enquêtes <strong>de</strong> <strong>santé</strong> en popu<strong>la</strong>tion générale aumoment où a été conçu le questionnaire <strong>de</strong> l’enquête Trajectoires <strong>et</strong> Origines (2006-2007) mais <strong>de</strong>puis, en 2007,Eurostat a validé une nouvelle nomenc<strong>la</strong>ture avec les cinq modalités suivantes : « très bon », « bon », « assezbon », « mauvais » <strong>et</strong> « très mauvais » en vue d’une harmonisation, à l’échelle européenne, <strong>de</strong>s questionnaires<strong>de</strong>s enquêtes nationales <strong>de</strong> <strong>santé</strong>.7