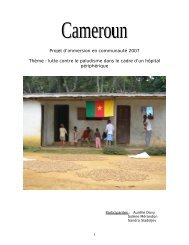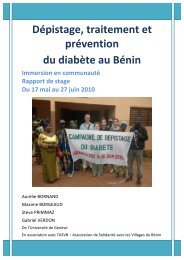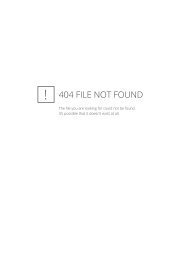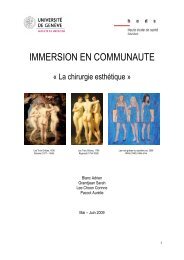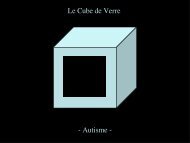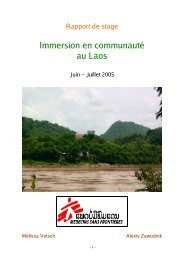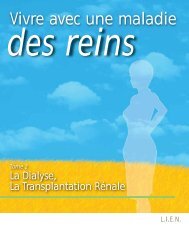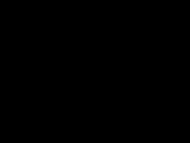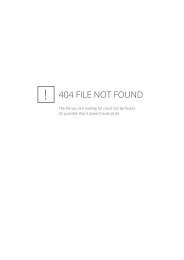rapport (soins palliatifs)
rapport (soins palliatifs)
rapport (soins palliatifs)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IMMERSION EN COMMUNAUTESOINS PALLIATIFSl’épreuve de la maladie grave ou chronique, de nombreux croyants vivent une période de remise enquestion de leur foi et éprouvent de la révolte face à un Dieu dont ils ne comprennent pas le message.« Pourquoi me punit-il ? » « Pourquoi reste-t-il sourd à mes prières ? » Il est à noter également que denombreuses personnes qui subissent une maladie longue et douloureuse la supportent et y trouvent unsens grâce à une force spirituelle et une confiance profonde en un dieu bon et salvateur. Les athées,eux, seront plus facilement défaitistes et accepteront moins facilement une épreuve qu’ils jugentabsurde et injuste.Lorsque la mort est proche, la plupart des malades ressentent à la fois un désir de mort dans la sérénitéet la paix intérieure, et à la fois de la peur et de l’angoisse face à l’inconnu. En général, ce sont lespatients qui n’ont pas pu ou voulu régler tout ce qui pesait sur leur âme (sentiment de culpabilité,incapacité de réconciliation avec des proches, non-dits, etc.) qui ont le plus de difficultés et d’angoisse àpartir. Certains d’ailleurs, même à demi-conscients, ne parviennent pas à lâcher prise tant que quelquechose qui les tracassait n’a pas été dit, tant qu’une personne qu’ils voulaient voir une dernière fois n’estpas venue, ou tant qu’un geste de pardon n’a pas été fait. Ce soulagement peut aussi leur être apportépar un accompagnement spirituel, en priant, en lisant des psaumes, en se confessant ou en assistant àun culte.Le soutien spirituel n’a pas pour vocation d’empêcher la souffrance ou l’angoisse, mais il permet« d’humaniser le passage ». Le rôle de l’accompagnant n’est pas de chercher à imposer ses propresvaleurs spirituelles au malade en fin de vie, mais à se faire le témoin empli de compassion de ladernière trace laissée par une personne qui a traversé l’épreuve ultime et enfin trouvé la paix. C’est unetâche délicate et exigeante et, pour l’accomplir correctement et sereinement, il faut que l’équipe desoignants soit soudée et solidaire et que chacun puisse évacuer son stress et sa propre angoisse faceà la mort (via des supervisions par exemple), au risque, sinon, de s’épuiser.MortLa mort est une étape normale de la vie de chacun, au même titre que la naissance, l’adolescence,l’âge adulte et la vieillesse et elle offre une chance ultime de se réaliser en intégrant toutes lesdimensions de l’existence. La mort est une occasion d’accéder enfin, de son vivant, à une sérénitéparfois inconnue jusqu’à ce jour. 13 Dans une «bonne» fin de vie le «pourquoi vivre encore» setransforme en «pourquoi avoir vécu» et prend tout son sens s’il peut être partagé avec une personnedont l’écoute est de qualité. Pourtant, le concept de « bonne mort » reste un mythe, tant l’acte de mouriréchappe à toute rationalisation et tentative d’explication.Jusqu’au dernier moment, l’accompagnement du mourant est communication, même par le seultoucher, si aucune autre relation ne peut être établie. C’est cette communication verbale ou nonverbale,profonde, sincère et emprunte de chaleur qui permet au mourant de se sentir en confiance etde se laisser aller dans l’acceptation de sa fin. L’aide apportée par le soignant, bénévole ou non, n’estdonc plus tant de l’ordre du savoir-faire, que du savoir-être. Par sa présence attentive, l’accompagnantdoit se faire le témoin et non l’acteur d’une transformation profonde du mourant qui lui permettrait degrandir une dernière fois et de se montrer digne devant sa mort. Il doit aussi laisser le temps aumourant de parvenir à exprimer de lui-même, par la parole ou par son attitude qu’il est conscient qu’il vamourir afin qu’il reste jusqu’au bout le sujet de sa vie.13 Claire Kebers, Soins <strong>palliatifs</strong>, <strong>soins</strong> curatifs : leurs différences, leurs complémentarité, p.41-42De La Fuente V. , Petreska I. ,Schmid B. , Schwitzguébel A. - Page 36 -