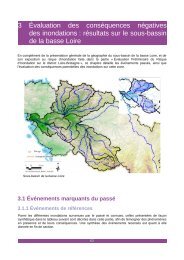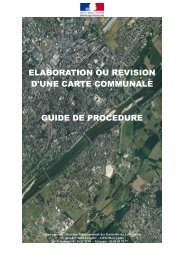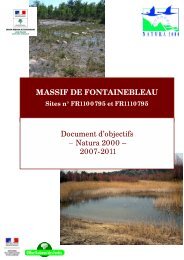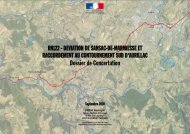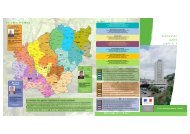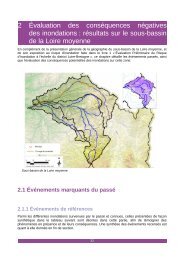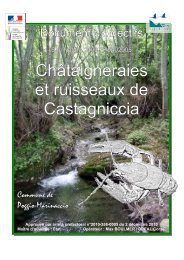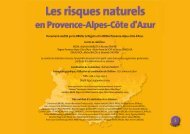Risques littoraux majeurs - Webissimo
Risques littoraux majeurs - Webissimo
Risques littoraux majeurs - Webissimo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1804 -4.8354 48.715 Au large de l’île de Tariec1818 -3.3637 48.943 Au large de l’île des Femmes1791 -5.1460 48.197 Au large de Beniguet1730 -2.3667 46.720 Au large de l’Ile d’YeuFigure 8 : Coordonnées des points de mesure de l’orientation des houles au large extraits de l’atlasnumérique de houle (Lafon et Benoît, 2005)L’analyse des variations d’orientation des houles permet d’identifier trois grandes périodes communes à tous lespoints (fig. 9) : dans la première, la composante méridienne nord ou sud des orientations de houles tend à serenforcer ; une période d’affaiblissement de la composante méridienne lui succède durant laquelle les directionsmoyennes redeviennent plus zonales ; enfin, cette dernière est suivie d’une nouvelle période de renforcement dela composante méridienne nord ou sud des directions. Au total (fig. 10), ce type d’évolution met en évidence unrenforcement graduel de la composante méridienne des directions de houle entre 1979 et 2003. Cependant, lapériode intermédiaire d’orientation plus zonale compense généralement le renforcement de la composanteméridienne qui s’était produit durant la première période. C’est le cas aux points 1804, 1791 et 1730 où, enquelques années, les houles retrouvent leurs orientations antérieures. Ce n’est par contre pas le cas aux points1818 et 1771 où, de ce fait, le renforcement de la composante méridienne durant la dernière période est plusnettement accentué. Dans le temps, les dates de début et de fin de ces trois épisodes successifs ne sont pas pourautant concordantes. La période intermédiaire de retour de la direction moyenne des houles vers des orientationsplus zonales est la seule que l’on puisse caractériser par des dates de début et de fin, les deux autres ayantrespectivement débuté avant le début ou se poursuivant après la fin des observations. Cette période intermédiairese produit aux environs du début des années 1990 et dure plus ou moins longuement selon les points examinés.Elle s'étend ainsi de 1987 à 1994 au point 1818 ; de 1991 à 1994 au point 1804 ; de 1990 à 1997 au point 1791 ;de 1990 à 1993 au point 1730. Au point 1771, cette période est singulière : elle se produit de 1987 à 1999, c’està-dire,sur une plus longue durée qu’aux autres points et est entrecoupée par une phase d’affaiblissement de lacomposante méridienne entre 1990 et 1995. On observe une autre singularité au point 1730. Le renforcement dela composante méridienne se fait ici selon une direction nord-sud durant la première période et selon desdirections alternativement N-S et S-N durant la dernière période.La comparaison des résultats obtenus par l’analyse des indicateurs naturels et l’analyse des points extraits del’atlas numérique est évidemment délicate. Il s’agit, en effet, de points de mesure différant, d’une part, par leurlocalisation respective à la côte et au large, d’autre part, par le pas de temps entre chaque mesure. Malgré cesdifférences, cette comparaison permet de tester la valeur des indicateurs naturels des directions de houles et laméthode utilisée. Du point de vue des orientations, la comparaison met en évidence un décalage plus ou moinsimportant entre les directions obtenues par les indicateurs naturels et celles obtenues au large : au Pont-d’Yeu10° d’écart vers le nord par rapport au point 1730 ; à Tariec, décalage de plus de 35° par rapport au point 1804.L’orientation absolue n’est cependant pas un paramètre fondamental de l’analyse. Plus que les orientationsmesurées, ce sont surtout les tendances évolutives décrites par les deux séries de mesures qui importent. De cepoint de vue, les résultats sont généralement satisfaisants. Dans la majorité des cinq cas examinés, les deuxcourbes décrivent des tendances évolutives comparables et les trois périodes décrites par l’analyse des mesuresextraites de l’atlas numérique peuvent être plus ou moins aisément différenciées. Cependant, on observe quecertaines évolutions sont soit atténuées, soit amplifiées par les mesures obtenues sur les indicateurs naturels cequi ne permettrait éventuellement pas de les distinguer des périodes antérieures ou postérieures. Ces exagérationsne semblent pas uniquement liées à la différence de localisation à la côte et au large. Il semble que le nombre demesures effectuées sur les indicateurs naturels soit un critère de différenciation. Ainsi, à Groix, les 15 mesuresréalisées montrent une bonne correspondance entre les deux courbes jusqu’en 1994 (10 mesures entre 1979 et1994). Par contre, à l’île des Femmes où l’on ne dispose que de trois mesures, la courbe obtenue est trop lisséepour permettre la distinction des différentes périodes mises en évidence à partir des mesures effectuées au point1818. Des exagérations de la tendance évolutive apparaissent également en fin de période à Béniguet et au Pontd’Yeu.Le calage des différentes périodes d’évolution dans le temps paraît également satisfaisant dans la mesure,là aussi, où l’on dispose d’un nombre d’observations suffisant sur les indicateurs naturels. Au pas de tempsutilisé, il semble que les indicateurs naturels sont suffisamment sensibles pour enregistrer avec un temps réduitles variations majeures des directions de houles. Le meilleur exemple est évidemment donné par la courbeobtenue à Groix en comparaison du point 1771. Lorsque l’on dispose de mesures recueillies sur plusieurs annéesconsécutives, celles-ci mettent généralement bien en évidence les variations interannuelles enregistrées sur lespoints au large. Avec des mesures plus espacées dans le temps, comme à Tariec, Béniguet et au Pont-d’Yeu, ledécalage est presqu’inexistant.