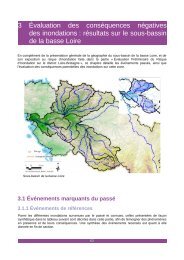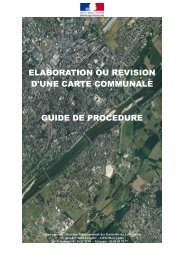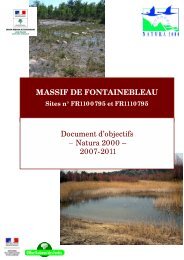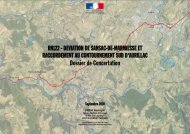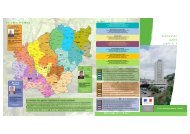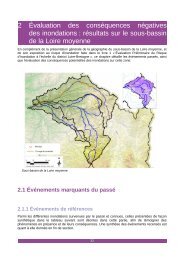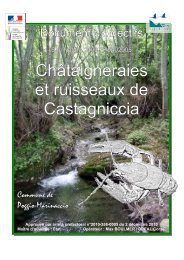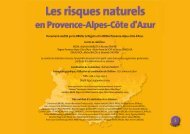6 ème journées scientifiques et techniques du CETMEF– Paris– Décembre 2006 – Laborie et Heurtefeux – modélisation et observation de submersionde dunes en Languedoc -Roussillontémoignent d'une morphologie propre aux phénomènes d'overwash : une forme étalée en forme de lobe(« washover fan »).III.2.2 Proposition d'un schéma de fonctionnement du lido de Villeneuve les MagueloneLe fonctionnement séquentiel du cordon dunaire soumis à un épisode d'overwash peut alors être décrit dela manière suivante:1. la surcote et les houles de tempête repoussent l’eau marine vers l’étang. La pente de la plage estrégulière et la masse d’eau progresse en écoulement transcritique tout en mobilisant du matériel.2. A l’approche du cordon dunaire les vagues les plus hautes parviennent à franchir celui-ci tandis quele reste de la lame d’eau s’engouffre par des points dépressionnaires et en particulier par le chenaldéjà creusé lors des tempêtes précédentes. Cette concentration de l’énergie des vagues provoque unélargissement du chenal primitif. De plus, l’eau a tendance à se diffuser car elle doit passer lesommet du cordon ; elle creuse de façon latérale. A ce niveau une grande quantité de matériel estarrachée et mobilisée par les intrusions marines.3. Une fois la dune franchie par l'écoulement, le chenal principal se maintient en se rétrécissant, lapente inverse côté baie concourant plutôt à une incision de la plage par l'écoulement. La contraintede cisaillement exercée par l'écoulement sur le sol et accentuée par l'augmentation de la pente entrele sommet du cordon dunaire et la concavité basale côté base conduit à la formation d'un chenal.L’eau contenue dans ce chenal dépose tout d’abord le matériel de façon latérale sous la formed’accumulations sableuses jusqu’à la concavité, puis vers l’avant de façon plus diffuse. Aux bords del’étang le matériel s’étale dans le sens de la plus forte pente en fonction de la topographie locale.Aux abords de l'étang, les eaux sont ralenties dans leur progression et déposent leur chargesédimentaire.En ce qui concerne la largeur du lido, le trait de côte en recul au niveau de la plage est totalementcompensé du côté de l’étang et le déficit en volume de sédiments de la plage est en partie récupéré en arrièredes dunes. On assiste donc bien à un phénomène de « rollover » du cordon dunaire accompagné d'uneérosion quasi-généralisée.L'analyse des transferts réalisée ici conduit à la proposition d'un schéma de fonctionnement du lido deVilleneuve les Maguelone dont on essaie de représenter, dans la suite, une partie de l'hydrodynamique àl'aide d'une approche par le modèle ARTEMIS basée sur l'équation de Berkhoff modifiée pour prendre encompte le frottement et le déferlement et le code de calcul courantologique TELEMAC qui résout leséquations de Saint-Venant bidimensionnelles et qui peut prendre en compte les contraintes de radiationcalculées par ARTEMIS.IV MODÉLISATION HYDRODYNAMIQUE DU LIDO DE VILLENEUVE LES MAGUELONEIV.1OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU MODELE DE VILLENEUVE LES MAGUELONEL'analyse de la tempête des 3 et 4 Décembre 2003 réalisée par le Service Maritime et de Navigation duLanguedoc Roussillon ([6]), ainsi que les données de houle issues de la base de données CANDHIS et lesdonnées marégraphiques mises à disposition par le SMNLR indiquent un paroxysme le 4 décembre 2003 à7h00 avec une hauteur significative de 4,87 m mesurée par 30 m de profondeur par un houlographe nondirectionnel situé au large de Sète. La période de houle correspondante est de 10,2 s. Cette hauteur de houleétait associée à une surélévation du plan d'eau moyen relativement normale pour la saison à 0,9 m NGF69 aumaximum de l'événement.A partir de la bathymétrie mise à disposition par l'EID Méditerranée et le SMNLR, un modèlebidimensionnel a été construit en utilisant MATISSE, le mailleur de la chaîne de calcul TELEMAC; ladiscrétisation du domaine de calcul s'est faite par éléments finis triangulaires. Il s'agit d'un modèlebidimensionnel dont le profil transversal est reproduit suivant y (cas-test monodimensionnel) au droit de lapartie de la dune comprenant la brèche. Le modèle fait 700 m de long sur 5 m de large. Le maillage utiliséest régulier ; les mailles font 1 m dans le sens longitudinal et de 1 m à 2 m dans le sens transversal (2 m à lafrontière maritime et 1 m près du rivage).
6 ème journées scientifiques et techniques du CETMEF– Paris– Décembre 2006 – Laborie et Heurtefeux – modélisation et observation de submersionde dunes en Languedoc -RoussillonFigure 4: Profil transversal utilisé pour laconstruction du modèle.Figure 5: Représentation d’un overwash àVilleneuve les Maguelonne (crédit photo : EIDMéditerranée).Le modèle bidimensionnel ainsi construit comprend 3308 noeuds. Il a été nécessaire de porter la frontièremaritime là où la profondeur avoisine les 6 m afin de la situer suffisamment loin de la zone de déferlement.La figure 4 montre que la cote altimétrique de la portion de dune modélisée, située au niveau de la brèche(figure 5), qui correspond à la situation de décembre 2003, se situe aux environs de 1,44 m NGF69. La cotede la crête, même dans ce point dépressionnaire, étant supérieure au niveau moyen du plan d'eau pendant latempête, on peut en conclure que les franchissements subis par la barrière sableuse pendant l'événement dedécembre 2003 sont des franchissements liés au set-up de houle et par « run-up » et non par inondation. Dansla mesure où le cordon dunaire a été franchi et que 1 m séparent la cote du plan d'eau mesuré (comprenant lasurcote et la marée) de la cote de la dune, c'est que les contributions totales de la houle, via le set-up et lerun-up, excèdent le mètre. L'objectif est donc de calculer le set-up de la houle au droit du cordon dunaire deVilleneuve les Maguelone en utilisant les courants de houle calculés par ARTEMIS, décrit dans leparagraphe suivant, et en les injectant ensuite dans le code courantologique bidimensionnel TELEMAC2D. Ils'agit d'une méthode pour prendre en compte la houle dans le calcul courantologique pour cette étude defaisabilité, une autre aurait pu être d'injecter le signal de houle monochromatique à la frontière maritime dudomaine d'étude et d'en étudier la propagation.IV.2 MODELISATION DE LA HOULEIV.2.1 Présentation du code de calcul ARTEMIS – modèle de Berkhoff modifiéLe code de calcul ARTEMIS est basé sur la résolution de l'équation de Berkhoff, modèle bidimensionnelqui décrit la réfraction et la diffraction d'une houle monochromatique par des fonds lentement variables enespace et des obstacles lentement immergés. Pour une description très complète du code ARTEMIS et dumodèle de Berkhoff, le lecteur se reportera à [7]. Dans ARTEMIS le modèle de Berkhoff a été modifié et destermes ajoutés de telle sorte de pouvoir prendre en compte les dissipations d'énergie par déferlement et parfrottement sur le fond.IV.2.2 Propagation de la houle du 04 décembre 2003 à 7h00Les caractéristiques de la houle du 4 décembre 2003 à 7h00 ont déjà été décrites dans le paragrapheprécédent : hauteur significative Hs = 4,87 m par 30 m de profondeur, Ts=10,2 s associée à un plan d'eau de0,9 m NGF 69.Cette houle a été propagée à la frontière du modèle par la théorie de la houle linéaire. On obtient une hauteurde houle de 4,7 m à 6 m de profondeur. Le critère de déferlement utilisé est celui de Miche imposé à 0,8 et laméthode de Dally (cf. [5]) est utilisée pour la dissipation de l'énergie de la houle par déferlement avec lesparamètres Kdally = 0,275 et Gdally = 0,475, compte-tenu des pentes côté maritime du profil transversal. Onobserve bien la décroissance de la houle au passage de la première barre de déferlement puis du relèvementdes fonds. Ce sont ces variations en espace de la houle qui conduisent à la présence de forces de radiationdans la 1ère zone de déferlement et près la plage, comme le montre également le graphique ci-dessus. Enréalité, les forces de radiation ne s'appliquant que là où il y a de l'eau, seuls les deux premiers pics seront
- Page 1 and 2:
Session 3Risques littoraux majeursP
- Page 4 and 5:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 6 and 7:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 8 and 9:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 10 and 11:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 12 and 13:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 14 and 15:
VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 16 and 17:
Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 18 and 19:
Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 20 and 21:
Hauteurs >ZH (cm)Saint-Jean-de-Luz2
- Page 22 and 23:
Fréquence(%)3530252015Directions d
- Page 24 and 25:
Fig. 4Station1. Saint-Jean-de-Luz2.
- Page 26 and 27:
confrontés aux tendances passées
- Page 28 and 29:
La majeure partie des indicateurs d
- Page 30 and 31:
1804 -4.8354 48.715 Au large de l
- Page 32 and 33: RUFINO DOS SANTOS T., PINOT J.-P.,
- Page 34 and 35: GoueltocGoulvenLe CurnicIle TariecR
- Page 36 and 37: 3203103002902802702602502401775 180
- Page 38 and 39: 7060504030201001775 1800 1825 1850
- Page 40 and 41: 315310305300Pt 1818295290285Pt 1804
- Page 42 and 43: MODELISATION DE L’IMPACT DU CHANG
- Page 44 and 45: évaluer leur importance lorsqu’i
- Page 46 and 47: l’enchaînement temporel des for
- Page 48 and 49: Morellato, D., Sabatier, F., Pon,s
- Page 50 and 51: CasHoule- intensité -Houle- durée
- Page 52 and 53: altitude m NGF (IGN 69)6543210-1-2-
- Page 54 and 55: 200augmentation de l'érosion (%180
- Page 56 and 57: Journées Scientifiques et Techniqu
- Page 58 and 59: Journées Scientifiques et Techniqu
- Page 60 and 61: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 62 and 63: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 64 and 65: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 66 and 67: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 68 and 69: Laboratory experiments have been pe
- Page 70 and 71: development of a vortex at the bloc
- Page 72 and 73: moving slide among these three case
- Page 74 and 75: [3] Walder, J.S., P. Watts, O.E. So
- Page 76 and 77: Session 3 : Risques Littoraux Majeu
- Page 78 and 79: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 80 and 81: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 84 and 85: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 86: ABSTRACTObservations on the Impacts