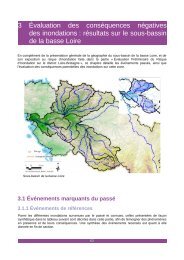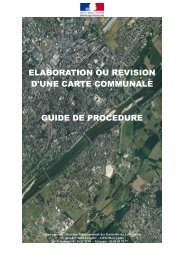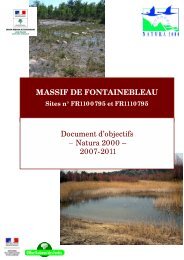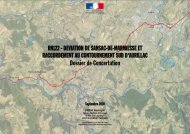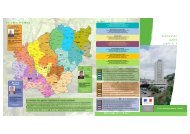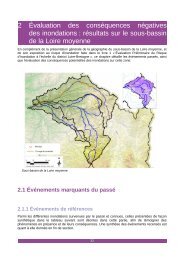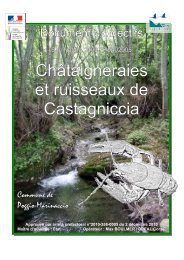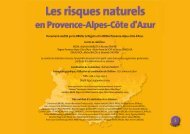Risques littoraux majeurs - Webissimo
Risques littoraux majeurs - Webissimo
Risques littoraux majeurs - Webissimo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
l’enchaînement temporel des forçages joue un rôle important sur les taux d’érosion ce qui explique pourquoides tempêtes, aux caractéristiques apparemment similaires, montrent souvent des taux d’érosionsignificativement différents (Lee et al., 1998). Par conséquent, notre analyse devrait être étendue à plusieurstempêtes extrêmes aux caractéristiques différentes. Nous nous heurtons ici au manque de donnéesexpérimentales existantes pour les événements exceptionnels. Dans le Golfe du Lion, ces lacuness’expliquent à la fois par la rareté de ces événements, la mise en place récente (années 90) d’houlographesmais aussi par la difficulté à produire des mesures expérimentales durant des conditions extrêmes pendantlesquelles l’appareillage montre souvent des problèmes techniques.III.6Applicabilité du modèle pour le calibrage des dunesDans le cas d’une recrudescence maximale des tempêtes (cas 8), la dune n’est pas totalement détruite par latempête (Figure 4). Nos simulations peuvent donc aussi s’utiliser en terme de calibration pour le design desdunes car nous montrons que des dunes de 5 m de hauteur et de 30 m de large sont capables de résister à unetempête extrême. Cette morphologie et ce calibrage pourront donc être utilisés par défaut pour la constitutionde dunes artificielles en vue de protéger des inondations marines les terres qui se trouvent en arrière desplages. Cependant, la modélisation que nous avons réalisée ne concerne qu’un événement extrême de quatrejours. Or, la saison des tempêtes, qui s’étend d’octobre à mars, est toujours marquée par plusieursévénements. Il est donc possible qu’une dune aux caractéristiques retenues dans cet article soit érodée enraison de la succession de plusieurs événements dans un même hiver. A ce jour, le modèle que nous utilisonsne donne pas encore de résultats suffisamment satisfaisants à l’échelle saisonnière, aussi, il convient degarder cette précision à l’esprit et de ne pas considérer que les dunes, dont la morphologie est proche de celleque nous avons simulée, représentent une protection suffisante contre les inondations marines en cas d’unCC.IV CONCLUSION ET PERSPECTIVESDans cet article nous avons modélisé l’érosion d’une dune représentative du littoral en recul de Camargueen augmentant l’intensité et la durée des forçages (houle et niveau de la mer) d’une tempête exceptionnelleen entrée du modèle. Les scénarii retenus avaient pour but de représenter une éventuelle recrudescence destempêtes dans le cas d’un CC. Nous montrons que la houle joue un rôle plus important que le niveau de l’eausur l’érosion de la dune ; que la durée de la tempête, au delà des 4 jours simulés, ne semble pas significativesur l’érosion de la dune ; qu’une augmentation simultanée de la force et de la durée des forçage se traduit parl’érosion la plus forte et que la force et la durée des forçages entretiennent des relations complexes qui setraduisent par des relations non linéaires sur l’érosion du cordon dunaire. De plus, de faibles augmentationsdans la force et/ou la durée des forçages se traduiront par des érosions significativement plus importantes quecelles que nous connaissons aujourd’hui. Il semble donc nécessaire, voire urgent, de commencer à anticiperune augmentation de la force des tempêtes pour une gestion durable du littoral.S’il est généralement admis que le CC devrait augmenter la fréquence et l’intensité des tempêtes (IPCC,2001), de nombreuses incertitudes subsistent à l’échelle régionale aux moyennes latitudes en raison de lavariabilité entre les différents modèles climatiques (Houghton et al., 1995). Si une tendance au renforcementdes événements extrêmes a été mise en évidence dans l’Atlantique Nord et dans la mer du Nord pendant lesdernières décennies (Lamb, 1991, Warrick et al., 1993, Costa, 1997, Héquette et Vasseur, 1998), desrésultats plus nuancés apparaissent aussi (Pirrazoli, 1999) et l’évolution est moins connue en Méditerranée.En effet, si une tendance lente à l’augmentation des surcôtes est observée pendant le XXème siècle (Suanez,1997 ; Sabatier et al., in press ; Ullmann et al., in press), et si l’analyse de vents tri-horaires à Cap Couronne(ouest de Marseille) entre 1961 et 1995 indique une recrudescence de l’intensité et du nombre de tempêtesannuelles à partir de 1978 (Suanez, 1997 ; Ullmann et al., in press), à ce jour, aucune analyse pluri décennalebasée sur des données in situ de houle existe du fait d’une lacune importante de mesures (Sabatier et al., inpress). Nos scénariis d’augmentation de l’amplitude de la houle demandent donc à être confirmés par desétudes climatiques. Il semble cependant raisonnable de considérer qu’il existe une relation directe entre lescoups de vents de mer et les houles de tempêtes ce qui rend les scénarii choisit dans cet article cohérentsavec les résultats d’augmentation historique des tempêtes montrés par Suanez (1997) et Ullmann et al., (inpress) à partir de données de vents. Compte tenu des lacunes instrumentales existantes dans le Golfe du Lion,la perception d’une éventuelle recrudescence des tempêtes (houle) dans cette zone ne pourra s’estimer qu’àpartir de modélisations à moyenne échelle en déterminant d’abord l’évolution des champs de pressions