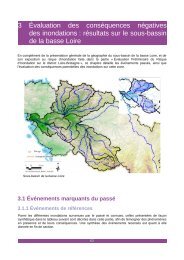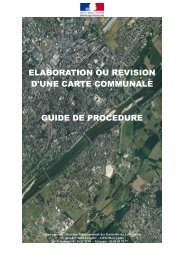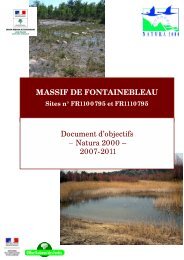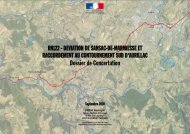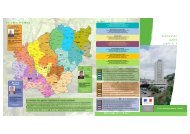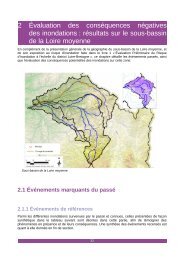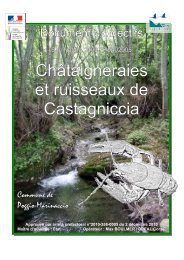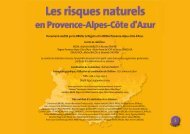évaluer leur importance lorsqu’ils sont couplés (cas 4). Ensuite, une simulation sur la durée des événementsde tempête est proposée (cas 5). Puis les simulations couplent des augmentations d’intensité du niveau de lamer et/ou de la force des tempêtes avec leur durée (cas 6 et 7). Enfin, le dernier cas de simulation (cas 8)considère une augmentation générale de l’intensité et de la durée des forçages.Les augmentations futures des tempêtes n’étant pas encore définies par les météorologues et lesclimatologues, nous avons arbitrairement augmentés de + 5, + 10 et + 20 % les forçages mesurés lors de latempête extrême de 1997. Les simulations (cas 2 à 8) sont comparées à la situation actuelle (cas 1), sansproposer de date future du fait de l’incertitude de l’ampleur du CC sur la force de la houle, l’élévation duplan d’eau et la durée des tempêtes. Au total, nous avons donc réalisés 22 simulations. A notre connaissance,il n’existe pas (encore) de travaux qui précisent dans quelles proportions l’intensité des tempêtes (houle etsurcôte) pourrait augmenter dans le Golfe du Lion. Néanmoins, les augmentations de 5 à 20 % que nousavons choisies sont probablement réalistes car la majorité des indicateurs d’un éventuel CC en milieu littoral(Pirazzoli, 1999 ; Allan et Komar, 2006 ; Lionello et al., 2006 ; Ullman et al., 2007 ; Ullman et Pirazzoli, inpress) ne montrent très rarement des changements pluri décennaux supérieurs à des variations de 20%. Parexemple, dans un environnement comparable à celui investigué dans cet article, le delta de l’Ebre, Sanchze-Arcilla et al., (1996) ont considéré des variations de l’intensité et de l’orientation des tempêtes comparables ànos simulations (+10% par rapport au climat de houle définis dans les années 90).Afin d’évaluer l’augmentation de l’érosion dunaire causée par un éventuel CC, nous avons d’abord simulél’érosion de la dune en fonction des caractéristiques de la tempête de 1997 (cas 1) afin de servir de référenceaux autres simulations. Les résultats de l’érosion des cas 2 à 8 sont comparés à ceux du cas 1 en terme de :morphologie, altitude et recul de la crête de la dune, et de volumes d’érosion. Les volumes sont exprimés enpourcentages d’érosion et non pas en valeurs absolues car les résultats du modèle ne représentent par desvaleurs généralisables pour l’ensemble du littoral de Camargue puisque nous nous plaçons dans un cas idéal.En effet, l’érosion des dunes dépend des tempêtes dont les caractéristiques de houles varient spatialement enfonction de la propagation de celle-ci mais aussi en fonction de la morphologie de la plage elle-même et plusparticulièrement de la morphologie anté-tempête de la dune. Dans ce premier travail de modélisation del’érosion dunaire sous l’effet du CC, nous avons choisi un cas idéal et il convient donc de garder à l’espritque nos simulations ne proposent que des ordres de grandeur. Par conséquent, lorsque nous exprimons uneérosion de dune qui augmente de 200 % par exemple, cela signifie que les valeurs d’érosion obtenues pourune simulation, sont doublées par rapport à celles obtenues pour la simulation réalisée avec le cas 1 (tempêtede 1997 de référence).II.3Le profil de dune utiliséLe profil de plage utilisé pour la modélisation comprend une dune qui culmine à 5 m NGF, une plageétroite large de 20 m et une morphologie sous marine à doubles barres (figure 2). Cette morphologie estcaractéristique des secteurs en érosion des plages de Camargue (Suanez, 1997 ; Sabatier, 2001), plusparticulièrement pour le secteur à l’Est des Saintes-Maries-de-la-Mer, où Sbeach a été calibré (Morellato,2004).III RÉSULTATS ET DISCUSSIONIII.1Description morphologique des sorties du modèleConformément à ce qui est observé en nature, le modèle reproduit correctement le recul de la crête de ladune ainsi que son abaissement sous l’effet des tempêtes qui sapent la dune à sa base (figure 3). Lesdifférences entre les cas de simulation ne sont significativement visibles que pour les cas 4 et 8 lorsque larecrudescence des tempêtes est simulée à + 20 %. Nous verrons que ces deux cas correspondent logiquementaux taux d’érosion les plus importants. Pour l’ensemble des cas, la crête recule de 1 mètre et son altitudes’abaisse entre 0.05 et 0.40 mètre sauf pour les cas 4 et 8 (hypothèse d’une recrudescence des tempêtes de 20%) où la crête recule respectivement de 2 et 3 mètres avec un abaissement de 0.49 et 0.71 mètre. Le modèlereproduit donc bien de manière fiable la morphologie de l’érosion de la dune soumise à des tempêtes.
III.2Rôles respectifs des forçages sur l’érosion de la duneLes simulations des différents scénarii de recrudescence des tempêtes (cas 2 à 8) indiquent, dans chaquecas de figure, une augmentation de l’érosion de la dune par rapport à la tempête de référence de 1997 (cas 1).Une hiérarchisation des scenarii, et donc du rôle des forçages, peut être proposée. En terme d’intensité desdeux forçages investigués par le modèle, la houle (cas 2) joue un rôle plus important que celui de la hauteurdu plan d’eau (cas 3) sur l’érosion de la dune (Figure. 4). Si on compare une augmentation de l’intensité (cas4) à une augmentation de la durée (cas 5) des tempêtes, le modèle montre le rôle dominant de l’intensité surla durée de l’événement. Par conséquent, la hiérarchisation décroissante de l’augmentation de l’érosion, liéeà un éventuel CC et simulée par les différents scénarii que nous avons retenus, est la suivante : cas 8, 4, 6, 7-2, 3 et 5 (Figure 4) (les résultats particuliers du cas 7, sont décrits ci après). Cette augmentation estlogiquement la plus forte dans l’hypothèse d’une recrudescence simultanée de l’intensité et de la force de lahoule et de la marégraphie (cas 8). L’amplification de l’érosion est par contre la plus faible dans le cas oùseule la durée de la tempête augmenterait (cas 5).Nos résultats sont donc contradictoires à ceux de Vellinga (1982), Steetzel (1991) et Zhang et al., (2001)qui insistent sur le rôle de la hauteur du plan d’eau par rapport à celui de l’énergie de la houle pour l’érosionde la dune. Les travaux de ces auteurs ont toutefois été réalisés pour des plages méso-tidales et les casextrêmes investigués coïncident avec des coefficients de marée élevées. La spécificité microtidale des plagesméditerranéenne apparaît vraisemblablement à travers nos résultats. Pour que la hauteur du plan d’eau joueun rôle plus important, il faudrait qu’elle atteigne une cote plus élevée ou que l’énergie de la houle soitmoins forte.III.3Relations entre l’augmentation des forçages et l’érosion de la duneLes augmentations de 5, 10 et 20% des caractéristiques des tempêtes se traduisent dans tous les cas par uneaugmentation de l’érosion de la dune. Il n’y a pas de relations équivalentes entre la recrudescence destempêtes et l’augmentation de l’érosion qu’elles produiraient. Par exemple dans l’hypothèse d’uneaugmentation de 5, 10 et 20% de l’intensité et de la durée des forçages (cas 8) l’érosion de la dune seraitamplifiée respectivement d’environ 130, 150 et 200 %. Dans l’hypothèse d’une seule augmentation de laforce de la houle (cas 2), l’érosion serait augmentée d’environ 110, 125 et 140 %. Une faible recrudescencedes tempêtes, se traduira donc par des conséquences morphologiques proportionnellement beaucoup plusimportantes que l’augmentation des forçages.III.4Effets rétroactifs entre les forçages et la duneLorsque l’on augmente de 5, 10 et 20 % les caractéristiques des tempêtes, l’allure des courbes obtenuesdiffère entre les cas (Figure 4). En effet, les courbes obtenues pour les cas 4 ,5, 6, et 8 montrent une érosion(très) légèrement exponentielle tandis que celles des cas 2, 3 et plus particulièrement 7 indiquent au contraireune érosion légèrement logarithmique lorsque l’intensité ou la durée des forçages augmente. Ces résultatssuggèrent des relations non linéaires entre le rôle de la houle, de la marégraphie, de leur intensité et de leurdurée sur l’érosion de la dune. On peut aussi considérer que l’aspect logarithmique de l’érosion témoigned’une adaptation du profil de la dune aux forçages. En effet, si l’augmentation des valeurs d’érosion sontlogarithmiques, cela signifie que malgré une augmentation des forçages, l’érosion de la dune ne se fait plus àson maximum car elle commence à trouver un nouveau profil d’équilibre. Cependant, cette situation n’estraisonnablement envisageable que pour le cas 7 (Figure 4) car les autres cas montrent des allures de courbestrès faiblement exponentielles ou logarithmiques.III.5Relations entre les forçagesLes relations non linéaires entre le rôle de la houle, de la marégraphie, de leur intensité et de leur durée surl’érosion de la dune sont représentées par la figure 5. A travers cette figure, nous avons cherché à définir siles effets des forçages se superposent linéairement ou si des interactions, liées à des effets rétroactifs entreles forçages, le transport sédimentaire et la morphologie sont reproduites par le modèle. Par exemple, le cas 4qui correspond à une augmentation de l’intensité de la houle et du niveau de la mer est comparé à la sommedes impacts du cas 2 (augmentation de la houle seule) et du cas 3 (augmentation de l’intensité du niveaumarin seul). Conformément à la modélisation conceptuelle de la morphodynamique des plages (Stive et DeVriend, 1995) et des dunes (Sherman, 1995), nous montrons que les relations entre les forçages ne setraduisent pas linéairement sur la morphologie (la dune dans cet article). Ce résultat suggère aussi que
- Page 1 and 2: Session 3Risques littoraux majeursP
- Page 4 and 5: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 6 and 7: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 8 and 9: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 10 and 11: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 12 and 13: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 14 and 15: VI e Journées Scientifiques et Tec
- Page 16 and 17: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 18 and 19: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 20 and 21: Hauteurs >ZH (cm)Saint-Jean-de-Luz2
- Page 22 and 23: Fréquence(%)3530252015Directions d
- Page 24 and 25: Fig. 4Station1. Saint-Jean-de-Luz2.
- Page 26 and 27: confrontés aux tendances passées
- Page 28 and 29: La majeure partie des indicateurs d
- Page 30 and 31: 1804 -4.8354 48.715 Au large de l
- Page 32 and 33: RUFINO DOS SANTOS T., PINOT J.-P.,
- Page 34 and 35: GoueltocGoulvenLe CurnicIle TariecR
- Page 36 and 37: 3203103002902802702602502401775 180
- Page 38 and 39: 7060504030201001775 1800 1825 1850
- Page 40 and 41: 315310305300Pt 1818295290285Pt 1804
- Page 42 and 43: MODELISATION DE L’IMPACT DU CHANG
- Page 46 and 47: l’enchaînement temporel des for
- Page 48 and 49: Morellato, D., Sabatier, F., Pon,s
- Page 50 and 51: CasHoule- intensité -Houle- durée
- Page 52 and 53: altitude m NGF (IGN 69)6543210-1-2-
- Page 54 and 55: 200augmentation de l'érosion (%180
- Page 56 and 57: Journées Scientifiques et Techniqu
- Page 58 and 59: Journées Scientifiques et Techniqu
- Page 60 and 61: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 62 and 63: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 64 and 65: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 66 and 67: Colloque SHF "Valeurs rares et extr
- Page 68 and 69: Laboratory experiments have been pe
- Page 70 and 71: development of a vortex at the bloc
- Page 72 and 73: moving slide among these three case
- Page 74 and 75: [3] Walder, J.S., P. Watts, O.E. So
- Page 76 and 77: Session 3 : Risques Littoraux Majeu
- Page 78 and 79: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 80 and 81: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 82 and 83: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 84 and 85: 6 ème journées scientifiques et t
- Page 86: ABSTRACTObservations on the Impacts