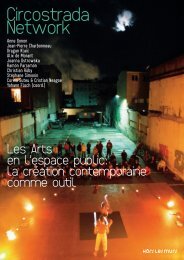Ethnographie du spectateur - in vivo - Free
Ethnographie du spectateur - in vivo - Free
Ethnographie du spectateur - in vivo - Free
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
démocratisation culturelle, la « question <strong>du</strong> public » va progressivement pénétrer dans l’espritet le langage des tenants de l’action culturelle pour devenir aujourd’hui le leitmotiv desservices de relations publiques et autres médiateurs. Le <strong>spectateur</strong> n’est pas uniquement celuiqui fait l’expérience de rencontrer une œuvre (qu’elle soit théâtrale, c<strong>in</strong>ématographique,chorégraphique, etc.), il est aussi une problématique (voire un problème) et l’objet de toutesles attentions. Si le recours au terme <strong>spectateur</strong> lui-même reste relativement récent 11 , il estdésormais entré dans le vocabulaire courant des champs artistique et culturel. Entre école <strong>du</strong><strong>spectateur</strong>, abonnements, chargée (la profession est particulièrement fém<strong>in</strong><strong>in</strong>e) des publicsscolaires ou universitaires, le <strong>spectateur</strong> est avant tout envisagé comme un <strong>in</strong>divi<strong>du</strong> à capter,conquérir et fidéliser. La présente recherche délaisse délibérément cet aspect de laproblématique pour se focaliser sur le temps de la confrontation entre le <strong>spectateur</strong> et l’œuvre,faisant l’hypothèse qu’une partie des réponses à la « question <strong>du</strong> public » se niche dans cet<strong>in</strong>stant précis.Le théâtre de rue, dont l’émergence artistique en France date des années 70 et la constructionen tant que champ culturel des années 80, est lui aussi en perpétuelle quête de son Nordmagnétique. Au cœur <strong>du</strong> discours, de l’écriture et de la scénographie, le <strong>spectateur</strong> estomniprésent. Les partis pris esthétiques fondateurs <strong>du</strong> genre trouvent pour la plupart leurorig<strong>in</strong>e dans un <strong>in</strong>tense désir de rencontrer l’autre. Il en résulte un rejet des règles édictées parle théâtre de salle considéré comme l’antre de l’exclusion d’une trop grande part de lapopulation. En s’aventurant sur des chem<strong>in</strong>s buissonniers, le théâtre de rue s’<strong>in</strong>scrit pourtantaussi dans une cont<strong>in</strong>uité historique qu’il ignore bien souvent. « Depuis l’aube <strong>du</strong> XIX èmesiècle, toutes les révolutions artistiques se sont laissées guider par l’euphorie d’une liberté àconquérir contre des règles devenues <strong>in</strong>supportables et par conséquent contre la traditionporteuse desdites règles. (…) Mais on sait désormais que la table rase est une dangereuseillusion. Où commence vraiment l’<strong>in</strong>novation ? Qu’est-ce qui la rend nécessaire ? Quellessont ses rac<strong>in</strong>es, au-delà de cette ambition commune d’un commencement radical, voire11 « Les premières études spécifiquement consacrées aux occupants de la salle de théâtre n’ont (…) qu’unec<strong>in</strong>quanta<strong>in</strong>e d’années » souligne Marie-Madele<strong>in</strong>e Mervant-Roux. Elles « ont d’abord envisagé ceux-ciensemble, comme un groupe d’une nature orig<strong>in</strong>ale : l’article de Léon Chancerel écrit en 1944 s’<strong>in</strong>titulait « DuPublic » ; Jean Vilar rédigea en 1946 sa « Déf<strong>in</strong>ition <strong>du</strong> public » ; Jean Doat, l’année suivante, (…) <strong>in</strong>venta pouranalyser ce groupe une psychologie nouvelle qui n’était plus « de masse » [La Psychologie collective et lethéâtre, Paris, Editions de Flore, 1947]. Une histoire et une sociologie spécifiques se sont ensuite développées :Le Public de théâtre et son histoire de Maurice Descotes est publié en 1964 ; « Le public <strong>du</strong> Festival d’Avignon1967 », de Jan<strong>in</strong>e Larrue, en 1968. La notion de <strong>spectateur</strong> n’apparaît encore qu’exceptionnellement dans lesannées c<strong>in</strong>quante (l’article de David Victoroff, « Le paradoxe <strong>du</strong> <strong>spectateur</strong> », est de 1955). Elle s’affirme deuxdécennies plus tard ; plusieurs champs discipl<strong>in</strong>aires sont alors concernés : la psychanalyse (le livre d’OctaveMannoni, Clefs pour l’Imag<strong>in</strong>aire ou l’Autre Scène, est de 1969), la sémiologie (L’Ecole <strong>du</strong> <strong>spectateur</strong> d’AnneUbersfeld paraît en 1981) et l’esthétique de la réception (illustrée en France par Patrice Pavis). » idem, p.5810