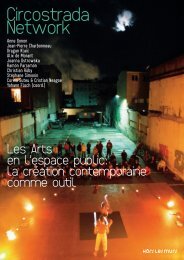- Page 1: UNIVERSITE DE BOURGOGNEUFR Langues
- Page 4 and 5: AVERTISSEMENTAfin de permettre une
- Page 7 and 8: Introduction« Le public est capabl
- Page 9 and 10: La communication peut être envisag
- Page 11 and 12: virginal ? » 12 La place et la fon
- Page 13 and 14: focalisant sur l’objet lui-même
- Page 15: Première partieReprésentation, ac
- Page 18 and 19: l’espace de représentation - cel
- Page 20 and 21: Toute frontière, cependant, appell
- Page 22 and 23: de rue comme une « critique radica
- Page 24 and 25: nécessairement un bâtiment. Pour
- Page 26 and 27: « elles remettent en cause la plac
- Page 28 and 29: monde. » 77 La primauté du visuel
- Page 32 and 33: indécidable, et fascinante parce q
- Page 34 and 35: Bertolt Brecht propose ainsi aux ac
- Page 36 and 37: personnalité est définie et garan
- Page 38 and 39: 2.2.2. Niveaux de jeu en rueAu trav
- Page 40 and 41: Si les dangers auxquels est exposé
- Page 42 and 43: apidement et presque par instinct
- Page 45 and 46: Chapitre 2 - Les espaces imbriqués
- Page 47 and 48: 1.2. La ville : un espace multifonc
- Page 49 and 50: lettres de légitimité en s’insc
- Page 51 and 52: « L’animation culturelle n’ét
- Page 53 and 54: d’une autre expérience de la vie
- Page 55 and 56: 3.3. Une pratique extraordinaire de
- Page 57 and 58: démontable, transportable. Elle a
- Page 59 and 60: la surprise qu’il provoque, l’i
- Page 61 and 62: spectacle, dans l’écriture même
- Page 63 and 64: production » 225 . Le sociologue d
- Page 65: peuvent aboutir à la légitimation
- Page 68 and 69: tierce entité, en soi, qui dévelo
- Page 70 and 71: « Cette situation du spectateur (
- Page 72 and 73: « Ce que recouvre cette formulatio
- Page 74 and 75: ville dont la composition socioprof
- Page 76 and 77: - Au MAR comme au FAR, les motivati
- Page 78 and 79: Cette enquête, résumée ici de ma
- Page 80 and 81:
3.3. Le spectateur potentielC’est
- Page 82 and 83:
nombreuses. Conciliabules quant à
- Page 84 and 85:
attendus. La rencontre est double,
- Page 86 and 87:
Le fait de s’exercer dans l’esp
- Page 88 and 89:
populations-publics a ainsi l’ava
- Page 90 and 91:
3.2. Vers une sortie du carcan fest
- Page 92 and 93:
valoriser l’évidente capacité d
- Page 94 and 95:
« Dans la dynamique de la décentr
- Page 96 and 97:
1.2. La nécessaire définition de
- Page 98 and 99:
lui semble délicat d’en établir
- Page 100 and 101:
1.1. Paramètre 1a - Le festivalLe
- Page 102 and 103:
2.3. Paramètre 2c - La résidenceL
- Page 104 and 105:
Le cercle entourant ou englobant Da
- Page 106 and 107:
La fiction perméable La fiction pr
- Page 108 and 109:
FACTEURS CONDITIONNANT LA RÉCEPTIO
- Page 110 and 111:
CARMEN - OPERA DE RUE, COMPAGNIE OF
- Page 112 and 113:
LES CHAMBRES D’AMOUR, THEATRE DE
- Page 114 and 115:
LE SENS DE LA VISITE, 26000 COUVERT
- Page 116 and 117:
ITINERAIRE SANS FOND(S), KUMULUS 37
- Page 118 and 119:
LES HABITANTS DU LUNDI, ILOTOPIE (2
- Page 120 and 121:
SQUARE TELEVISION LOCALE DE RUE, K
- Page 122 and 123:
122
- Page 124 and 125:
124
- Page 126 and 127:
I. Sciences de l’information et d
- Page 128 and 129:
1.2. L’interactionnisme symboliqu
- Page 130 and 131:
comportements des spectateurs qui l
- Page 132 and 133:
La distance personnelleC’est la z
- Page 134 and 135:
silences, les tensions et les rires
- Page 136 and 137:
L’analyse d’Hans Robert Jauss s
- Page 138 and 139:
un parcours idéal, linéairement
- Page 140 and 141:
Florence Belaën s’est penchée s
- Page 142 and 143:
Nathalie Heinich s’est trouvée c
- Page 144 and 145:
ien appréhendées comme autant de
- Page 146 and 147:
1.2. L’élaboration d’une grill
- Page 148 and 149:
2. L’apport des études théâtra
- Page 150 and 151:
Schéma 1. Une méthodologie fondé
- Page 152 and 153:
3. Trois spectacles pour prismes3.1
- Page 154 and 155:
Les critères retenus excluent de f
- Page 156 and 157:
INTERMÈDEPour en finir avec le spe
- Page 158 and 159:
I. Analyse du spectacle1. Contextua
- Page 160 and 161:
spectacle dans ce contexte. Le spec
- Page 162 and 163:
du spectacle est double : il s’ag
- Page 164 and 165:
phase 2 du récit Le Réveil 476 ).
- Page 166 and 167:
4.2.2. Une fiction du partageLa rel
- Page 168 and 169:
5.1.2. La mise en condition du spec
- Page 170 and 171:
Entrant dans un état de disponibil
- Page 172 and 173:
spectatrice qui remarque qu’elle
- Page 174 and 175:
dans un espace confiné, entraîne
- Page 176 and 177:
1.3.2. Le spectacle vécu comme une
- Page 178 and 179:
corporelle tout en ayant parfaiteme
- Page 180 and 181:
un jugement négatif rejette le dis
- Page 182 and 183:
I. Analyse du spectacle1. Contextua
- Page 184 and 185:
1.3. Contexte des observations de t
- Page 186 and 187:
La récurrence du pronom « vous »
- Page 188 and 189:
vue formulé par Denis Guénoun 525
- Page 190 and 191:
à avancer par des interpellations
- Page 192 and 193:
en négatif. Sans sonorisation ni s
- Page 194 and 195:
4.2. Facteurs déterminants4.2.1. L
- Page 196 and 197:
public qui le « nourrit » et il
- Page 198 and 199:
endus volontairement à Rendez-vous
- Page 200 and 201:
La référence à la performance de
- Page 202 and 203:
« à faire comme si ». Cette atti
- Page 204 and 205:
Synthèse - Le choix entre posture
- Page 206 and 207:
I. Analyse du spectacle1. Contextua
- Page 208 and 209:
1.3. Contexte des observations de t
- Page 210 and 211:
ont conduit à la production de tex
- Page 212 and 213:
« HVR : Elle te plaît ?Viens, app
- Page 214 and 215:
3.1. La relation au lieu : les enje
- Page 216 and 217:
scénographiques et symboliques. Qu
- Page 218 and 219:
4.1.2. La zone proche : l’éphém
- Page 220 and 221:
comprenant ni où est le spectacle
- Page 222 and 223:
principe de la vision parcellaire d
- Page 224 and 225:
1. L’impact du dispositif sur la
- Page 226 and 227:
leur regard. C’est l’analyse du
- Page 228 and 229:
spectateurs en losange est dès lor
- Page 230 and 231:
1.3.2. Un contact particulier avec
- Page 232 and 233:
d’ailleurs au cœur d’un parado
- Page 234 and 235:
à s’extraire du jeu basique des
- Page 236 and 237:
236
- Page 238 and 239:
tous les spectateurs ne se saisisse
- Page 240 and 241:
entretenue par les défenseurs des
- Page 242 and 243:
témoignent de ce plaisir à sentir
- Page 244 and 245:
d’observation de la relation éta
- Page 246 and 247:
2.2.3. La « liberté proxémique
- Page 248 and 249:
1.1.2. Un vis-à-visQu’en est-il
- Page 250 and 251:
Ce regard est associé à une expos
- Page 252 and 253:
donner. C’est de sentir qu’il y
- Page 254 and 255:
attendre quelque chose de précis e
- Page 256 and 257:
1.3. Quand acteur et spectateur fon
- Page 258 and 259:
2.1. Le théâtre, un temps de part
- Page 260 and 261:
(…) L’inconnu lui-même est vé
- Page 262 and 263:
types d’attitudes, de cerner des
- Page 264 and 265:
elle permet d’aller vers autre ch
- Page 266 and 267:
2.2. Logique réceptionnelle : une
- Page 268 and 269:
3. Le Léonce3.1. Profil : un spect
- Page 270 and 271:
d’une émotion collective » 726
- Page 272 and 273:
Le principe d’identification a co
- Page 274 and 275:
intervention d’un récitant, chan
- Page 276 and 277:
3. Les processus de perturbation de
- Page 278 and 279:
Les pistes contestataires lancées
- Page 280 and 281:
apports réels de ce spectacle avec
- Page 282 and 283:
salle dans l’obscurité. Ces évo
- Page 284 and 285:
les vertus appréciées du degré z
- Page 286 and 287:
La dualité conflictuelle entre un
- Page 288 and 289:
mouvement en suivant une parade sou
- Page 290 and 291:
2.2. Le « spect’acteur » entre
- Page 292 and 293:
processus de création que sont les
- Page 294 and 295:
nombre des projets d’art urbain o
- Page 296 and 297:
même. Dans le cas de Kumulus, elle
- Page 298 and 299:
scéniques s’accumule et s’agen
- Page 300 and 301:
1.1. De la trace à la mémoire des
- Page 302 and 303:
se stratifie et alimente une mémoi
- Page 304 and 305:
esthétique potentiellement puissan
- Page 306 and 307:
construction collective d’identit
- Page 308 and 309:
venus pour en faire un public à la
- Page 310 and 311:
2.2. Carrières et mise en mémoire
- Page 312 and 313:
qu’ils s’en souviendront toute
- Page 314 and 315:
ase. « L’implantation est le fai
- Page 316 and 317:
1.2. Romain Rolland, Copeau, Vilar
- Page 318 and 319:
l’espoir de permettre cette large
- Page 320 and 321:
conditions de vie (parfois plus sub
- Page 322 and 323:
elles. Pour autant, l’œuvre gén
- Page 324 and 325:
2.2. Le théâtre de rue à l’heu
- Page 326 and 327:
Ainsi la dimension populaire du th
- Page 328 and 329:
dissensions les plus profondes sont
- Page 330 and 331:
330
- Page 332 and 333:
Le théâtre de rue : la représent
- Page 334 and 335:
prise de parole, flirte d’après
- Page 336 and 337:
l’aise ou n’appréciant pas la
- Page 338 and 339:
sur le cours du jeu devient d’aut
- Page 340 and 341:
d’un illustoire âge d’or » ma
- Page 342 and 343:
342
- Page 344 and 345:
I - ETUDES THÉÂTRALES1. Spectateu
- Page 346 and 347:
PRADIER, Jean-Marie. « Le public e
- Page 348 and 349:
ABIRACHED, Robert. La décentralisa
- Page 350 and 351:
KNAPP, Alain. « Acteur interprète
- Page 352 and 353:
BOURDIEU, Pierre. Les héritiers :
- Page 354 and 355:
DJAKOUANE, Aurélien. Genèse et ca
- Page 356 and 357:
LATOUR, Bruno. « Comment finir une
- Page 358 and 359:
SAUVAGEOT, Pierre. « J’ai beauco
- Page 360 and 361:
Du Théâtre. 1996, n°14. Dossier
- Page 362 and 363:
LE FOURNEAU. Enquête sur le public
- Page 364 and 365:
STIEGLER, Bernard. BAILLY, Jean-Chr
- Page 366 and 367:
Chapitre 2 - Les espaces imbriqués
- Page 368 and 369:
Tableau 4. Grille de décryptage ap
- Page 370 and 371:
Chapitre 6b - Trois spectacles pour
- Page 372 and 373:
1.3.2. Un contact particulier avec
- Page 374 and 375:
Chapitre 9 - Effets et prospective
- Page 376:
CréditsDessins de M. λ : Coline D