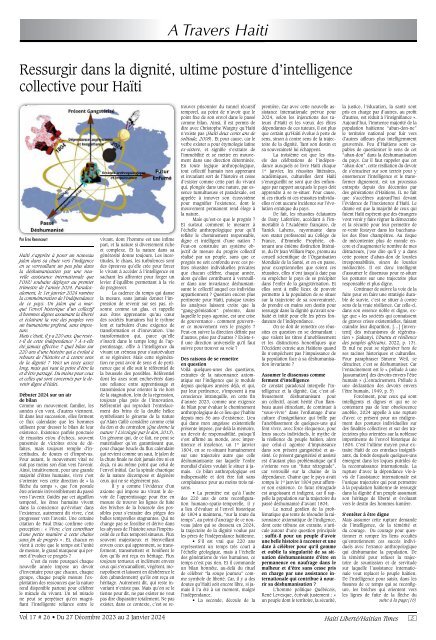Haiti Liberte 27 Decembre 2023
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A Travers <strong>Haiti</strong><br />
Ressurgir dans la dignité, ultime posture d’intelligence<br />
collective pour Haïti<br />
Par Erno Renoncourt<br />
Haïti s’apprête à poser un nouveau<br />
jalon dans sa chute vers l’indigence<br />
en se verrouillant un peu plus dans<br />
la déshumanisation par une nouvelle<br />
assistance internationale que<br />
l’ONU souhaite déployer au premier<br />
trimestre de l’année 2024. Paradoxalement,<br />
le 1er janvier 2024 ramène<br />
la commémoration de l’indépendance<br />
de ce pays. Un jalon qui a marqué<br />
l’envol historique d’un collectif<br />
d’hommes dignes assumant la liberté<br />
et éclairant la voie des peuples vers<br />
un humanisme profond, sans imposture.<br />
Mais c’était, il y a 220 ans. Que restet-il<br />
de cette indépendance ? A-t-elle<br />
été jamais effective ? Quel bilan sur<br />
220 ans d’une histoire qui a évolué à<br />
rebours de l’histoire et à contre sens<br />
de la dignité ? Voici un texte assez<br />
long, mais qui vaut la peine d’être lu<br />
et d’être partagé. Du moins pour ceux<br />
et celles qui sont concernés par le devenir<br />
digne d’Haïti.<br />
Débuter 2024 sur un air<br />
de bilan<br />
Comme un mouvement familier, les<br />
années s’en vont, d’autres viennent.<br />
Et dans leur succession, elles forment<br />
ce flux calendaire que les hommes<br />
utilisent pour dresser le bilan de leur<br />
existence. Existence parfois ponctuée<br />
de réussites et/ou d’échecs, souvent<br />
parsemée de victoires et/ou de défaites,<br />
mais toujours remplie d’incertitudes,<br />
de doutes et d’imprévus.<br />
Pour autant, le mouvement vital ne<br />
suit pas moins son élan vers l’avenir.<br />
Ainsi, intuitivement, pour une grande<br />
majorité d’êtres humains, vivre c’est<br />
s’orienter vers cette direction de « la<br />
flèche du temps », que l’on postule<br />
être orientée irréversiblement du passé<br />
vers l’avenir. Guidés par cet aiguillon<br />
temporel, les êtres humains vivent<br />
dans la conscience qu’évoluer dans<br />
l’existence, autrement dit vivre, c’est<br />
progresser vers l’avenir. Une certaine<br />
citation de Paul Dirac confirme cette<br />
perception : « Vivre, c’est contribuer<br />
d’une petite manière à cette chaine<br />
sans fin de progrès ». Et, chacun en<br />
vient à croire que le temps est l’unité<br />
de mesure, le grand marqueur qui permet<br />
d’évaluer ce progrès ?<br />
C’est du reste pourquoi chaque<br />
nouvelle année impose un devoir<br />
d’inventaire pour que chacun, chaque<br />
groupe, chaque peuple mesure l’exploitation<br />
des ressources que la nature<br />
rend disponible partout pour célébrer<br />
le miracle du vivant. Un tel miracle<br />
ne peut se perpétuer qu’en magnifiant<br />
l’intelligente reliance entre le<br />
vivant, dont l’homme est une infime<br />
part, et la nature si diversement riche<br />
et complexe. Et la nature dans sa<br />
générosité donne toujours. Les incertitudes,<br />
le chaos, les turbulences sont<br />
des épreuves qu’elle crée pour forcer<br />
le vivant à accéder à l’intelligence en<br />
sachant les affronter pour forger un<br />
levier d’équilibre permettant à la vie<br />
de progresser.<br />
La cadence du temps qui danse<br />
la mesure, sans jamais donner l’impression<br />
de revenir sur ses pas, résonne<br />
comme un glas, et rappelle<br />
aux êtres apprenants qu’au cœur<br />
des sociétés humaines bat le rythme<br />
lent et turbulent d’une exigence de<br />
transformation et d’innovation. Une<br />
transformation qui, parce qu’elle<br />
s’inscrit dans le temps long de l’apprentissage,<br />
offre à l’intelligence du<br />
vivant un créneau pour s’autoévaluer<br />
et se régénérer. Mais cette régénération<br />
ne peut avoir de sens et de pertinence<br />
que si elle suit le référentiel de<br />
la boussole des possibles. Référentiel<br />
dont les axes sont enchevêtrés dans<br />
une reliance entre apprentissage et<br />
transmission pour orienter la vie hors<br />
de la stagnation, loin de la régression,<br />
toujours plus près de l’innovation.<br />
Référentiel qui reproduit l’entrelacement<br />
des brins de la double hélice<br />
symbolisant le génome de la nature<br />
qu’Alain Caillé considère comme celui<br />
du don et du contredon (Que donne la<br />
nature ? L’écologie par le don, 2013).<br />
Un génome qui, de ce fait, ne peut se<br />
matérialiser qu’en garantissant que,<br />
pour chaque boucle du flux calendaire<br />
qui revient comme un saut, le jalon de<br />
la chute finale ne doit jamais être ni en<br />
deçà, ni au même point que celui de<br />
l’envol initial. Car la spirale chaotique<br />
de la nature décompose et dégénère<br />
ceux qui ne se régénèrent pas.<br />
Il y a comme l’évidence d’un<br />
axiome qui impose au vivant le devoir<br />
de l’apprentissage pour être en<br />
mesure de trouver les lignes de fuite<br />
des brèches de la boussole des possibles<br />
pour s’extraire des pièges des<br />
bulles temporelles stagnantes. Qui ne<br />
change pas se fossilise et dérive dans<br />
les abysses de l’histoire sous l’impétuosité<br />
de ce flux temporel sinueux. Flux<br />
souvent majestueux et bienveillant<br />
envers ceux qui apprennent, se transforment,<br />
transmettent et bonifient le<br />
don qu’ils ont reçu en héritage. Flux<br />
toujours tortueux et inclément envers<br />
ceux qui s’encanaillent, végètent, monopolisent<br />
et laissent en déshérence le<br />
don (abandonnent) qu’ils ont reçu en<br />
héritage. Autrement dit, qui reste invariant<br />
n’existe pas. Mais qu’on se le<br />
tienne pour dit, ne pas exister ne veut<br />
pas dire disparaitre totalement. Ne pas<br />
exister, dans ce contexte, c’est se retrouver<br />
prisonnier du tunnel récursif<br />
temporel, au point de n’avoir que le<br />
point fixe de son envol dans le passé<br />
comme bilan. Ainsi, il est permis de<br />
dire avec Christophe Wargny qu’Haïti<br />
n’existe pas (Haïti deux cents ans de<br />
solitude, 2008). Et pour cause, car le<br />
verbe exister a pour étymologie latine<br />
ex-sistere, et signifie s’extraire de<br />
l’immobilité et se mettre en mouvement<br />
dans une direction déterminée.<br />
En toute logique anthropologique,<br />
tout collectif humain non apprenant<br />
et invariant sort de l’histoire et cesse<br />
d’exister comme cette part du vivant<br />
qui, plongée dans une nature, par essence<br />
tumultueuse et paradoxale, est<br />
appelée à innover son écosystème<br />
pour magnifier l’existence, dont le<br />
mouvement permanent rend éloge à<br />
la nature.<br />
Mais qu’est-ce que le progrès ?<br />
Et surtout comment le mesurer à<br />
l’échelle anthropologique pour qu’il<br />
reflète le cheminement responsable,<br />
digne et intelligent d’une nation ?<br />
Peut-on construire un système objectif<br />
de mesure du progrès collectif<br />
réalisé par un peuple, sans que ce<br />
progrès ne soit confondu avec ces petites<br />
réussites individuelles précaires<br />
que chacun célèbre, chaque année,<br />
alors qu’elles contribuent à verrouiller<br />
dans une invariance déshumanisante<br />
le collectif auquel ces individus<br />
appartiennent ? Question encore plus<br />
pertinente pour Haïti, puisque toutes<br />
les analyses laissent croire que la<br />
‘‘gang-grénisation’’ présente, dans<br />
laquelle le pays agonise, est une crise<br />
de gouvernance : comment gouverner<br />
ce mouvement vers le progrès ?<br />
Peut-on suivre la direction définie par<br />
d’autres, prise par d’autres ? Existe-til<br />
une direction universelle qu’il faut<br />
suivre pour trouver sa voie ?<br />
Des raisons de se remettre<br />
en question<br />
Voilà quelques-unes des questions,<br />
extraites de la raisonnance axiomatique<br />
sur l’indigence que je module<br />
depuis quelques années déjà, et qui,<br />
par leur pertinence, s’imposent à ma<br />
conscience intranquille, en cette fin<br />
d’année <strong>2023</strong>, comme une exigence<br />
de bilan pour évaluer le cheminement<br />
anthropologique de ce lieu que j’habite<br />
depuis mes 56 ans d’existence. Lieu<br />
qui dans mon angoisse existentielle<br />
présente impose, par-delà la mémoire,<br />
un devoir de responsabilité, puisqu’il<br />
s’est affirmé au monde, avec impertinence<br />
et insolence, un 1 er janvier<br />
1804, en se re-situant humainement<br />
sur une trajectoire autre que celle<br />
déshumanisante sur laquelle l’ordre<br />
mondial d’alors voulait le situer à jamais.<br />
Ce bilan anthropologique est<br />
indispensable et doit être fait sans<br />
complaisance pour au moins trois raisons.<br />
• La première est qu’à l’aube<br />
des 220 ans de cette reconfiguration<br />
humano-spatio-temporelle, il y<br />
a lieu d’évaluer si l’envol historique<br />
de 1804 a maintenu, ‘‘sur la route du<br />
temps’’, au point d’ancrage de ce nouveau<br />
jalon qui se dressera en 2024,<br />
la trajectoire de la dignité voulue par<br />
les pères de l’indépendance haïtienne.<br />
• S’il est vrai que 220 ans<br />
représentent un temps très court à<br />
l’échelle géologique, mais à l’échelle<br />
des générations de vies humaines, ce<br />
temps n’est pas rien. Et il commande<br />
un bilan honnête, au-delà du rituel<br />
de célébrer ‘‘la soupe joumou’’ comme<br />
symbole de liberté. Car, il y a des<br />
doutes qu’Haïti soit encore libre, si jamais<br />
il l’a été à un moment, malgré<br />
l’indépendance.<br />
• La seconde, découle de la<br />
première, Car avec cette nouvelle assistance<br />
internationale prévue pour<br />
2024, selon les injonctions des tuteurs<br />
d’Haïti et les vœux des élites<br />
dépendantes de ces tuteurs, il est plus<br />
que certain qu’Haïti évolue à perte de<br />
sens, sinon à contre sens de la trajectoire<br />
de la dignité. Tant son destin et<br />
sa souveraineté lui échappent.<br />
La troisième est que les rituels<br />
des célébrations de l’indépendance<br />
auxquels se livre Haïti chaque<br />
1 er janvier, les réussites littéraires,<br />
académiques, culturelles dont Haïti<br />
s’enorgueillit ne sont que des enfumages<br />
par rapport auxquels le pays doit<br />
apprendre à se re-situer. Pour cause,<br />
ni ces rituels ni ces réussites individuelles<br />
n’ont aucune incidence sur l’évolution<br />
erratique du pays.<br />
De fait, les réussites éclatantes<br />
de Dany Laferrière, accédant à l’immortalité<br />
à l’Académie française, de<br />
Yanick Lahens, rayonnante dans<br />
son statut professoral au Collège de<br />
France, d’Emmelie Prophète, obtenant<br />
une énième distinction littéraire,<br />
du Dr Jean William Pape, promu au<br />
conseil scientifique de l’Organisation<br />
Mondiale de la Santé, et on en passe,<br />
pour exceptionnelles que soient ces<br />
réussites, elles n’ont jusqu’à date pas<br />
su empêcher le pays de se précipiter<br />
dans l’enfer de la gangstérisation. Et<br />
elles sont à mille lieux de pouvoir<br />
permettre à la population de se situer<br />
sur la trajectoire de sa souveraineté,<br />
de prendre en mains son destin pour<br />
ressurgir dans la dignité qu’avait souhaité<br />
et initié pour elle les pères fondateurs<br />
de l’indépendance.<br />
On se doit de remettre ces réussites<br />
en question en se demandant :<br />
que valent les titres d’anoblissement<br />
et les distinctions honorifiques que<br />
l’Occident octroie aux Haïtiens quand<br />
ils n’empêchent pas l’impuissance de<br />
la population face à sa déshumanisation<br />
invariante ?<br />
Assumer le dissensus comme<br />
ferment d’intelligence<br />
Ce constat paradoxal interpelle l’intelligence<br />
et la dignité. Car, c’est affreusement<br />
déshumanisant pour<br />
un collectif, ayant hérité d’un flambeau<br />
aussi étincelant, de continuer à<br />
‘‘sous-vivre’’ dans l’enfumage d’une<br />
culture d’insignifiance qui brille par<br />
l’anoblissement de quelques-uns qui<br />
font vivre, avec force éloquence, pour<br />
leurs succès individuels, le mythe de<br />
la résilience du peuple haïtien, alors<br />
que celui-ci agonise d’impuissance<br />
dans son présent gangstérisé et assisté.<br />
Ce présent gangstérisé et assisté<br />
est d’autant plus problématique qu’il<br />
s’oriente vers un ‘‘futur rétrograde’’,<br />
car verrouillé sur la chaine de la<br />
dépendance. Chaine que le pays avait<br />
rompu le 1 er janvier 1804 pour affirmer<br />
son existence. Ce futur rétrograde<br />
est angoissant et indigent, car il rappelle<br />
la population sur la trajectoire du<br />
passé déshumanisé d’avant 1804.<br />
Le nœud gordien de la problématique<br />
que tente de résoudre la raisonnance<br />
axiomatique de l’indigence,<br />
dont cette tribune est extraite, s’articule<br />
autour d’une question principale<br />
: suffit-il pour un peuple d’avoir<br />
une belle histoire à raconter et une<br />
date à célébrer pour qu’il gomme<br />
et oublie la singularité de sa situation<br />
déshumanisante d’être en<br />
permanence en naufrage dans le<br />
malheur et d’être sans cesse pris<br />
en charge par une assistance internationale<br />
qui contribue à nourrir<br />
sa déshumanisation ?<br />
L’homme politique Québécois,<br />
René Levesque, écrivait justement : «<br />
un peuple dont le territoire, la sécurité,<br />
la justice, l’éducation, la santé sont<br />
pris en charge par d’autres, au profit<br />
d’autres, est réduit à l’insignifiance ».<br />
Aujourd’hui, l’immense majorité de la<br />
population haïtienne ‘‘aban-don-ne’’<br />
le territoire national pour fuir vers<br />
d’autres ailleurs plus intelligemment<br />
gouvernés. Peu d’Haïtiens sont capables<br />
de questionner le sens de cet<br />
‘‘aban-don’’ dans la déshumanisation<br />
du pays. Car il faut rappeler que cet<br />
‘‘aban-don’’, cette résiliation du devoir<br />
de s’enraciner sur son terroir pour y<br />
ensemencer l’intelligence et le transformer<br />
dignement, est un processus<br />
entrepris depuis des décennies par<br />
des générations d’Haïtiens. IL ne fait<br />
que s’accélères aujourd’hui devant<br />
l’évidence de l’inexistence d’Haïti. Le<br />
drame est que la majorité de ceux qui<br />
fuient Haïti espèrent que des étrangers<br />
vont venir y faire régner la démocratie<br />
et la sécurité pour leur permettre de<br />
re-venir festoyer dans les bacchanales<br />
des fêtes champêtres. Au risque<br />
de mécontenter plus de monde encore<br />
et d’augmenter le nombre de mes<br />
détracteurs, j’ose dire qu’il y a dans<br />
cette posture d’aban-don de lourdes<br />
irresponsabilités, sinon de lourdes<br />
médiocrités. Il est donc intelligent<br />
d’assumer le dissensus pour re-situer<br />
les postures sur une trajectoire plus<br />
responsable et plus digne.<br />
Continuer de suivre la voie de la<br />
fuite pour en faire une stratégie durable<br />
de survie, c’est se situer à contre<br />
sens de la vraie résilience. Car celle-ci,<br />
dans son essence noble et digne, exige<br />
que « les sociétés qui connaissent<br />
de graves crises existentielles, faisant<br />
craindre leur disparition, […] [inventent]<br />
des mécanismes de régénération<br />
» (Sakanyi, Ubuntu et résilience<br />
des peuples africains, 2022, p. 13).<br />
Et nul ne peut se régénérer hors de<br />
ses racines historiques et culturelles.<br />
Pour paraphraser Simone Weil, se<br />
déraciner, c’est se déshumaniser. Car<br />
l’enracinement est le « prélude à une<br />
[assumation] des devoirs envers l’être<br />
humain » (L’enracinement. Prélude à<br />
une déclaration des devoirs envers<br />
l’être humain, 1949, p. 5)<br />
Forcément, pour ceux qui sont<br />
intelligents et dignes et qui ne se<br />
contentent pas de leur obsolescence<br />
anoblie, 2024 appelle à une rupture<br />
d’avec ce présent pour un réalignement<br />
des postures individuelles sur<br />
des finalités collectives et sur des trajectoires<br />
plus orientées sur la noblesse<br />
impertinente de l’envol historique de<br />
1804. C’est l’ultime moyen pour extraire<br />
Haïti de ces entrelacs insignifiants,<br />
du fonds desquels quelques-uns<br />
émergent dans les loques putrides de<br />
la reconnaissance internationale. La<br />
rupture d’avec la dépendance vis-àvis<br />
de l’assistance internationale est<br />
l’unique trajectoire qui peut permettre<br />
à la population haïtienne de ressurgir<br />
dans la dignité d’un peuple assumant<br />
son héritage de liberté et évoluant<br />
vers le destin des hommes-lumière.<br />
S’entêter à être digne<br />
Mais assumer cette rupture demande<br />
de l’intelligence, de la témérité et<br />
du courage. Du courage pour questionner<br />
et rompre les liens occultés<br />
qu’entretiennent ces succès individuels<br />
avec l’errance anthropologique<br />
qui déshumanise la population. De<br />
la témérité pour refuser la trajectoire<br />
de soumission et de servitude<br />
sur laquelle l’assistance internationale<br />
veut replacer le peuple haïtien.<br />
De l’intelligence pour saisir, dans les<br />
fissures de ce temps qui se reconfigure,<br />
les brèches qui orientent vers<br />
les lignes de fuite de la flèche du<br />
suite à la page(16)<br />
Vol 17 # 26 • Du <strong>27</strong> Décembre <strong>2023</strong> au 2 Janvier 2024<br />
<strong>Haiti</strong> Liberté/<strong>Haiti</strong>an Times<br />
5