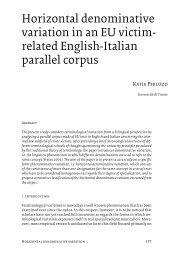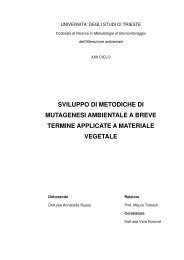SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Préfixes intensifs français et italiens<br />
Le préfixe intensif gréco-latin tel qu’il nous apparaît aujourd’hui est, sans<br />
l’ombre d’un doute, le résultat d’un procès évolutif qui se traduit par le passage<br />
d’un statut de formant non autonome à vocation scientifique et/ou technique à<br />
celui de préfixe devenu productif dans le vocabulaire commun des deux<br />
langues, voire, à celui d’unité autonome. Nous assistons à un processus<br />
d’autonomisation et de mobilité intramorphologique et intrasémantique de<br />
l’élément − cette mobilité détermine aussi, pour certains éléments, le passage<br />
d’une valeur non intensive à une une valeur intensive correspondant<br />
respectivement à un sens propre et à un sens figuré − dans le sens où il devient<br />
<strong>di</strong>sponible et peut fonctionner concurremment avec les éléments communs<br />
(sous-/sotto-, etc.).<br />
C’est ainsi que, dans une optique synchronique, il nous semble pertinent de<br />
réserver l’appellation « savant » uniquement aux préfixes rentrant dans la sphère<br />
scientifique et/ou technique et d’opter, pour les éléments qui vont nous<br />
intéresser, pour une dénomination plus banale mais plus large : préfixes<br />
(intensifs) d’origine gréco-latine. 33<br />
b. formes : mécanismes<br />
L’élément initial (intensif) grec ou latin qui est devenu un affixe fonctionnel<br />
apte à s’associer avec des bases du vocabulaire commun, s’intègre, en<br />
synchronie, dans un processus de « créativité lexicale incessante » 34 . Nous<br />
devons à présent focaliser notre attention sur deux aspects importants pour une<br />
étude sur les formations par préfixation : la délimitation et donc la dénomination<br />
des<strong>di</strong>ts éléments dans un rapport, cette fois, préfixe-bases et les mécanismes<br />
générateurs qui déterminent leur <strong>di</strong>sponibilité dans la construction de nouvelles<br />
unités et, de ce fait, leur dynamique dans le procès néologique de la langue.<br />
Notre objectif consiste avant tout à désambiguïser l’approche théorique en<br />
outrepassant, tout d’abord, les fameux clivages composition-dérivation et<br />
composition-préfixation qui affleurent toujours dès lors qu’il s’agit d’analyser<br />
des formations hybrides par préfixation gréco-latine, dès lors qu’il s’agit, d’une<br />
façon plus générale, d’aborder des formes construites par antéposition d’une<br />
33 Les études récentes sur la préfixation gréco-latine bannissent l’appellation<br />
« savant » qui semble trop liée au champ et au vocabulaire scientifique. D. Corbin<br />
(2001) lui préfère « archéoconstituant », qui in<strong>di</strong>que bien qu’il s’agit d’éléments<br />
provenant des langues mères, mais qui a perdu toute connotation scientifique, in<br />
« Préfixes et suffixes : du sens aux catégories » in Journal of French Language<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong>es, Vol. II, p. 44 ; dans la même optique, J.-F. Sablayrolles opte pour la<br />
terminologie de J. Tournier et parle de « paléomorphèmes » in La néologie en<br />
français contemporain, cit., p. 223.<br />
34 Cottez H., Dictionnaire des structures savantes, cit., p. XVII.<br />
43