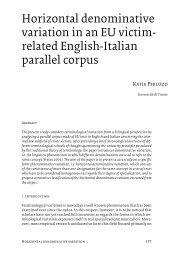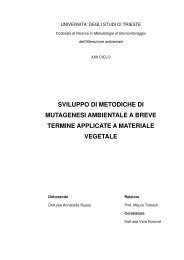SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
SERT 24_Janot.pdf - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Préfixes intensifs français et italiens<br />
de l’analyse sur lequel les <strong>di</strong>fférentes écoles linguistiques (de Darmesteter à<br />
Corbin) ont débattu et débattent encore. Les auteurs de manuels de lexicologie<br />
tion et de néologie qui ont pris leurs <strong>di</strong>stances par rapport à cette théorie. Toutefois,<br />
nous ne pouvons nier leur apport sur un aspect que nous ne cesserons de<br />
mentionner : la valeur grammaticale de l’élément préfixal. Relevant les limites et<br />
l’« insuffisance théorique » de l’analyse morphologique des formes construites,<br />
selon les critères classiques de <strong>di</strong>stinction entre dérivation et composition, Guilbert<br />
propose son analyse en se basant sur la relation syntagmatique selon laquelle « la<br />
construction lexicale repose sur des règles de syntaxe interne dont l’essentiel est<br />
une relation syntagmatique de déterminant à déterminé (le morphème de base<br />
déterminant l’élément affixé) », escamotant ainsi le problème de la <strong>di</strong>fférenciation<br />
entre dérivation (suffixation et préfixation) et composition et la « <strong>di</strong>fficulté de<br />
fonctionnement de certains éléments de composition comme les éléments savants<br />
qui n’entrent pas dans la <strong>di</strong>stinction entre unités autonomes et éléments non<br />
autonomes. » L’auteur choisit d’englober toutes les modalités de construction<br />
lexicale (suffixation, préfixation et composition) sous le même terme de<br />
« dérivation » en partant du principe que toutes reposent sur la transformation de<br />
phrases de <strong>di</strong>scours sous-jacentes.<br />
→ SUFFIXATION<br />
DERIVATION → PREFIXATION<br />
→ COMPOSITION<br />
C’est la structure de ces phrases de base qui permet de faire la <strong>di</strong>stinction entre un<br />
mot préfixé et un mot composé. La procédure de transformation est conçue selon<br />
des schémas se basant sur la relativisation pour les préfixés, à travers la relation<br />
entre préposition et adverbe et la catégorie du préfixe (archi-/arci- ; extra- ; hyper-<br />
/iper- ; super- ; ultra-), et la pré<strong>di</strong>cation pour les composés (maxi- ; méga-/mega-).<br />
in Guilbert L., De la formation des unités lexicales, cit., p. XXXII. Prenons les<br />
exemples :<br />
– un super-préfet est un préfet qui est au-dessus de du préfet; un homme politique<br />
ultra-nationaliste est un homme politique qui est très nationaliste (nationaliste à un<br />
degré extrême).<br />
– un maxi-manteau est un manteau qui est (très) grand ; un megaconcerto è un<br />
concerto che è (molto) importante.<br />
La théorie de Guilbert (comme celle de Darmesteter A., 1874, Traité de la<br />
formation des mots composés, p. 3 in Peytard J., Recherches sur la préfixation en<br />
français contemporain, cit., p. 13 : « Les rapports qui unissent la composition à la<br />
syntaxe sont trop évidents pour qu’il soit besoin d’y insister. Un mot composé est<br />
une proposition en raccourci et cela est si vrai que la question de la place du<br />
déterminé par rapport au déterminant se ramène à la question de la place de<br />
l’attribut dans la phrase indo-européenne primitive. » et de Benveniste E., 1974,<br />
Problèmes de linguistique générale, vol. 2, Paris, Galllimard, pp. 160-161 : « […]<br />
on ne peut […] plus expliquer la création des composés par la simple jonction<br />
immé<strong>di</strong>ate de deux signes antérieurs. Si la composition nominale était comme on la<br />
45