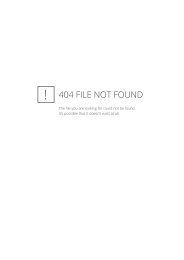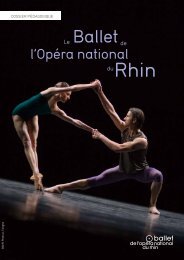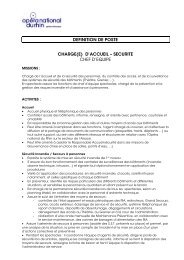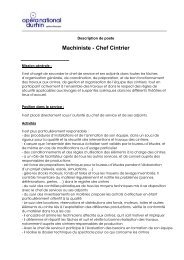Platée - Opéra national du Rhin
Platée - Opéra national du Rhin
Platée - Opéra national du Rhin
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean-Philippe Rameau<br />
Né à Dijon en 1683, il est le septième de onze enfants. Son père, organiste, assure<br />
la formation musicale de ses enfants : on dit de Jean-Philippe qu’il savait son<br />
solfège avant même de savoir lire et écrire. En 1701, se destinant à la musique, il<br />
séjourne environ trois mois à Milan. À partir de 1702, il est successivement organiste<br />
à Clermont, à Paris chez les Jésuites, à Dijon où il reprend le poste de son père à<br />
Notre-Dame, à Lyon puis à nouveau à Clermont. Il approfondit ses connaissances<br />
théoriques sur la musique, et publie le Traité de l’Harmonie ré<strong>du</strong>ite à ses principes<br />
naturels à son arrivée à Paris en 1722. Il compose plusieurs cantates et motets. Avant<br />
1727, il rencontre son futur mécène, La Pouplinière, et obtient en 1731 la direction de<br />
son orchestre privé. Hippolyte et Aricie, sur un livret de Pellegrin initie la Querelle des<br />
Bouffons en 1733. En 1736, Samson est interdit par la censure à cause <strong>du</strong> livret de<br />
Voltaire. La même année, Castor et Pollux, tragédie lyrique, est donnée à Versailles et<br />
Rameau ouvre son École de composition. En 1745, il est nommé Compositeur de la<br />
Musique <strong>du</strong> Cabinet <strong>du</strong> Roi et se tourne vers une musique plus légère, privilégiant<br />
l’opéra-ballet et la pastorale aux tragédies en musique. <strong>Platée</strong>, comédie-ballet, est<br />
donnée à Versailles la même année. En 1748, Rameau compose Zaïs, pastorale<br />
héroïque en un prologue et quatre actes, puis un ballet, Pygmalion. En 1750, il<br />
publie Démonstration <strong>du</strong> principe de l’harmonie, dont Diderot a aidé la rédaction.<br />
Le triomphe de la reprise de Castor et Pollux en 1754 met provisoirement fin à la<br />
Querelle des Bouffons dans laquelle Rameau se trouve engagé depuis 1752. Rameau compose sa dernière œuvre,<br />
Les Boréades, en 1763. Il a 80 ans. Pour des raisons obscures, l’œuvre n’est pas jouée. Le compositeur meurt le 12<br />
septembre de l’année suivante. La Querelle des Bouffons l’a relégué avec Lully parmi les gloires <strong>du</strong> passé.<br />
À propos de Rameau...<br />
Frédéric-Melchior Baron de Grimm, qui fut un farouche opposant à l’opéra français, déclara en 1752 dans une lettre :<br />
« M. Rameau est considéré par tous les connaisseurs comme un des plus grands musiciens qui ait jamais existé, et<br />
c’est avec raison. »<br />
Et le même Baron Grimm dans sa Lettre sur Omphale : « Mon étonnement est à son comble, quand je pense que<br />
l’auteur de Pygmalion est celui <strong>du</strong> quatrième acte de Zoroastre, que l’auteur de Zoroastre est celui de <strong>Platée</strong>, et que<br />
l’auteur de <strong>Platée</strong> a fait le divertissement de la Rose dans l’acte des Fleurs. Quel Protée toujours nouveau, toujours<br />
original, toujours saisissant le vrai et le sublime de chaque caractère ! »<br />
Jean-Jacques Rousseau qui écrivait à Grimm : « Personne n’a mieux que lui saisi l’esprit des détails, personne n’a<br />
mieux su l’art des contrastes. »<br />
Pierre-Louis d’Aquin de Châteaulyon dans Le Siècle littéraire de Louis XV, au sujet de la musique et ses effets : « Je<br />
connais des gens à qui un opéra de M. Rameau a valu les conseils des Molins et des Vernages, ils étaient fort<br />
malades en entrant, ils en sortaient guéris. Je ne parle que de ceux qui ont un organe sensible. » (1753).<br />
Puis, un siècle plus tard, Hector Berlioz disait de lui : « Rameau est le premier musicien français qui mérite le nom de<br />
maître. » (1842).<br />
Et Claude Debussy, encore plus récemment :<br />
« L’immense apport de Rameau est ce qu’il sut découvrir de la « sensibilité dans l’harmonie » ; ce qu’il réussit à noter<br />
certaines couleurs, certaines nuances dont, avant lui, les musiciens n’avaient qu’un sentiment confus. » (1912).<br />
L’apport de Rameau à la tragédie lyrique<br />
Il est considérable : il en fait un pro<strong>du</strong>it ayant sa propre cohérence, une œuvre d’art en soi, et non plus un prétexte<br />
à dire autre chose. Il contribue à l’élimination progressive des prologues à tendances politique ou sociale et cesse<br />
de reprendre des danses déjà enten<strong>du</strong>es dans des divertissements antérieurs en guise d’entractes, les remplaçant<br />
par des compositions spécialement adaptées à la situation dramatique. L’ouverture, au lieu d’être une symphonie<br />
autonome et sans rapport avec le drame, devient un prélude, une préparation psychologique à l’action, en lien<br />
avec le climat sonore de l’œuvre. En cela, Rameau précède les réformes de Gluck.