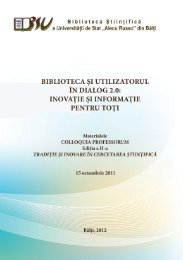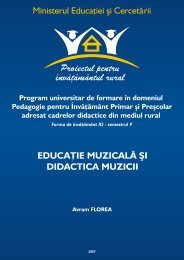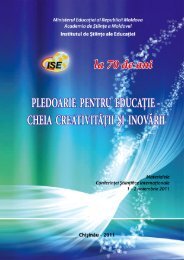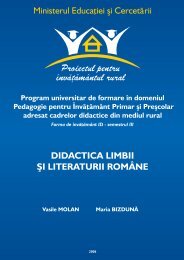Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ou les choses dont on parle. Dans le second cas (du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> grammaire) on<br />
considère mots <strong>de</strong>s unités <strong>de</strong> discours inanalysables comme forme : parle, ou<br />
composées d’éléments analysables dans le discours et qui existent comme pièces<br />
autonomes : parl- ons.<br />
Le défaut consiste encore en ce qu’on considère mot seulememnt ce qui est<br />
audible dans l’oral et visible dans l’écrit, en ne tenant pas compte du fait qu’il y a<br />
une discordance toujours possible entre le signifiant et le signifié (forme et contenu).<br />
En d’autres termes, on considère mot seulement les signes qui ont une représentation<br />
matérielle, mais ce n’est pas correct, car ceux sans représentation matérielle ont<br />
autant <strong>de</strong> réalité que les premiers. Ils sont présents dans <strong>la</strong> pensées et sans eux le<br />
discours serait inintelligible.Par exemple, dans marche : on sousentend et (tu) le<br />
pronom – sujet <strong>de</strong> <strong>la</strong> II-ème personne singulier et <strong>la</strong> valeur modale <strong>de</strong> l’impératif<br />
(l’ordre).<br />
Ainsi ce qu’on appelle mot est tantôt un signe purement lexical sans aucun<br />
ingrédient grammatical : chat, tantôt un complexe indécomposable <strong>de</strong> signes qui<br />
fonctionne dans le discours grâce à un certain nombre d’actiualisateurs, <strong>de</strong> ligaments<br />
grammaticaux. Par exemple, loup est un signe purement lexical tandis que lup-us du<br />
<strong>la</strong>tin, <strong>la</strong> flexion –us lui confère une valeur grammaticale <strong>de</strong> nominatif. Au signe loup<br />
du français correspond le radical lup du <strong>la</strong>tin qui n’a aucune autonomie syntaxique<br />
(il ne peut pas être élément d’une phrase. Le loup du français n’est guère plus<br />
autonome dans le discours que le lup du <strong>la</strong>tin car il ne peut pas figurer à lui seul dans<br />
une phrase. Pour remplir une <strong>de</strong>s fonctions du substantif (sujet, complément d’objet,<br />
et du nom…) il doit être actualisé, car on ne peut pas dire : Je vois loup ou Loup<br />
mange. Donc, tout signe purement lexical : a) simple – loup, chat; b) suffixal –<br />
bleuâtre; c) composé – rouge-gorge est appelé sémantème et tout complexe actualisé<br />
formé d’un sémantème et d’un ou plusieurs signes grammaticaux (actualisateurs ou<br />
ligaments) nécessaires et suffisants qu’il fonctionne dans une phrase est appélé<br />
moécule syntaxique : chat – c’est un sémantème, mais ce chat – est une molécule<br />
syntaxique, car sans l’élément ce l’élément chat ne peut pas entrer dans une phrase;<br />
march-ons est molécule grâce à <strong>la</strong> désinence ons et marche grace à <strong>la</strong> désinence<br />
zéro (dans l’oral). Ce concepte est appelé différemment par <strong>de</strong> différents linguistes :<br />
Ch.Bally l’appelle molécule syntaxique; A. Martinet – syntagme autonome; B.Pottier<br />
– lexie et E. Benveniste l’appelle synapsie<br />
Les éléments d’une molécule peuvent être séparés tout en <strong>la</strong>issant celle-ci<br />
indivisible du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur, par exemple, dans <strong>la</strong> molécule : Je vois on<br />
peut intercaler encore un élément : Je (le) vois – les éléments sont séparés mais le<br />
sens (ou <strong>la</strong> valeur) <strong>de</strong> <strong>la</strong> molécule n’est pas détruit. Ils peuvent aussi changer <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ce, <strong>la</strong> molécule restant intacte : il cahnge / change- t-il? Tout simplement ce<strong>la</strong><br />
prouve le fait que <strong>la</strong> molécule <strong>française</strong> est plus analytique que celle <strong>la</strong>tine.<br />
Donc, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’autonomie du mot est ramenée à celle du sémantème.<br />
La question est <strong>la</strong> suivante: un sémantème, peut-il être en même temps une unité<br />
fonctionnelle, c’est-à-dire, une molécule? Par exempler, loup est-il en même temps<br />
sémantème et molécule? Ou le sémantème est complètement indépendant <strong>de</strong>s autres<br />
éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> molécule? Bien sûr que non, dans : tu march-ais le sémantème<br />
22