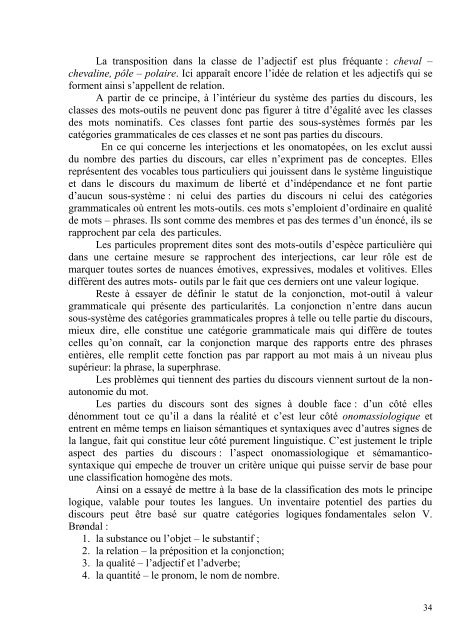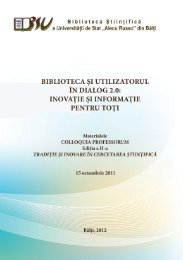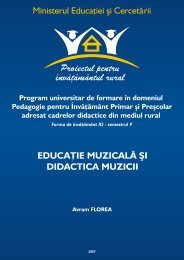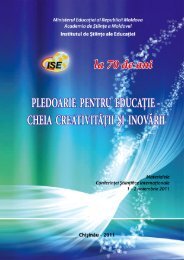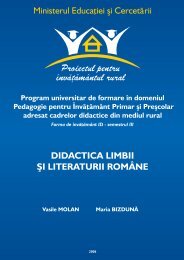Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La transposition dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> l’adjectif est plus fréquante : cheval –<br />
chevaline, pôle – po<strong>la</strong>ire. Ici apparaît encore l’idée <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tion et les adjectifs qui se<br />
forment ainsi s’appellent <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tion.<br />
A partir <strong>de</strong> ce principe, à l’intérieur du système <strong>de</strong>s parties du discours, les<br />
c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong>s mots-outils ne peuvent donc pas figurer à titre d’égalité avec les c<strong>la</strong>sses<br />
<strong>de</strong>s mots nominatifs. Ces c<strong>la</strong>sses font partie <strong>de</strong>s sous-systèmes formés par les<br />
catégories grammaticales <strong>de</strong> ces c<strong>la</strong>sses et ne sont pas parties du discours.<br />
En ce qui concerne les interjections et les onomatopées, on les exclut aussi<br />
du nombre <strong>de</strong>s parties du discours, car elles n’expriment pas <strong>de</strong> conceptes. Elles<br />
représentent <strong>de</strong>s vocables tous particuliers qui jouissent dans le système linguistique<br />
et dans le discours du maximum <strong>de</strong> liberté et d’indépendance et ne font partie<br />
d’aucun sous-système : ni celui <strong>de</strong>s parties du discours ni celui <strong>de</strong>s catégories<br />
grammaticales où entrent les mots-outils. ces mots s’emploient d’ordinaire en qualité<br />
<strong>de</strong> mots – phrases. Ils sont comme <strong>de</strong>s membres et pas <strong>de</strong>s termes d’un énoncé, ils se<br />
rapprochent par ce<strong>la</strong> <strong>de</strong>s particules.<br />
Les particules proprement dites sont <strong>de</strong>s mots-outils d’espèce particulière qui<br />
dans une certaine mesure se rapprochent <strong>de</strong>s interjections, car leur rôle est <strong>de</strong><br />
marquer toutes sortes <strong>de</strong> nuances émotives, expressives, modales et volitives. Elles<br />
diffèrent <strong>de</strong>s autres mots- outils par le fait que ces <strong>de</strong>rniers ont une valeur logique.<br />
Reste à essayer <strong>de</strong> définir le statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> conjonction, mot-outil à valeur<br />
grammaticale qui présente <strong>de</strong>s particu<strong>la</strong>rités. La conjonction n’entre dans aucun<br />
sous-système <strong>de</strong>s catégories grammaticales propres à telle ou telle partie du discours,<br />
mieux dire, elle constitue une catégorie grammaticale mais qui diffère <strong>de</strong> toutes<br />
celles qu’on connaît, car <strong>la</strong> conjonction marque <strong>de</strong>s rapports entre <strong>de</strong>s phrases<br />
entières, elle remplit cette fonction pas par rapport au mot mais à un niveau plus<br />
supérieur: <strong>la</strong> phrase, <strong>la</strong> superphrase.<br />
Les problèmes qui tiennent <strong>de</strong>s parties du discours viennent surtout <strong>de</strong> <strong>la</strong> non-<br />
autonomie du mot.<br />
Les parties du discours sont <strong>de</strong>s signes à double face : d’un côté elles<br />
dénomment tout ce qu’il a dans <strong>la</strong> réalité et c’est leur côté onomassiologique et<br />
entrent en même temps en liaison sémantiques et syntaxiques avec d’autres signes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, fait qui constitue leur côté purement linguistique. C’est justement le triple<br />
aspect <strong>de</strong>s parties du discours : l’aspect onomassiologique et sémamantico-<br />
syntaxique qui empeche <strong>de</strong> trouver un critère unique qui puisse servir <strong>de</strong> base pour<br />
une c<strong>la</strong>ssification homogène <strong>de</strong>s mots.<br />
Ainsi on a essayé <strong>de</strong> mettre à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s mots le principe<br />
logique, va<strong>la</strong>ble pour toutes les <strong>la</strong>ngues. Un inventaire potentiel <strong>de</strong>s parties du<br />
discours peut être basé sur quatre catégories logiques fondamentales selon V.<br />
Brøndal :<br />
1. <strong>la</strong> substance ou l’objet – le substantif ;<br />
2. <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion – <strong>la</strong> préposition et <strong>la</strong> conjonction;<br />
3. <strong>la</strong> qualité – l’adjectif et l’adverbe;<br />
4. <strong>la</strong> quantité – le pronom, le nom <strong>de</strong> nombre.<br />
34