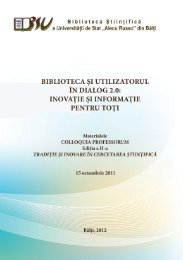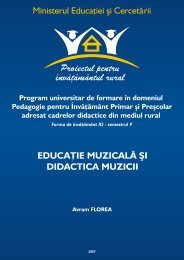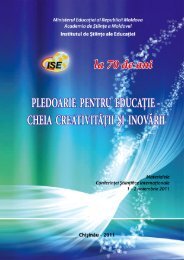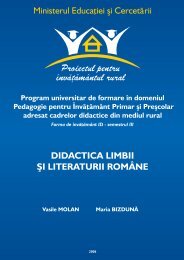Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Grammaire théorique de la langue française - Biblioteca Ştiinţifică a ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I.2. Les métho<strong>de</strong>s d’étu<strong>de</strong> en grammaire<br />
Un <strong>de</strong>s principes du choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> d’étu<strong>de</strong> dans <strong>la</strong> grammaire c’est celui<br />
sémiotique qui consiste dans le choix du signe nécessaire dans <strong>la</strong> position nécessaire<br />
<strong>de</strong> façon que l’énoncé ait du sens. On peut dire: Pierre parle, mais on ne peut pas<br />
dire: Pierre parlons. A <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ce choix se trouvent les rapports syntagmatiques et<br />
paradigmatiques entre les signes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue : Pierre parle, Michel mange les signes<br />
se trouvent en rapports syntagmatiques. Les éléments d’un paradigme peuvent se<br />
combiner avec d’autres éléments mais pas entre eux: parle mange – ce n’est pas<br />
correct car les <strong>de</strong>ux entrent dans le même paradigme.<br />
De ce point <strong>de</strong> vue on connaît les métho<strong>de</strong>s d’analyse suivantes:<br />
1. La métho<strong>de</strong> distributive (distributionnelle);<br />
2. La métho<strong>de</strong> transformationnelle;<br />
3. La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s oppositions (oppositionelle);<br />
4. La métho<strong>de</strong> situationnelle – contextuelle.<br />
Les grammaires formelles se limitent aux <strong>de</strong>ux premières métho<strong>de</strong>s, celles<br />
sémantiques (logiques, raisonnées) y ajoutent encore les autres. Dans les métho<strong>de</strong>s<br />
transformationnelle, oppositionnelle, <strong>de</strong>s composants immédiats on se base sur les<br />
rapports paradigmatiques. Dans <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> distributionnelle et contexto –<br />
situationnelle – sur les rapports syntagmatiques. Quelle que soit <strong>la</strong> métho<strong>de</strong><br />
d’analyse à sa base se trouve le principe sémantique <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
forme et du contenu. La difficulté vient <strong>de</strong> l’assimétrie entre le contenu et <strong>la</strong> forme<br />
du signe linguistique.<br />
La métho<strong>de</strong> distributive (distributionnelle) se base sur les rapports<br />
syntagmatiques entre les unités <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Elle permet <strong>de</strong> segmenter <strong>la</strong> chaîne parlée et <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduire à <strong>de</strong>s unités d’un<br />
rang inférieur, et <strong>de</strong> même <strong>de</strong> grouper ces unités en c<strong>la</strong>sses en permettant ainsi <strong>de</strong><br />
délimiter les unités <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue (leur i<strong>de</strong>ntification, leurs limites et leur<br />
c<strong>la</strong>ssification). On suppose que dans cette métho<strong>de</strong> on rejette complètement le sens.<br />
(J.Dubois). Mais ce n’est pas tout à fait ça, car pendant cette métho<strong>de</strong> on se base sur<br />
l’isomorphisme sémantico – structural c’est – à – dire à chaque forme correspond un<br />
sens et entre le sens et <strong>la</strong> forme il y a une corré<strong>la</strong>tion réciproque. Néanmoins le sens<br />
ici est pris en considération dans sa forme <strong>la</strong> plus générale; on prend en considération<br />
si: a) les unités ou leur combinaisons ont un sens, b) si le sens ou <strong>la</strong> fonction se gar<strong>de</strong><br />
quand <strong>la</strong> forme change.<br />
Chaque élément du mot ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne parlée se caractérise par un certain<br />
entourage. La totalité <strong>de</strong>s éléments qui constituent cet entourage s’appelle <strong>la</strong><br />
distribution <strong>de</strong> l’élément donné. Par ex.: Un grand homme a <strong>la</strong> structure ou<br />
l’entourage suivant: art (dét) + adj + N, ou: art (dét) + N + A. : Une tâche<br />
importante, ou c’est + A. : C’est difficile. Donc, tout mot ayant une telle distribution<br />
peut être attribué à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> l’adjectif. On emploie cette métho<strong>de</strong> dans <strong>la</strong><br />
morphologie pour relever les morphèmes grammaticaux : en/fant/er et<br />
l’établissement <strong>de</strong>s catégories: calm/e, calm/er, calm/e/ment ça le calm/ait dans<br />
8