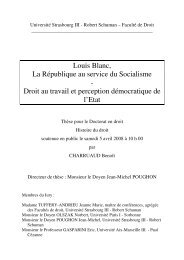Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
deviennent en eff<strong>et</strong> opaques. Les règles concrètes deviennent alors de moins en moins adaptées à<br />
répondre à ce genre d’incertitude “structurelle” <strong>et</strong> non plus simplement “paramétrique” (au sens de<br />
Minkler, 1993). C’est pourquoi Langlois (1997) propose que plus le changement est radical (plus est<br />
radicale la déviation par rapport à la trajectoire coutumière), plus abstraites seront les règles nécessaires<br />
pour changer, créer, ou réorganiser les capacités concrètes dans une direction efficace. Dans notre<br />
interprétation, l’émergence de ces règles abstraites au sein des organisations est synonyme de cultures<br />
d’entreprise qui vont présider de manière spontanée à la coordination des connaissances de plus en plus<br />
dispersées <strong>et</strong> des actions de plus en plus décentralisées au sein des organisations.<br />
Il s’agit, de ce point de vue, d’analyser la firme comme un système de routines <strong>et</strong> de règles tacites dont<br />
l’évolution pourrait être décrite dans les termes Hayekiens de l’évolution culturelle. Nous empruntons à<br />
c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> la grille de lecture Hayekienne, combinée à une perspective évolutionniste récente, dite<br />
mémétique, pour essayer de comprendre <strong>et</strong> d’interpréter la genèse endogène des systèmes de règles<br />
abstraites présidant au comportement de la firme <strong>et</strong> de ses membres individuels, ce que nous appelons<br />
une “culture d’entreprise”.<br />
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’économie évolutionniste 1 où il convient plus précisément de<br />
distinguer, dans la lignée de Witt (1991), quatre traditions (très) différentes : la tradition Hayekienne, la<br />
tradition Schump<strong>et</strong>erienne, l’institutionnalisme à la Veblen <strong>et</strong> la tradition marxiste. Ce travail est basé<br />
analytiquement sur les deux premières traditions que nous discuterons successivement dans les chapitres<br />
2 <strong>et</strong> 3.<br />
Et si Richard Nelson appelle de ses vœux une telle approche (citation supra), c’est que c<strong>et</strong>te attitude est<br />
aujourd’hui encore minoritaire <strong>et</strong> loin de fédérer l’adhésion des économistes pour constituer un véritable<br />
paradigme. Autrement dit, le “paradigme évolutionniste” en économie n’est toujours pas stabilisé, ce que<br />
d’aucuns appellent un paradigme en décantation.<br />
L’approche économique évolutionniste rompt avec l’analyse économique standard sur la caractérisation<br />
même du “problème économique” : sur la caractérisation des agents économiques, de leur rationalité, de<br />
leurs croyances, de même que sur la caractérisation du changement économique, autant d’éléments qui<br />
revêtent les caractéristiques de l’évolution. Le “problème économique” tel qu’il se dégage d’une<br />
approche évolutionniste est moins un problème d’optimisation que celui d’apprentissage <strong>et</strong> de<br />
coordination. En partant de la considération de la dispersion de la connaissance productive entre des<br />
agents économiques individuels, dotés d’une rationalité limitée, <strong>et</strong> se mouvant dans un environnement<br />
complexe <strong>et</strong> incertain, il n’y a en eff<strong>et</strong> aucune raison de penser que la coordination des plans individuels<br />
des agents puisse être établie ex ante <strong>et</strong> encore moins qu’elle puisse être optimale. Ce qu’il s’agit alors de<br />
chercher à expliquer ce sont plutôt les processus d’apprentissage <strong>et</strong> de coordination interindividuelle,<br />
1 Nous parlerons dans ce travail d’économie évolutionniste <strong>et</strong> de mécanismes évolutionnaires. Nous rejoignons ici Philippe<br />
Van Parijs qui est, à notre connaissance, le seul auteur à avoir établi, dans Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An<br />
Emerging Paradigm (1981), une clarification des deux concepts. Van Parijs y établit en eff<strong>et</strong> une distinction n<strong>et</strong>te, claire <strong>et</strong><br />
limpide entre les deux concepts en distinguant une perspective “évolutionniste” qui concerne l’évolution en tant que succession<br />
de changements caractérisée par une direction <strong>et</strong> une perspective “évolutionnaire” qui concerne l’évolution en tant que<br />
succession de changements caractérisée par un mécanisme.