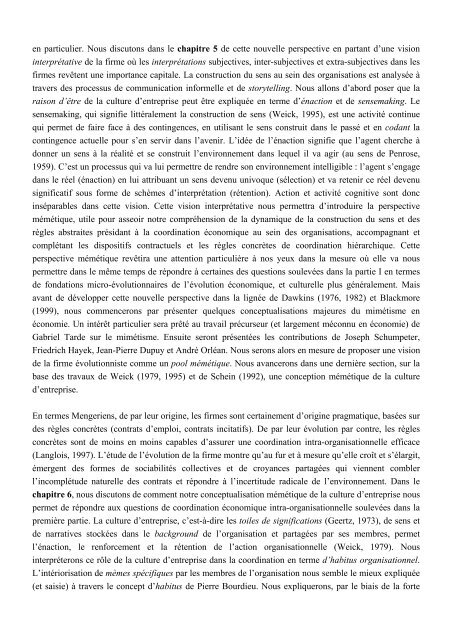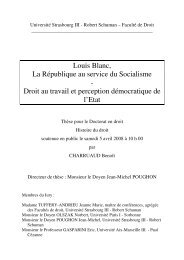Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
en particulier. Nous discutons dans le chapitre 5 de c<strong>et</strong>te nouvelle perspective en partant d’une vision<br />
interprétative de la firme où les interprétations subjectives, inter-subjectives <strong>et</strong> extra-subjectives dans les<br />
firmes revêtent une importance capitale. La construction du sens au sein des organisations est analysée à<br />
travers des processus de communication informelle <strong>et</strong> de storytelling. Nous allons d’abord poser que la<br />
raison d’être de la culture d’entreprise peut être expliquée en terme d’énaction <strong>et</strong> de sensemaking. Le<br />
sensemaking, qui signifie littéralement la construction de sens (Weick, 1995), est une activité continue<br />
qui perm<strong>et</strong> de faire face à des contingences, en utilisant le sens construit dans le passé <strong>et</strong> en codant la<br />
contingence actuelle pour s’en servir dans l’avenir. L’idée de l’énaction signifie que l’agent cherche à<br />
donner un sens à la réalité <strong>et</strong> se construit l’environnement dans lequel il va agir (au sens de Penrose,<br />
1959). C’est un processus qui va lui perm<strong>et</strong>tre de rendre son environnement intelligible : l’agent s’engage<br />
dans le réel (énaction) en lui attribuant un sens devenu univoque (sélection) <strong>et</strong> va r<strong>et</strong>enir ce réel devenu<br />
significatif sous forme de schèmes d’interprétation (rétention). Action <strong>et</strong> activité cognitive sont donc<br />
inséparables dans c<strong>et</strong>te vision. C<strong>et</strong>te vision interprétative nous perm<strong>et</strong>tra d’introduire la perspective<br />
mémétique, utile pour asseoir notre compréhension de la dynamique de la construction du sens <strong>et</strong> des<br />
règles abstraites présidant à la coordination économique au sein des organisations, accompagnant <strong>et</strong><br />
complétant les dispositifs contractuels <strong>et</strong> les règles concrètes de coordination hiérarchique. C<strong>et</strong>te<br />
perspective mémétique revêtira une attention particulière à nos yeux dans la mesure où elle va nous<br />
perm<strong>et</strong>tre dans le même temps de répondre à certaines des questions soulevées dans la partie I en termes<br />
de fondations micro-évolutionnaires de l’évolution économique, <strong>et</strong> culturelle plus généralement. Mais<br />
avant de développer c<strong>et</strong>te nouvelle perspective dans la lignée de Dawkins (1976, 1982) <strong>et</strong> Blackmore<br />
(1999), nous commencerons par présenter quelques conceptualisations majeures du mimétisme en<br />
économie. Un intérêt particulier sera prêté au travail précurseur (<strong>et</strong> largement méconnu en économie) de<br />
Gabriel Tarde sur le mimétisme. Ensuite seront présentées les contributions de Joseph Schump<strong>et</strong>er,<br />
Friedrich Hayek, Jean-Pierre Dupuy <strong>et</strong> André Orléan. Nous serons alors en mesure de proposer une vision<br />
de la firme évolutionniste comme un pool mémétique. Nous avancerons dans une dernière section, sur la<br />
base des travaux de Weick (1979, 1995) <strong>et</strong> de Schein (1992), une conception mémétique de la culture<br />
d’entreprise.<br />
En termes Mengeriens, de par leur origine, les firmes sont certainement d’origine pragmatique, basées sur<br />
des règles concrètes (contrats d’emploi, contrats incitatifs). De par leur évolution par contre, les règles<br />
concrètes sont de moins en moins capables d’assurer une coordination intra-organisationnelle efficace<br />
(Langlois, 1997). L’étude de l’évolution de la firme montre qu’au fur <strong>et</strong> à mesure qu’elle croît <strong>et</strong> s’élargit,<br />
émergent des formes de sociabilités collectives <strong>et</strong> de croyances partagées qui viennent combler<br />
l’incomplétude naturelle des contrats <strong>et</strong> répondre à l’incertitude radicale de l’environnement. Dans le<br />
chapitre 6, nous discutons de comment notre conceptualisation mémétique de la culture d’entreprise nous<br />
perm<strong>et</strong> de répondre aux questions de coordination économique intra-organisationnelle soulevées dans la<br />
première partie. La culture d’entreprise, c’est-à-dire les toiles de significations (Geertz, 1973), de sens <strong>et</strong><br />
de narratives stockées dans le background de l’organisation <strong>et</strong> partagées par ses membres, perm<strong>et</strong><br />
l’énaction, le renforcement <strong>et</strong> la rétention de l’action organisationnelle (Weick, 1979). Nous<br />
interpréterons ce rôle de la culture d’entreprise dans la coordination en terme d’habitus organisationnel.<br />
L’intériorisation de mèmes spécifiques par les membres de l’organisation nous semble le mieux expliquée<br />
(<strong>et</strong> saisie) à travers le concept d’habitus de Pierre Bourdieu. Nous expliquerons, par le biais de la forte