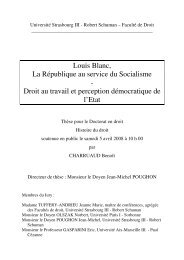Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
de règles abstraites présidant à la coordination économique au sein de la firme, ce que nous appellerons<br />
une “culture d’entreprise”. Nous discuterons ensuite des régularités de construction des cultures<br />
d’entreprise <strong>et</strong> de l’évolution culturelle de la firme que nous traduirons en terme de “régimes culturels”. Il<br />
s’agit, à travers le recours au concept régime, de représenter les régularités que nous avons pu déceler<br />
dans la dynamique de l’évolution culturelle de la firme. Nous définirons les régimes culturels sur une base<br />
tripartie : (i) la dispersion de la connaissance productive ; (ii) la communication ; <strong>et</strong> (iii) l’autorité au sein<br />
de la firme. Nous distinguerons ensuite deux principaux régimes culturels : un régime culturel Taylorien,<br />
ou régime standard, <strong>et</strong> un régime culturel post-Taylorien, conséquent à l’avènement d’une économie<br />
basée sur la connaissance.<br />
Ce travail de thèse procède comme suit.<br />
**<br />
La thèse comporte neuf chapitres. Dans le chapitre 1, nous discutons des liens entre économie <strong>et</strong><br />
évolution : l’idée de l’évolution doit-elle être nécessairement rattachée à une discipline particulière, la<br />
biologie en l’occurrence, ou est-elle une posture épistémologique ? A quel degré l’influence du modèle<br />
biologique est-elle prégnante dans les approches évolutionnistes en économie ? Quel est le degré<br />
d’enracinement des approches évolutionnistes en économie <strong>et</strong> dans les sciences sociales en général ? La<br />
première constatation que nous ferons dans c<strong>et</strong>te mise en perspective est le caractère encore minoritaire<br />
de l’approche évolutionniste en économie par rapport au modèle standard. Une seconde constatation sera<br />
la grande hétérogénéité des contributions évolutionnistes contemporaines. Nous ne pouvons en eff<strong>et</strong> que<br />
très difficilement relever des traits communs à des contributions s’inspirant aussi bien de Schump<strong>et</strong>er, de<br />
Hayek que de Veblen. Nous allons entreprendre à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> un examen de la traçabilité (à la Callon <strong>et</strong><br />
Latour) des approches évolutionnistes en économie afin d’essayer d’y discerner le bon grain de l’ivraie <strong>et</strong><br />
de faire ressortir les postures authentiquement évolutionnistes que nous discuterons dans le reste du<br />
travail. Après avoir j<strong>et</strong>é la lumière sur les filiations d’Adam Smith, d’Alfred Marshall <strong>et</strong> de Thorstein<br />
Veblen, nous nous focalisons particulièrement sur les deux approches évolutionnistes saillantes : la<br />
tradition néo-Schump<strong>et</strong>erienne (qui reçoit aujourd’hui le plus d’adhésion) <strong>et</strong> la tradition Hayekienne (qui<br />
reste, elle, largement mésestimée). Ces deux traditions sur lesquelles repose analytiquement ce travail<br />
seront discutées successivement dans les chapitres 2 <strong>et</strong> 3.<br />
Nous traitons dans le chapitre 2 de la tradition néo-Schump<strong>et</strong>erienne qui trouve son point d’ancrage dans<br />
l’œuvre séminale de Nelson <strong>et</strong> Winter (1982). Nous verrons que depuis la publication de An Evolutionary<br />
Theory of Economic Change, les contributions qui vont se rattacher au programme de recherche tracé par<br />
Nelson <strong>et</strong> Winter vont se multiplier pour constituer un véritable courant de recherche. Courant de<br />
recherche certes hétérogène, ne reposant pas encore sur un paradigme stable, mais courant de recherche<br />
dynamique <strong>et</strong> en pleine évolution. A l’instar de Nelson <strong>et</strong> Winter (1982), les contributions évolutionnistes<br />
qui vont leur succéder vont s’intéresser principalement à des questions ayant trait à l’innovation :<br />
routines, connaissances, apprentissage, compétences, irréversibilités, <strong>et</strong>c. Autant de questions peu (ou pas<br />
du tout) traitées par la théorie standard, mais qui vont bénéficier dans c<strong>et</strong>te perspective d’une véritable