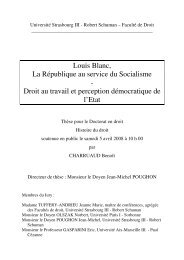Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Économie Évolutionniste et Culture d'Entreprise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
acquises par l’action du milieu qui, elles, sont biologiquement intransmissibles. En n’invoquant rien<br />
d’autre que les circonstances aléatoires, c<strong>et</strong>te explication ne repose en rien sur le succès plus ou moins<br />
grand obtenu par les individus dans leurs tentatives de s’adapter à leur environnement (Lagueux, 1999).<br />
1.3.2.2 Le Lamarckisme<br />
Bien avant Darwin, Jean-Baptiste Lamarck avait observé que les animaux changeaient sous la pression de<br />
l’environnement <strong>et</strong> il a suggéré qu’ils pourraient transm<strong>et</strong>tre de tels changements à leur progéniture. Le<br />
changement du milieu <strong>et</strong> la tendance adaptative ont pour eff<strong>et</strong> de modifier les besoins des espèces vivantes <strong>et</strong>, en<br />
conséquence, de modifier leur comportement. Ce qui entraîne l’usage de certaines parties de l’organisme <strong>et</strong> le<br />
non-usage de certaines autres, l’usage ou le non-usage ayant un eff<strong>et</strong> positif ou négatif sur le développement des<br />
organes. Les modifications ainsi obtenues deviennent héréditaires <strong>et</strong> sont donc transmises à la progéniture.<br />
Toutefois, il ne s’agit que de modifications fondamentales qui sont acquises en réponse à des défis intenses <strong>et</strong><br />
persistants du milieu écologique, poursuivis pendant des générations (par exemple le cou de la girafe). Le principe<br />
de vie décrit par Lamarck serait issu de deux composantes agissant simultanément : une montée croissante vers<br />
la complexité <strong>et</strong> une adaptation continuelle des êtres vivants à leur milieu. Le Lamarckisme est une théorie qui<br />
explique l’évolution des êtres vivants, (i) par leur adaptation volontaire au milieu <strong>et</strong> (ii) par l’hérédité des caractères<br />
acquis. C’est ainsi que Lamarck est souvent associé à l’idée d’hérédité des caractères acquis, présentée pour la<br />
première fois en 1801 (le premier livre de Darwin traitant de la sélection naturelle a été édité en 1859). Et c’est ce<br />
qui explique que ce soit l’hypothèse Lamarckienne (Zuscovitch, 1993) qui reçoive le plus d’adhésion dans la<br />
sphère économique, où on conçoit plus facilement la possibilité d’héritage de caractéristiques ou de compétences<br />
acquises <strong>et</strong> entreposées d’une manière ou d’une autre dans la mémoire collective : routines, traditions, normes<br />
apprises du passé, <strong>et</strong>c.<br />
La démonstration du caractère Lamarckien de l’évolution culturelle peut se faire de manière simple <strong>et</strong> directe. Les<br />
caractéristiques culturelles, règles de conduites, technologies ou connaissances, ne sont manifestement pas<br />
innées ou transmises génétiquement. Donc, l’évolution culturelle est nécessairement d’une certaine manière<br />
Lamarckienne, car ce qui est transmis par la culture est acquis. Aussi évidente que puisse sembler c<strong>et</strong>te<br />
démonstration, c’est oublier que la simple hérédité des caractères acquis pose en elle-même des problèmes<br />
importants. Il n’est en eff<strong>et</strong> pas avantageux que toutes les caractéristiques acquises au cours de l’existence soient<br />
héritées par les descendants. Il est même préférable que la plupart d’entre elles ne le soient pas. Pour qu’il y ait<br />
évolution, seulement certaines caractéristiques acquises doivent être héritées. Mais lesquelles ? Comment<br />
s’assurer que seules les caractéristiques qui sont “utiles” seront héritées <strong>et</strong> que le mécanisme de réplication ne<br />
transm<strong>et</strong>tra pas également une grande quantité de caractéristiques pernicieuses de génération en génération ? La<br />
réponse de Lamarck consiste à postuler que ne seront hérités que les caractères qui découlent des efforts faits par<br />
les organismes afin de s’adapter à leur environnement. Ainsi, les caractères acquis seraient précisément ceux qui<br />
sont “utiles” à l’organisme. Autrement dit, le cœur du Lamarckisme est l’idée que les mutations ne sont pas le fait<br />
du hasard, mais qu’elles sont au contraire guidées par l’adaptation volontaire (consciente ou inconsciente) à<br />
l’environnement (ce sont précisément ces apprentissages qui constituent les caractéristiques acquises héritées).<br />
C<strong>et</strong>te boucle de rétroaction Lamarckienne entre les mécanismes d’apprentissage, de sélection <strong>et</strong> d’hérédité perm<strong>et</strong><br />
de comprendre facilement la plus grande rapidité de l’évolution culturelle par rapport à l’évolution biologique. Parce<br />
qu’elles sont guidées par les efforts des individus pour s’adapter aux défis de leur environnement, les variations<br />
dont se nourrit l’évolution culturelle seront vraisemblablement, dès l’origine, plus proches du but poursuivi que les<br />
mutations Darwiniennes dues au hasard.<br />
Mais bien que les deux approches, Lamarckienne <strong>et</strong> Darwinienne, semblent être clairement distinctes, <strong>et</strong><br />
même exclusives l’une de l’autre, plusieurs tentatives actuelles en économie tentent de les combiner dans