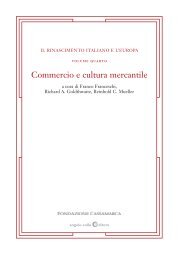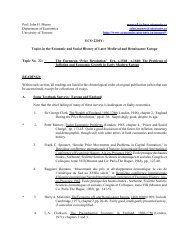- Page 2: HANDBOUND AT THE $ UNIVERSITY OF TO
- Page 8 and 9: MAÇON, PHOTAT FRERES, IMPRIMEURS.
- Page 10 and 11: 937015 / /^ s . >v^>
- Page 12 and 13: VI PREFACE térateurs de l'antiquit
- Page 14 and 15: On reproche enfin aux monnaies fran
- Page 16 and 17: ADDITIONS ET CORRECTIONS 1686 avec
- Page 18 and 19: 2 . INTRODUCTION bien des additions
- Page 20 and 21: 4 INTRODUCTION çois !«'; les Docu
- Page 22 and 23: INTRODUCTION 4" La présence de la
- Page 24 and 25: 8 ORGANISATION MONETAIRE exceptionn
- Page 26 and 27: 10 ORGANISATION MONETAIRE et les ma
- Page 28 and 29: 12 ORGANISATION MONETAIRE § III.
- Page 30 and 31: 14 ORGANISATION MONETAIRE Conformé
- Page 32 and 33: 16 ORGANISATION MONETAIRE 2
- Page 34 and 35: 18 ORGANISATION MONETAIRE roi envoy
- Page 36 and 37: 20 ORGANISATION MONÉTAIRE s< VII.
- Page 40 and 41: 24 LA FABRICATION On possède quelq
- Page 42 and 43: . 26 LA FABRICATION pesantes ; ces
- Page 44 and 45: 28 LA FABRICATION vouloir des taill
- Page 46 and 47: CHAPITRE III DE LA MATIÈRE DES MON
- Page 48 and 49: 32 DE LA MATIÈRE DES MONNAIES monn
- Page 50 and 51: 34 DE LA MATIÈRE DES MONNAIES Pour
- Page 52 and 53: :i6 DE LA MATIERE DES MONNAIES au l
- Page 54 and 55: 38 DE LA MATIÈRE DES MONNAIES sibl
- Page 56 and 57: 40 DE LA MATIERE DES MONNAIES 244 g
- Page 58 and 59: 4-2 DE LA MATIERE DES MONNArES Ce n
- Page 60 and 61: 44 DE LA MATIERE DES MONNAIES D'apr
- Page 62 and 63: CHAPITRE IV DE L'EMPREINTE DES MONN
- Page 64 and 65: 48 DE l'empreinte des monnaies [Fig
- Page 66 and 67: 50 DE l'empreinte des monnaies sous
- Page 68 and 69: 52 DE L EMPREINTE DES MONNAIES 1-2
- Page 70 and 71: 54 DE l'empreinte des monnaies * es
- Page 72 and 73: 56 DE l'empreinte des monnaies est
- Page 74 and 75: 58 DE L EMPREINTE DES MONNAIES de b
- Page 76 and 77: 60 DE l'empreinte des monnaies dans
- Page 78 and 79: 62 DE l'empreinte des monnaies se t
- Page 80 and 81: 64 DE l'empreinte des monnaies 8**
- Page 82 and 83: 66 DE l'empreinte des monnaies rest
- Page 84 and 85: CHAPITRE V DES PIÈGES MONÉTIFORME
- Page 86 and 87: 70 DES PIÈCES MONÉTIFORMES (Hoff.
- Page 88 and 89:
72 DES PIÈCES MONÉTIFORMES pièce
- Page 90 and 91:
74 DES PIÈCES MONÉTIFORMES récem
- Page 92 and 93:
CHAPITRE VI LA VALEUR DE COMPTE Som
- Page 94 and 95:
78 LA VALEUR DE COMPTE 1° Von paya
- Page 96 and 97:
80 LA VALEUR DE COMPTE § V. — Fi
- Page 98 and 99:
82 LA VALEUR DE COMPTE du second, p
- Page 100 and 101:
84 LA VALEUR DE COMPTE l'arrêter d
- Page 102 and 103:
86 LA VALEUR DE COMPTE la monnaie e
- Page 104 and 105:
. 88 LA VALEUR DE COMPTE payait 54
- Page 106 and 107:
9() LA VALEUR DE COMPTE Le roi en
- Page 108 and 109:
92 LA VALEUR DE COMPTE Quand le roi
- Page 110 and 111:
94 LA VALEUR DE COMPTE § XIV^ —
- Page 112 and 113:
96 LA VALEUR DE COMPTE SOU au denie
- Page 114 and 115:
98 LA VALEUR DE COMPTE 5 OU 6 au XI
- Page 116 and 117:
100 DES NOMS DES MONNAIES ET DE LEU
- Page 118 and 119:
102 DES NOMS DES MONNAIES ET DE LEU
- Page 120 and 121:
104 DES NOMS DES MONNAIES ET DE LEU
- Page 122 and 123:
106 DES NOMS DES MONNAIES ET DE LEU
- Page 124 and 125:
108 8** Kpoque du Teston et du Loui
- Page 126 and 127:
110 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 128 and 129:
112 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 130 and 131:
114 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 132 and 133:
I 16 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINIST
- Page 134 and 135:
118 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 136 and 137:
120 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 138 and 139:
12*2 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINIST
- Page 140 and 141:
124 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 142 and 143:
126 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 144 and 145:
1*28 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINIST
- Page 146 and 147:
130 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 148 and 149:
132 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 150 and 151:
. 134 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINIS
- Page 152 and 153:
136 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 154 and 155:
138 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 156 and 157:
140 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 158 and 159:
142 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 160 and 161:
144 HISTOIRE POLITIQUE ET ADMINISTR
- Page 162 and 163:
146 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 164 and 165:
148 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 166 and 167:
150 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 168 and 169:
152 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 170 and 171:
154 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 172 and 173:
156 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 174 and 175:
158 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 176 and 177:
160 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 178 and 179:
162 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 180 and 181:
164 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ECONOMIQ
- Page 182 and 183:
166 HISTOIRE MONETAIRE ET ECONOMIQU
- Page 184 and 185:
168 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 186 and 187:
J70 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ECONOMIQ
- Page 188 and 189:
172 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 190 and 191:
174 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 192 and 193:
176 HISTOIRE MONETAIRE ET ECONOMIQU
- Page 194 and 195:
178 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 196 and 197:
180 HISTOIRE MONETAIRE ET ECONOMIQU
- Page 198 and 199:
182 HISTOIRE MONÉTAIRE ET ÉCONOMI
- Page 200 and 201:
CHAPITRE III HISTOIRE ARTISTIQUE So
- Page 202 and 203:
186 HISTOIRE ARTISTIQUE Usée à br
- Page 204 and 205:
188 HISTOIRE ARTISTIQUE revers ne s
- Page 206 and 207:
190 HISTOIRE ARTISTIQUE être adopt
- Page 208 and 209:
192 HISTOIRE ARTISTIQUE ment négli
- Page 210 and 211:
194 HISTOIRE ARTISTIQUE mais, soit
- Page 212 and 213:
196 HISTOIRE ARTISTIQUE de rémissi
- Page 214 and 215:
198 HISTOIRE ARTISTIQUE Sept graveu
- Page 216 and 217:
200 HISTOIRE ARTISTIQUE Louis XII,
- Page 218 and 219:
202 HUGUES CAPET DUC DES FRANCS GRA
- Page 220 and 221:
204 DE HUGUES CAPET A LOUIS Vil §1
- Page 222 and 223:
206 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. BO
- Page 224 and 225:
208 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. DU
- Page 226 and 227:
210 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. OR
- Page 228 and 229:
212 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. SE
- Page 230 and 231:
214 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. SO
- Page 232 and 233:
216 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII. IS
- Page 234 and 235:
218 DE HUGUES CAPET A LOUIS VII ^ r
- Page 236 and 237:
220 PHILIPPE II AUGUSTE § II. —
- Page 238 and 239:
222 PHILIPPE II AUGUSTE CIVI [Fig.
- Page 240 and 241:
J224 LOUIS VIII ET LOUIS IX Lottis
- Page 242 and 243:
226 LOUIS IX. ECU d'or § II. — B
- Page 244 and 245:
228 LOUIS IX, GROS TOURNOIS i au dr
- Page 246 and 247:
CHAPITRE VI PHILIPPE III Philipus r
- Page 248 and 249:
232 PHILIPPE III. TOULOUSAIN Toulou
- Page 250 and 251:
234 PHILIPPE IV LÉ BEL Date de l'o
- Page 252 and 253:
236 PHILIPPE IV. CHAISE. PETITS ROY
- Page 254 and 255:
238 PHILIPPE IV. GROS TOURNOIS de m
- Page 256 and 257:
240 PHILIPPE IV. DOUBLES règne, av
- Page 258 and 259:
CHAPITRE VIII LOUIS X ET PHILIPPE V
- Page 260 and 261:
CHAPITRE IX CHARLES IV LE BEL Karol
- Page 262 and 263:
246 CHARLES IV. MAILLE. MONNAIES NO
- Page 264 and 265:
248 PHILIPPE VI DE VALOIS 1
- Page 266 and 267:
250 PHILIPPE VI. ECU est en costume
- Page 268 and 269:
252 PHILIPPE VI. GROS 11 existe en
- Page 270 and 271:
254 PHILIPPE VI. MONNAIES NOIRES De
- Page 272 and 273:
256 JEAN II LE BON 1
- Page 274 and 275:
258 JEAN II LE BON. DENIER D OR. RO
- Page 276 and 277:
260 JEAN II LE BON. MAILLE ET GROS
- Page 278 and 279:
262 JEAN II LE BON. GROS ET BLANCS
- Page 280 and 281:
264 JEAN II LE BON. BLANC. GROS 2°
- Page 282 and 283:
266 JEAN II LE BON Deniers tournois
- Page 284 and 285:
268 CHARLES V. FRANC A PIED Franc a
- Page 286 and 287:
CHAPITRE XIII CHARLES VI Karolus re
- Page 288 and 289:
272 CHARLES VI. ATELIERS § II. —
- Page 290 and 291:
274 CHARLES VI. MOUTON. HEAUME (Pet
- Page 292 and 293:
J X de •276 CHARLES VI. GUENAR. G
- Page 294 and 295:
278 CHARLES VI. GROS HEAUME B Franc
- Page 296 and 297:
280 CHARLES VI. NIQUET NiQUET {Fig.
- Page 298 and 299:
282 HENRI V. OR. ARGENT H. Grueber,
- Page 300 and 301:
CHAPITRE XV HENRI VI D'ANGLETERRE R
- Page 302 and 303:
286 HENRI VI. TRESIN. MONNAIES NOIR
- Page 304 and 305:
288 CHARLES VII 1 Date de l'ordonna
- Page 306 and 307:
290 CHARLES VII. MOUTON. ROYAL D OR
- Page 308 and 309:
292 CHARLES VII. ECU. PLAQUE (renfo
- Page 310 and 311:
294 CHARLES VII. BLANCS ET GROS tr
- Page 312 and 313:
296 CHARLES VII. MONNAIES NOIRES de
- Page 314 and 315:
CHAPITRE XVII LOUIS XI Ludovicus re
- Page 316 and 317:
300 LOUIS XI. GROS, BLANC. HARDI. L
- Page 318 and 319:
302 LOUIS XI 2° Pour les initiales
- Page 320 and 321:
304 CHARLES VllI. ECU AU SOLEIL Ajo
- Page 322 and 323:
306 CHARLES VIII, GROS. HARDI. LIAR
- Page 324 and 325:
CHAPITRE XIX LOUIS XII Ludovicus re
- Page 326 and 327:
310 LOUIS XII. GROS DE ROI. BLANC L
- Page 328 and 329:
312 LOUIS XII. HARDI. LIARD. MONNAI
- Page 330 and 331:
CHAPITRE XX FRANÇOIS I" Franciscus
- Page 332 and 333:
316 FRANÇOIS 1^"". ECUS d'oR Écu
- Page 334 and 335:
^f 318 FRANÇOIS r"". TESTON ment d
- Page 336 and 337:
320 FRANÇOIS r\ DOUZAINS pondre à
- Page 338 and 339:
322 FRANÇOIS I^'. DOUBLES ET DENIE
- Page 340 and 341:
324 HENRI II. ECUS D OR p. 113-122
- Page 342 and 343:
326 HENRI II. GROS DE NESLE. DOUZAI
- Page 344 and 345:
CHAPITRE XXII CHARLES IX Carolus (q
- Page 346 and 347:
330 CHARLES IX. GROS et sur quelque
- Page 348 and 349:
CHAPITRE XXIII HENRI III (1574-1589
- Page 350 and 351:
334 HENRI III. TESTON § IV. — Mo
- Page 352 and 353:
336 HENRI Ili. DOUZAINS. LIARDS con
- Page 354 and 355:
CHAPITRE XXIV CHARLES X, ROI DE LA
- Page 356 and 357:
CHAPITRE XXV HENRI IV Henricus IIII
- Page 358 and 359:
342 HENRI n . FRANC. QUART d'ÉCU.
- Page 360 and 361:
CHAPITRE XXVI LOUIS XIII Ludovicus
- Page 362 and 363:
346 LOUIS XIII. DEMI-FRANC. QUART d
- Page 364 and 365:
348 LOUIS XIII. DOUZAIN. LIARD de H
- Page 366 and 367:
CHAPITRE XXVII LOUIS XIV Lnd. (ou L
- Page 368 and 369:
352 LOUIS XIV. ECU AU SOLEIL Besan
- Page 370 and 371:
354 LOUIS XIV. LIS d'or, quart d'EC
- Page 372 and 373:
356 LOUIS XIV Demi-écus reçoivent
- Page 374 and 375:
358 LOUIS XIV. LIS. VINGT SOLS A DE
- Page 376 and 377:
360 LOUIS XIV. BILLON Même droit.
- Page 378 and 379:
362 LOUIS XIV. DARDENNE 235-237). I
- Page 380 and 381:
364 LOUIS XV Ci-dessus, p. 142-143,
- Page 382 and 383:
366 LOUIS XV Pour affirmer qu'il y
- Page 384 and 385:
368 LOUIS XV poursuit par un second
- Page 386 and 387:
CHAPITRE XXIX LOUIS XVI Lud. XVI D.
- Page 388 and 389:
37*2 ' ECUS lance « avec laquelle
- Page 390 and 391:
i CHAPITRE XXX RÉPUBLIQUE (1793) C
- Page 392 and 393:
376 ITALIE Barcelone, — même lor
- Page 394 and 395:
378 DE CHARLES VI A LOUIS XI. SAVOX
- Page 396 and 397:
380 DE CHARLES VIII A FRANÇOIS I*^
- Page 398 and 399:
382 DE CHARLES VIII A FRANÇOIS I^*
- Page 400 and 401:
384 DE CHARLES VIII A FRANÇOIS I®
- Page 402 and 403:
386 HENRI II. SIENNE Cavallo. — M
- Page 404 and 405:
388 LOUIS XIII ET LOUIS XIV. ESPAGN
- Page 406 and 407:
390 LOUIS XIV. MODÈNE MenuL — LV
- Page 408 and 409:
392 DE LOUIS XIV A LOUIS XVI. COLON
- Page 410 and 411:
394 LISTE DES ATELIERS rencontrent
- Page 412 and 413:
396 LISTE DES ATELIERS août 1420 p
- Page 414 and 415:
398 LISTE DES ATELIERS Bordeaux K P
- Page 416 and 417:
400 LISTE DIÎS ATELIERS Bruges. Ph
- Page 418 and 419:
402 LISTE DES ATELIERS GoNDOM. Monn
- Page 420 and 421:
404 LISTE DES ATELIERS était une F
- Page 422 and 423:
406 LISTE DES ATELIERS reparaît qu
- Page 424 and 425:
408 LISTE DES ATELJERS et quelquefo
- Page 426 and 427:
410 LISTE DES ATELIERS comme sur Fi
- Page 428 and 429:
412 LISTE DES ATELIERS 1421, p. 126
- Page 430 and 431:
414 LISTE DES ATELIERS différenl p
- Page 432 and 433:
416 LISTE DES ATELIERS et pour Char
- Page 434 and 435:
418 LISTE DES ATELIERS MONETAIRES S
- Page 436 and 437:
420 LISTE DES ATELIERS MONETAIRES T
- Page 438 and 439:
422 LISTE DES ATELIERS MONETAIRES c
- Page 440 and 441:
CHAPITRE XXXIII LISTE DES NOMS DE M
- Page 442 and 443:
426 LISTE DES NOMS DE MAITRES ET DE
- Page 444 and 445:
428 LISTE DES NOMS DE MAITRES ET DE
- Page 446 and 447:
430 LISTE DES NOMS DE MAITRES ET DE
- Page 448 and 449:
•432 LISTE DES NOMS DE MAITRES ET
- Page 451 and 452:
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE Les principau
- Page 453 and 454:
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE 437 NocQ (H.)
- Page 455 and 456:
INDEX ANALYTIQUE' A. Variétés de
- Page 457 and 458:
Blanc de compte, 78 n. 3, 101 ; de
- Page 459 and 460:
(1" Écu et Écu sol), 300, 304, 30
- Page 461 and 462:
— Tinple, 73 Quadruple, 74 n. 1 .
- Page 463 and 464:
de roi, 288, 293, 295, 298, 300, 30
- Page 465 and 466:
76-98, 99. Valeur de la 1. tournois
- Page 467 and 468:
Niquet, ni. noire. 271, 280. Noaill
- Page 469 and 470:
Prix des monnaies en valeur de comp
- Page 471 and 472:
Tarascon, atelier, 419. Tarasque, 1
- Page 473 and 474:
Préf. TABLE DES CHAPITRES DE CE TO
- Page 475 and 476:
TABLE DES CHAPITRES 459 II. Orig-in
- Page 477 and 478:
Chapitre premier : Hugues 981) Chap
- Page 479 and 480:
TABLE DES CHAPITRES 463 Chapitre XV
- Page 481 and 482:
LISTE DES MONNAIES FIGURÉES SUR LE
- Page 483 and 484:
LISTE DES MONNAIES FIGUREES SUR LES
- Page 485:
DE SAINT LOUIS A JEAN LE BON PI. I
- Page 489:
.^ sp>' ^ ^^ ';- /%^ •^;_^____^ L
- Page 493:
•-*7*,J^'^^_ H Mé LOUIS XIII, LO
- Page 497:
PI. VII DAUPHINÉ, BRETAGNE, PROVEN
- Page 501:
PI. IX / ^%^'^ :# MONNAIES FRAPPÉE