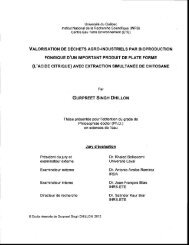2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
épisodes glaciaires; ii) la superposition de<br />
séquences de remplissage de cônes de bas<br />
niveaux marins qui surmontent ou s’interdigitent<br />
dans les séquences anciennes; iii) la présence<br />
de gaz naturel dans les successions sableuses,<br />
qui peuvent former d’excellents réservoirs pour<br />
un éventuel stockage de gaz naturel; iv) la<br />
présence d’hydrates de gaz, qui représentent<br />
une ressource gigantesque de combustible<br />
fossile; et v) le contact Quaternaire –<br />
Paléozoïque, ainsi que la structure épidermale<br />
du bassin pré-quaternaire en précisant la nature<br />
des contacts entre les diverses unités préquaternaires/CGC<br />
et HQ.<br />
Comité d’experts sur les levées sismiques<br />
dans le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent<br />
Le comité d’experts identifiera les enjeux<br />
environnementaux associés aux campagnes<br />
proposées de levées sismiques dans le golfe et<br />
l’estuaire du Saint-Laurent. A cet effet, il fera<br />
état de la connaissance sur les techniques de<br />
levées sismiques, sur les impacts potentiels de<br />
ces activités sur le milieu naturel, sur les<br />
activités humaines et sur les modalités de<br />
réalisation aptes à atténuer leurs impacts. Le<br />
comité formulera ses recommandations sur<br />
l’opportunité d’un encadrement de ces activités<br />
aux plans technique et scientifique, et sur les<br />
conditions qui permettraient d’assurer le<br />
développement durable des ressources du golfe<br />
et de l’estuaire. Le comité produira un rapport<br />
qui sera rendu public et utilisé comme document<br />
de référence, pour la consultation qui sera<br />
conduite par le Bureau d’audiences publiques<br />
sur l’environnement/ Ministère des Ressources<br />
Naturelle, de la Faune et des Parcs.<br />
Alain MAILHOT, professeur<br />
Hydrologie<br />
Modélisation en milieu urbain<br />
La recherche proposée porte sur des<br />
problématiques liées à la modélisation<br />
physique, hydraulique et hydrologique en milieu<br />
urbain. Elle recoupe trois axes de recherche, à<br />
savoir; i) l’évolution de l’état structural des<br />
infrastructures souterraines d’eau; ii) l’impact<br />
des changements climatiques en milieu urbain;<br />
et iii) la modélisation des impacts des usages<br />
urbains de l’eau sur les milieux récepteurs. Les<br />
travaux scientifiques réalisés à travers ces<br />
différents ouvrages seront menés en parallèle<br />
puisqu’ils feront appel à plusieurs techniques<br />
mathématiques communes (techniques<br />
d’analyses statistiques, algorithmes et outils<br />
numériques, modèles de simulation, techniques<br />
d’analyse d’incertitudes, méthodes d’analyse de<br />
fiabilité (“reliability analysis”) et d’analyse de<br />
sensibilité). Concernant plus spécifiquement le<br />
volet Infrastructures souterraines d’eau, il s’agit<br />
de développer des modèles d’estimation des<br />
probabilités d’occurrence des bris d’aqueduc,<br />
dont la mise en place permettra une meilleure<br />
planification des interventions de remplacement<br />
des conduites sur les réseaux. La qualité des<br />
résultats et de la planification qui en résultera<br />
49<br />
est cependant intimement liée aux incertitudes<br />
inhérentes à ce type de modélisation, qui<br />
peuvent être importantes dans plusieurs cas.<br />
L’objectif est d’élaborer une méthodologie<br />
permettant l’estimation des solutions optimales<br />
qui intègre les incertitudes associées à ce type<br />
de modélisation, et d’estimer dans quelle<br />
mesure la qualité et le volume de données<br />
actuellement disponibles affecteront la<br />
performance de ce type d’approche. Concernant<br />
le volet Changements climatiques en milieu<br />
urbain, il s’agit, dans un premier temps,<br />
d’évaluer la capacité actuelle des réseaux à<br />
acheminer les eaux pluviales dans un contexte<br />
de changements climatiques. Cette étude<br />
permettra de voir l’incidence de ces<br />
changements sur les probabilités d’occurrence<br />
de refoulements, de débordements, et sur la<br />
qualité des milieux récepteurs. Il s’agira aussi<br />
de voir comment différentes modifications aux<br />
infrastructures ou à la gestion des réseaux<br />
pourraient être revues afin de diminuer les<br />
impacts négatifs occasionnés par ces<br />
changements. Finalement, le volet Modélisation<br />
des impacts des usages urbains de l’eau sur les<br />
milieux récepteurs s’intéresse à la quantification<br />
des impacts des rejets urbains en milieu<br />
récepteur. Plusieurs auteurs ont en effet<br />
proposé de modifier l’objectif du contrôle en<br />
temps réel pour le faire passer d’un objectif de<br />
minimisation des volumes déversés à un objectif<br />
de minimisation des impacts sur la qualité du<br />
milieu récepteur. Une telle modification implique<br />
une modélisation de la qualité de l’eau du milieu<br />
récepteur. Or, les modèles de qualité de l’eau<br />
se distinguent par leur complexité relative, par le<br />
nombre important de variables et de paramètres<br />
qui les composent, par le nombre élevé de<br />
variables d’entrée que leur mise en place exige,<br />
et enfin par le nombre très limité de données<br />
disponibles pour leur validation. Il importe donc<br />
de s’interroger sur l’impact des différentes<br />
incertitudes sur les résultats de simulation de<br />
ces modèles. Cet axe de recherche entend<br />
examiner cette question et voir, dans un premier<br />
temps, comment les incertitudes sur les<br />
paramètres et sur les données d’entrée d’un<br />
modèle de qualité de l’eau déterminent les<br />
incertitudes sur les variables simulées. À plus<br />
long terme, ce travail s’inscrit dans une<br />
démarche visant à déterminer si, sur la base<br />
des informations généralement disponibles, il<br />
est possible d’escompter avoir une performance<br />
suffisante des modèles de qualité de l’eau pour<br />
pouvoir appliquer ces modèles à un contrôle en<br />
temps réel basé sur une minimisation de<br />
l’impact des rejets en milieu récepteur/CRSNG/<br />
Coll : S. Duchesne, A.N. Rousseau, J.-P.<br />
Villeneuve.