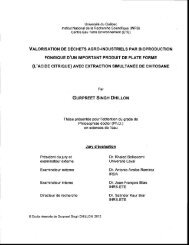2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
2003-2004 - Centre - Eau Terre Environnement - INRS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ou directement dans la fosse à lisier. Les sousproduits<br />
seront caractérisés, d’un point de vue<br />
chimique, au début et à la fin de la période de<br />
stockage/ Corporation Horizon <strong>Environnement</strong><br />
Technologies/ Coll.: Blais, J.F.<br />
Léopold NADEAU, professeur associé<br />
Géodynamique<br />
Cadre lithotectonique de la partie orientale<br />
de la province de Grenville : Transect<br />
Labrador-Québec (Programme de l’Initiative<br />
géoscientifique ciblée de la CGC)<br />
Des travaux de géologie régionale et structurale<br />
ont été menés dans la séquence supracrustale<br />
du Groupe de Wakeham, entre Havre Saint-<br />
Pierre et Natashquan. Les levés menés à l’est<br />
de Natashquan ont révélé l’origine plutonique du<br />
domaine de La Romaine, qui renferme des<br />
roches volcano-sédimentaires et<br />
hydrothermales minéralisées en cuivre et au<br />
faciès des granulites. La découverte d’une<br />
intrusion litée à péridotite et troctolite<br />
minéralisée en cuivre, son potentiel en nickel,<br />
cuivre et platinoïdes et les évidences<br />
d’hydrothermalisme de métasédiments en milieu<br />
volcano-plutonique ont permis d’accroître la<br />
collaboration avec le MRN, afin de mieux cerner<br />
le potentiel économique régional. Ce projet est<br />
réalisé en partenariat avec les services<br />
géologiques du Québec et de <strong>Terre</strong>-Neuve et<br />
les universités. Il a pour but de dresser de<br />
nouvelles cartes et de mettre au point de<br />
nouveaux outils et modèles afin d’élargir les<br />
connaissances et d’établir de nouveaux cadres<br />
d’exploration pour l’est du Québec et le<br />
Labrador, connus pour leurs gisements de<br />
nickel-cuivre, de fer et de titane, de rang<br />
mondial/ CGC/ Coll. : L. Corriveau (CGC-Q),),<br />
P. Brouillette (CGC-Q), F. Gervais, G. Scherrer,<br />
A-L Bonnet, S. Parsons, M. Malo.<br />
Taha OUARDA, professeur<br />
Hydrologie<br />
Estimation régionale des variables<br />
hydrologiques<br />
Lorsque l’information hydrologique en un site<br />
est absente ou insuffisante, l’estimation des<br />
variables hydrologiques peut être effectuée par<br />
des modèles régionaux. Le principe est de<br />
transposer au site d’intérêt l’information spatiale<br />
provenant de bassins ayant un régime<br />
hydrologique similaire. Le programme de<br />
recherche comprend :<br />
Développement de modèles fréquentiels<br />
régionaux<br />
Les recherches sur l’estimation régionale des<br />
variables hydrologiques concernent : i) la<br />
modélisation explicite de l’hétérogénéité<br />
régionale et la quantification de la précision des<br />
estimations régionales des quantiles de crues;<br />
ii) la prise en compte des corrélations entre les<br />
différentes variables explicatives et les variables<br />
dépendantes, et la combinaison de l’information<br />
54<br />
locale et régionale; iii) le développement de<br />
modèles robustes en poursuivant le<br />
développement de la méthode de l’analyse des<br />
corrélations canoniques, par exemple en<br />
utilisant l’estimateur de James-Stein; iv) le<br />
développement de modèles régionaux de crues<br />
intégrant l’utilisation du GRADEX (gradient des<br />
valeurs extrêmes) des pluies; v) la<br />
régionalisation d’autres variables telles que les<br />
volumes de crues et les paramètres de<br />
modèles; et vi) le développement de modèles<br />
régionaux utilisant les queues des distributions<br />
(parties extrêmes des distributions) ainsi que<br />
l’information alternative (par ex., données<br />
historiques).<br />
Application à la modélisation des apports<br />
prévisionnels<br />
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de<br />
l’estimation et de la régionalisation des<br />
paramètres de modèles hydrologiques (modèles<br />
conceptuels, hydrogrammes unitaires) utilisés<br />
pour transformer les données météorologiques<br />
affectant un bassin-versant en écoulements<br />
naturels. Cependant, les estimations des<br />
paramètres de modèles hydrologiques sont<br />
entachées d’incertitude et représentent donc<br />
des paramètres stochastiques. Les sorties des<br />
modèles hydrologiques basés sur ces<br />
paramètres stochastiques représentent donc<br />
des variables aléatoires. On propose d’effectuer<br />
une analyse systématique des incertitudes<br />
associées à ces paramètres, et d’évaluer la<br />
propagation de cette incertitude dans la<br />
modélisation des apports. Ces travaux<br />
permettront d’améliorer la représentativité des<br />
séries prévisionnelles d’apports/ CRSNG/ Coll. :<br />
B. Bobée, M. Haché.<br />
Développement d’un modèle hydrologique<br />
visant l’estimation des débits d’étiage pour<br />
le Québec habité<br />
L’objectif de ce projet est de développer un outil<br />
hydrologique/statistique permettant de calculer<br />
les débits d’étiages pour les régions<br />
méridionales du Québec (au sud du 51 e<br />
parallèle) selon une procédure rationnelle,<br />
rapide et efficace. Le projet consiste d’abord à<br />
appliquer la méthode d’analyse fréquentielle<br />
pour l’estimation des quantiles d’étiage de 1,7 et<br />
30 jours consécutifs et correspondant à des<br />
périodes de retour de 2, 5 et 10 ans, pour toutes<br />
les stations hydrométriques du Ministère qui<br />
sont naturelles et qui disposent de suffisamment<br />
d’années d’information. Ce travail sera fait<br />
séparément pour les périodes annuelles,<br />
estivales et mensuelles. Ensuite, on aura<br />
recours à une procédure d’estimation régionale<br />
pour évaluer les quantiles d’étiage aux sites où<br />
l’on ne dispose pas de suffisamment<br />
d’information. Une méthodologie d’estimation<br />
régionale se divise en deux étapes : i) la<br />
définition et la détermination des régions<br />
hydrologiquement homogènes sur la base de<br />
caractéristiques physiographiques et/ou<br />
météorologiques; et ii) l’estimation régionale, qui<br />
permet de développer des équations régionales<br />
pour chaque RHH. Finalement, des cartes de