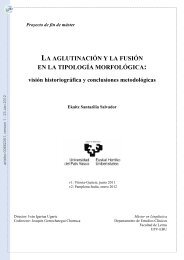L'ibère et le basque: recherches et comparaisons
L'ibère et le basque: recherches et comparaisons
L'ibère et le basque: recherches et comparaisons
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00465824, version 1 - 22 Mar 2010<br />
variantes orienta<strong>le</strong> <strong>et</strong> sud-orienta<strong>le</strong>, serait dans l’alphab<strong>et</strong> phénicien : <strong>le</strong>s Phéniciens ont<br />
occupé une partie de l’orient ibérique du milieu du VIIIème sièc<strong>le</strong> avant notre ère jusqu’au<br />
milieu du IIIème, avant l’arrivée des Carthaginois puis très vite (fin du IIIème sièc<strong>le</strong> : prise<br />
Sagonte en -212) des Romains.<br />
Il faut noter, dans <strong>le</strong> système ainsi décrit, l’absence de toute référence à<br />
l’aspiration, l’un des traits phonétiques majeurs de la langue <strong>basque</strong> en tous domaines<br />
dia<strong>le</strong>ctaux à l’époque la plus anciennement documentée (X-XIèmes sièc<strong>le</strong>s), réduit ensuite<br />
dia<strong>le</strong>cta<strong>le</strong>ment, jusqu’à sa disparition quasi complète dans la prononciation – sinon la graphie<br />
- contemporaine : aspiration initia<strong>le</strong>, intervocalique, ou consonnes aspirées. Or on sait que,<br />
très nombreuses dans <strong>le</strong>s inscriptions dites « aquitaines » d’époque antique qui ne se réfèrent<br />
peut-être pas à l’ibère, <strong>le</strong>s aspirations sont aussi des éléments qui différencient ces citations de<br />
la langue dans laquel<strong>le</strong> el<strong>le</strong>s sont insérées, <strong>le</strong> latin, qui a des aspirations initia<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
intervocaliques, mais ignore <strong>le</strong>s consonnes aspirées, occlusives kh, th, ou apica<strong>le</strong>s lh, nh, rh.<br />
Des aspirations initia<strong>le</strong> <strong>et</strong> intervocalique du <strong>basque</strong> auraient cependant un<br />
antécédent ibère dans l’occlusive sourde vélaire k. A l’initia<strong>le</strong>, à l’ibère karri correspond ainsi<br />
<strong>le</strong> <strong>basque</strong> harri « pierre », ce qui appel<strong>le</strong> trois remarques complémentaires : d’abord qu’il<br />
semb<strong>le</strong> aujourd’hui démontré que la base kar-/gar- a eu à époque ancienne une extension paneuropéenne,<br />
<strong>et</strong> pas seu<strong>le</strong>ment ibérique, ayant laissé partout de nombreux toponymes, y<br />
compris en pays bascophones <strong>et</strong> ici bien distincts en général des noms de lieux, probab<strong>le</strong>ment<br />
postérieurs mais déjà nombreux dans <strong>le</strong>s textes des XI-XIIèmes sièc<strong>le</strong>s, faits sur harri ;<br />
ensuite que <strong>le</strong> passage de kar- à har- a pu être documenté encore à époque historique en<br />
toponymie alavaise dans l’exemp<strong>le</strong> de carrelucea (1025), évolué ensuite en arlucea (1189)<br />
après une étape d’aspiration avec h- effacée par la régression généra<strong>le</strong> <strong>et</strong> rapide de l’aspiration<br />
en domaine ibérique <strong>basque</strong>, à moins que <strong>le</strong> k- initial n’ait été déjà une manière de représenter<br />
graphiquement, non une occlusive réel<strong>le</strong>, mais une aspiration forte comme cel<strong>le</strong> de l’anglais<br />
ou de l’al<strong>le</strong>mand, plus forte en tout cas que cel<strong>le</strong> du latin (voir plus loin) ; enfin que <strong>le</strong> mot a<br />
pu être importé dans <strong>le</strong> <strong>basque</strong>, qui nommait déjà la « pierre », <strong>le</strong> « rocher » par <strong>le</strong> mot aitz,<br />
encore plus prolifique en toponymie de toute zone montagneuse aujourd’hui ou anciennement<br />
bascophone. En position intervocalique on aurait la même correspondance : ibère bekor <strong>et</strong><br />
<strong>basque</strong> behor « jument », ibère sakar <strong>et</strong> <strong>basque</strong> zahar « vieux ».<br />
Dans <strong>le</strong> même ordre on aurait en ibère un déterminant-pronom démonstratif kau,<br />
correspondant au démonstratif <strong>basque</strong> de proximité hau(r) (l’effacement de la vibrante douce<br />
fina<strong>le</strong> est tardive d’après <strong>le</strong>s textes connus), mais qui était articulé kau en roncalais comme <strong>le</strong>s<br />
autres aspirations initia<strong>le</strong>s (dans une l<strong>et</strong>tre de 1884 : quemen, cona pour hemen, hona(ra)<br />
dérivés de haur « celui-ci », mais ori pour hori « celui-là »), ce qui ne change donc en rien <strong>le</strong>s<br />
données du problème, à savoir la relation entre la nature phonétique réel<strong>le</strong> de c<strong>et</strong>te aspiration<br />
<strong>et</strong> sa transcription grahique. Le fait que <strong>le</strong> <strong>basque</strong> a longtemps réalisé <strong>le</strong>s occlusives sourdes<br />
initia<strong>le</strong>s latines non par des aspirées mais par des sonores (causa > gauza), ce qui se produit<br />
aussi peut-être entre ibère <strong>et</strong> <strong>basque</strong> (caco > gako « croch<strong>et</strong> » <strong>et</strong> par extension de sens<br />
« c<strong>le</strong>f »), complique un peu la question.<br />
Comme l’initia<strong>le</strong> occlusive vélaire sourde k- du latin, <strong>le</strong> <strong>basque</strong> a sonorisé dans<br />
ses emprunts latins <strong>et</strong> romans non seu<strong>le</strong>ment la bilabia<strong>le</strong> latine p- (pace > bake « paix », pice<br />
> bike « poix »), mais aussi la denta<strong>le</strong> t-, malgré l’obstac<strong>le</strong> signalé de l’absence en <strong>le</strong>xique<br />
<strong>basque</strong> <strong>et</strong> en ibère d’un d- initial non verbal (tastatu > dastatu, <strong>et</strong> jastatu par palatalisation<br />
secondaire, tempora > dembora, torre > dorre). Or d’après <strong>le</strong>s analyses de L. Silgo Gauche,<br />
<strong>le</strong> « résultat » d’une occlusive denta<strong>le</strong> intia<strong>le</strong> t-, ou interne –t- de l’ibère, aurait été aussi une<br />
aspirée en <strong>basque</strong>. Le toponyme ibère Turissa aurait présenté une forme ancienne de ithurri<br />
« source, fontaine », mais, si la correspondance avec <strong>le</strong> mot <strong>basque</strong> (en toponymie ancienne<br />
lamiturri 945, iturrioz 1025 ; l’aspiration est dans <strong>le</strong>s dia<strong>le</strong>ctes aquitains : 1189 ithurriaycita)<br />
est comme il semb<strong>le</strong> bien avérée, c’est vraisemblab<strong>le</strong>ment une forme altérée : vibrante faib<strong>le</strong><br />
4