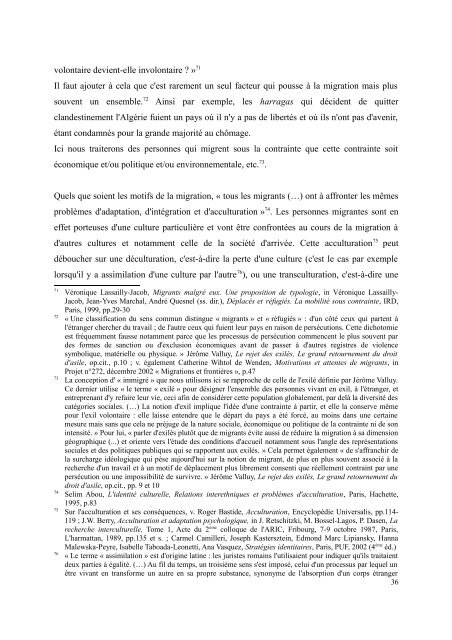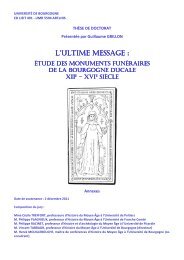- Page 1: UNIVERSITE DE BOURGOGNE UFR Droit e
- Page 5 and 6: Résumé Les enfants (d') immigrés
- Page 7 and 8: Table des matières Introduction...
- Page 9 and 10: hétérogène sur le territoire....
- Page 11 and 12: 1. L’image du personnage étrange
- Page 13: B. Quelle(s) représentation(s) des
- Page 16 and 17: Annexe 18 - Évolution du pourcenta
- Page 19: Index des tableaux et graphique Tab
- Page 22 and 23: IGEN Inspection Générale de l'Éd
- Page 25 and 26: Le 22 mai 2011, Claude Guéant, Min
- Page 27 and 28: et aussi légitimer - ces dernière
- Page 29 and 30: fraudeur 26 , suspect, dont il faut
- Page 31 and 32: leur renvoyant une image stigmatis
- Page 33 and 34: 883 demandes de mineurs 53 et 3 260
- Page 35: Dans notre recherche, nous nous int
- Page 39 and 40: psychologiques (…) dont la forme
- Page 41 and 42: Tout être humain est porteur de cu
- Page 43 and 44: dans lequel elle s'est développée
- Page 45 and 46: définition, la transmission d'une
- Page 47 and 48: effet, plusieurs études ont montr
- Page 49 and 50: D'autre part, reprenant le proverbe
- Page 51 and 52: vestimentaire, modalités de relati
- Page 53 and 54: intermédiaire, directement, sans p
- Page 55 and 56: La dévalorisation/délégitimation
- Page 57 and 58: système de repères sociaux, d'un
- Page 59 and 60: la présence d'enfants porteurs d'a
- Page 61 and 62: Notre recherche portant sur l'immig
- Page 63: ont donné nous semble-t-il du corp
- Page 67 and 68: On a l'habitude de faire remonter l
- Page 69 and 70: Chapitre 1 - Les structures d'accue
- Page 71 and 72: étudier les fondements et fonction
- Page 73 and 74: Le public concerné par ces structu
- Page 75 and 76: Deux cas étaient distingués par l
- Page 77 and 78: École primaire Collège Lycée Tot
- Page 79 and 80: peuvent vivre (c). a. La fluctuatio
- Page 81 and 82: Pays d'origine Classe d'accueil d'E
- Page 83 and 84: Cette diversité quant à la scolar
- Page 85 and 86: demandeurs d'asile, travail ou non
- Page 87 and 88:
groupes de niveaux dans la classe,
- Page 89 and 90:
élèves étaient répartis en deux
- Page 91 and 92:
En outre, la CLA disposait d'une t
- Page 93 and 94:
B. Les structures d'accueil au sein
- Page 95 and 96:
professeur de la CLA du collège de
- Page 97 and 98:
professeurs vont privilégier les a
- Page 99 and 100:
primo-arrivants dans les écoles (2
- Page 101 and 102:
attention, il faut varier au maximu
- Page 103 and 104:
propose une orientation qui corresp
- Page 105 and 106:
non francophone et enfant handicap
- Page 107 and 108:
primaire parlent des enfants allogl
- Page 109 and 110:
observations que nous avons pu fair
- Page 111 and 112:
français, est un aspect important
- Page 113 and 114:
Des auteurs critiquent la rareté d
- Page 115 and 116:
faire la part des choses entre des
- Page 117 and 118:
dans lequel il vit et de qui le jug
- Page 119 and 120:
Les enseignants de CLIN ou de CLA d
- Page 121 and 122:
voire dans la société française
- Page 123 and 124:
maternelle, qui, sans être parlée
- Page 125 and 126:
D'une part, cette inadaptation tien
- Page 127 and 128:
Cependant, la langue de l'enfant n'
- Page 129 and 130:
Apprendre une langue ne se limite p
- Page 131 and 132:
intégrer un cursus dit normal, ce
- Page 133 and 134:
« ordinaire » en arguant de la ma
- Page 135 and 136:
sorte de voie moyenne entre l'assim
- Page 137 and 138:
Chapitre 2. Les Enseignements des L
- Page 139 and 140:
d'enseignement bilingue). » 415 Au
- Page 141 and 142:
des accords signés par la France e
- Page 143 and 144:
pédagogiques et aux résultats des
- Page 145 and 146:
En 1979, est instituée une commiss
- Page 147 and 148:
apport sur les ELCO de 2006 et de c
- Page 149 and 150:
1984- 1985* 1985- 1986* 1986- 1987*
- Page 151 and 152:
volonté de l'État marocain de dé
- Page 153 and 154:
marginalisation qu'à son intégrat
- Page 155 and 156:
étrangères à l'école primaire (
- Page 157 and 158:
Nationale précisent certaines moda
- Page 159 and 160:
en effet que rarement intégrés au
- Page 161 and 162:
(mais avec la possibilité de prolo
- Page 163 and 164:
Nous trouvons en annexe de cette no
- Page 165 and 166:
problèmes rencontrés par les ense
- Page 167 and 168:
plusieurs villes parfois 511 , voir
- Page 169 and 170:
disposons pas d'éléments récents
- Page 171 and 172:
Cette diversité d'âge et de nivea
- Page 173 and 174:
ce qui concerne la langue parlée a
- Page 175 and 176:
Parmi les raisons invoquées 544 po
- Page 177 and 178:
semble pas adapté au public des EL
- Page 179 and 180:
2. L'ignorance et la non prise en c
- Page 181 and 182:
au vu de ce que nous avons dévelop
- Page 183 and 184:
suggestions qui pourraient être fa
- Page 185 and 186:
Cette question est en lien avec la
- Page 187 and 188:
En effet, les personnes immigrées
- Page 189 and 190:
langue parlée par les familles des
- Page 191 and 192:
nos observations dans un des ELCO a
- Page 193 and 194:
emporter des conséquences sur les
- Page 195 and 196:
En nous basant sur cette analyse, n
- Page 197 and 198:
dérive anti-laïque. Ces enseignem
- Page 199 and 200:
voir si une évolution positive a
- Page 201 and 202:
d'autres cas, la langue étrangère
- Page 203 and 204:
« nobles », jugées dignes d'int
- Page 205 and 206:
Partie 2 - Occidentalocentrisme dan
- Page 207 and 208:
L’occidentalocentrisme est une fo
- Page 209 and 210:
principaux outils de l’enseignant
- Page 211 and 212:
Chapitre 1. Prise en compte des cul
- Page 213 and 214:
poétiques du XIX ème ou du XX èm
- Page 215 and 216:
« Blancs » est posée comme princ
- Page 217 and 218:
Nous pouvons enfin nous interroger
- Page 219 and 220:
omans centrés sur la vie affective
- Page 221 and 222:
chiliens et 1 uruguayen), 2 asiatiq
- Page 223 and 224:
Cette étude portera sur les manuel
- Page 225 and 226:
étaient parmi ceux qui présentaie
- Page 227 and 228:
1. Des auteurs étrangers et des te
- Page 229 and 230:
est concédée est semblable à tou
- Page 231 and 232:
manuels. Selon les manuels, le pour
- Page 233 and 234:
important de poésies s'explique en
- Page 235 and 236:
père britannique (J.M.G. Le Clézi
- Page 237 and 238:
Départements d’Outre-Mer frança
- Page 239 and 240:
Arabes nous suivaient en criant »
- Page 241 and 242:
Condition humaine 761 : il s’agit
- Page 243 and 244:
l’autobiographie de Patrick Chamo
- Page 245 and 246:
cris de bêtes et les passants leur
- Page 247 and 248:
sommes loin de l’étranger pauvre
- Page 249 and 250:
que ce ne soit pas pour les mêmes
- Page 251 and 252:
L’image d’un ailleurs où règn
- Page 253 and 254:
Celles-ci sont conjuguées dans deu
- Page 255 and 256:
sur l’école et son manque de rel
- Page 257 and 258:
Conclusion Nous pouvons conclure de
- Page 259 and 260:
objectif œuvre plus en faveur d’
- Page 261 and 262:
Ainsi, par exemple, en ce qui conce
- Page 263 and 264:
les angles morts. » 849 De plus, b
- Page 265 and 266:
décrite dans l’ouvrage de Roy Pr
- Page 267 and 268:
temps d'une société pour explicit
- Page 269 and 270:
être utilisés de manière pertine
- Page 271 and 272:
. L’omission dans la présentatio
- Page 273 and 274:
Si les peuples extra-occidentaux so
- Page 275 and 276:
Outre le fait que les empires aient
- Page 277 and 278:
est découpé et parsemé dans les
- Page 279 and 280:
parties consacrées aux croisades (
- Page 281 and 282:
Seul le manuel de Hatier avance une
- Page 283 and 284:
δ. Omission, simplification et/ou
- Page 285 and 286:
Le manuel de Hatier présente un ex
- Page 287 and 288:
effet, la majeure partie des partie
- Page 289 and 290:
Nous pouvons remarquer que le même
- Page 291 and 292:
β. La mise en avant de certains é
- Page 293 and 294:
(de celui-ci) sont encore vivantes
- Page 295 and 296:
Hachette (p.168), la conquête de l
- Page 297 and 298:
Nous avons constaté que dans la ma
- Page 299 and 300:
l'ensemble des manuels, les termes
- Page 301 and 302:
monde » et de « phénomène colon
- Page 303 and 304:
terres colonisées sont vides, ne s
- Page 305 and 306:
Là aussi, les terres ne semblent p
- Page 307 and 308:
les acteurs occidentaux (« mission
- Page 309 and 310:
acteurs n'est effectivement pas la
- Page 311 and 312:
Lorsque la guerre d'Algérie est ab
- Page 313 and 314:
3. La supériorité-domination des
- Page 315 and 316:
supériorité militaire européenne
- Page 317 and 318:
les documents mais en ce qui concer
- Page 319 and 320:
L'analyse actancielle des différen
- Page 321 and 322:
« travailler », « construire »,
- Page 323 and 324:
des verbes d'action, au sens d'acti
- Page 325 and 326:
éléments au profit des acteurs oc
- Page 327 and 328:
plus représentés. Il en est de m
- Page 329 and 330:
outrancière à un Dieu qui, à tou
- Page 331 and 332:
Allah, de la prière, du pèlerinag
- Page 333 and 334:
pacte du calife Omar avec les chré
- Page 335 and 336:
2. L'expansion du monde arabo-musul
- Page 337 and 338:
« s'enrichir en pillant l'ennemi
- Page 339 and 340:
Le manuel de Magnard (p.29) est le
- Page 341 and 342:
eligion et coutumes. » 1135 Nous p
- Page 343 and 344:
Conclusion de la Partie 2 Les progr
- Page 345 and 346:
Conclusion 345
- Page 347 and 348:
« Alors que le culturel structure
- Page 349 and 350:
d'arrivée, la langue familiale sub
- Page 351 and 352:
Par delà l'acquisition de la langu
- Page 353 and 354:
Parmi ces stratégies identitaires,
- Page 355 and 356:
héros « positifs » tombés sous
- Page 357 and 358:
Bibliographie 357
- Page 359 and 360:
Ouvrages AA.VV., Frontera Sur, Nuev
- Page 361 and 362:
Brouwer, 1996 Bouamama Saïd, Les d
- Page 363 and 364:
Decourt Nadine, Raynaud Michelle, C
- Page 365 and 366:
marocaine aux enfants marocains ré
- Page 367 and 368:
Lucchini Silvia, Maravelaki Aphrodi
- Page 369 and 370:
Rahmani Zahia, France récit d'une
- Page 371 and 372:
Wachtel Nathan, La vision des vainc
- Page 373 and 374:
mai 1988, organisé par l'ADRI, Par
- Page 375 and 376:
scolaire en France, Thèse de scien
- Page 377 and 378:
Migrants-formation n°73, juin 1988
- Page 379 and 380:
français », pp.171-176 Gaspard Fr
- Page 381 and 382:
Mc Andrew Marie, Ciceri Coryse, L'e
- Page 383 and 384:
formation, n°83, décembre 1990, p
- Page 385 and 386:
Ministère de l'Éducation National
- Page 387 and 388:
décembre 1981, publié par le déc
- Page 389 and 390:
enseignement en leur langue nationa
- Page 391 and 392:
Sitographie Sites institutionnels n
- Page 393 and 394:
Annexes 393
- Page 395 and 396:
Annexe 1 - Répartition de la popul
- Page 397 and 398:
Annexe 3 - Répartition des immigr
- Page 399 and 400:
Annexe 5 - Nombre de premières dem
- Page 401 and 402:
Annexe 7 - Répartition de la popul
- Page 403 and 404:
Annexe 9 - Répartition des naissan
- Page 405 and 406:
Annexe 11 - Répartition de la popu
- Page 407 and 408:
Autres nationalitésd'Afrique Agric
- Page 409 and 410:
Répartition de la population par c
- Page 411 and 412:
Pays d'origine ou nationalité Autr
- Page 413 and 414:
2/ Répartition géographique de la
- Page 415 and 416:
4/ Répartition de la population ac
- Page 417 and 418:
* Secteur industriel Les cartes ont
- Page 419 and 420:
Annexe 15 - Emplacement des classes
- Page 421 and 422:
Annexe 16 - Évolution du nombre d'
- Page 423 and 424:
423
- Page 425 and 426:
Annexe 19 - Questionnaire adressé
- Page 427 and 428:
Annexe 20 - Questionnaire aux profe
- Page 429 and 430:
2/ Carte représentant les effectif
- Page 431 and 432:
6/ Carte représentant les effectif
- Page 433 and 434:
Les cartes ont été réalisées pa
- Page 435 and 436:
Sources : 1984 à 1990 : Notes d'in
- Page 437 and 438:
Annexe 24 - Évolution des effectif
- Page 439 and 440:
Annexe 26 - Évolution des effectif
- Page 441 and 442:
8/ Savez-vous ce qu'ils apprennent
- Page 443 and 444:
- employé de bureau - employé de
- Page 445 and 446:
Annexe 30 - Répartition en pourcen
- Page 447 and 448:
Romans centrés sur la vie affectiv
- Page 449 and 450:
Annexe 33 - Liste des manuels de 6
- Page 451 and 452:
Annexe 34 - Liste des manuels de 3
- Page 453 and 454:
Manuels/ Nationalité Moyen - Orien
- Page 455 and 456:
Annexe 37 - Pourcentages d’auteur
- Page 457 and 458:
Annexe 38 - Nombre et proportion de
- Page 459 and 460:
Annexe 39 - Nombre et proportion de
- Page 461 and 462:
Dans le manuel de Didier : Beaumarc
- Page 463 and 464:
Annexe 41 - Origine des documents a
- Page 465 and 466:
2/ pourcentages par manuels et sur
- Page 467 and 468:
Hachette Colonisateurs/explorateurs
- Page 469 and 470:
Nathan Colonisateurs colonisés Rel
- Page 471:
Thèmes abordés dans les documents