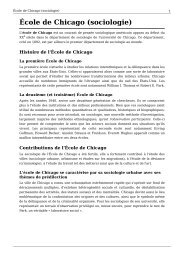Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Friedrich</strong> <strong>Nietzsche</strong> 12<br />
psychologie comme morphologie et comme doctrine de l'évolution dans la volonté de<br />
puissance, ainsi que je la considère — personne n'y a encore songé, même de loin :<br />
autant, bien entendu, qu'il est permis de voir dans ce qui a été écrit jusqu'à présent un<br />
symptôme de ce qui a été passé sous silence. La puissance des préjugés moraux a<br />
pénétré profondément dans le monde le plus intellectuel, le plus froid en apparence, le<br />
plus dépourvu d'hypothèses — et, comme il va de soi, cette influence a eu les effets les<br />
plus nuisibles, car elle l'a entravé et dénaturé. Une psycho-physiologie réelle est forcée<br />
de lutter contre les résistances inconscientes dans le cœur du savant, elle a « le cœur<br />
» contre elle. [...] Et le psychologue qui fait de tels « sacrifices » — ce n'est pas le<br />
sacrifizio del intelletto, au contraire ! — aura, tout au moins, le droit de demander que<br />
la psychologie soit de nouveau proclamée reine des sciences, les autres sciences<br />
n'existant qu'à cause d'elle, pour la servir et la préparer. Mais, dès lors, la psychologie<br />
est redevenue la voie qui mène aux problèmes fondamentaux. » [41]<br />
Si cette nouvelle psychologie repose, en 1886, sur l'hypothèse de la Volonté de puissance,<br />
l'idée du conflit des instincts n'est pas née de celle-ci. Dès 1880, des fragments vont dans<br />
ce sens, et la Volonté de puissance en tant qu'idée apparaît bien avant d'être nommée.<br />
L'expression Volonté de puissance permet de synthétiser cet ensemble.<br />
L'observation psychologique<br />
Comme cela a été signalé, la Volonté de puissance est une notion qui n'est pas d'emblée<br />
présente dans l'œuvre de <strong>Nietzsche</strong>. Pour rendre compte de l'évolution de la pensée de<br />
<strong>Nietzsche</strong>, il faut partir des hypothèses qu'il pose et des notions qu'il utilise avant la<br />
période dite de maturité. Il en va de même pour la psychologie, puisque le développement<br />
de cette dernière apparaît significatif surtout à partir de Humain, trop humain, c'est-à-dire<br />
en 1878, quand il rompt de manière consciente avec son milieu culturel [42] . Influencé par<br />
Paul Rée, <strong>Nietzsche</strong> lit alors avec intérêt les moralistes français (La Rochefoucauld,<br />
Chamfort, etc.) ; il lit également des ouvrages contemporains de psychologie, à quoi il faut<br />
ajouter des études de sociologie, d'anthropologie, et des travaux sur la théorie de la<br />
connaissance, tel que celui de Lange (Histoire du matérialisme), où l'on trouve une<br />
discussion du statut scientifique de la psychologie. La pensée de <strong>Nietzsche</strong>, en ce qui<br />
concerne la psychologie, se développe donc d'une part d'après l'observation des hommes<br />
(les maximes de La Rochefoucauld par exemple, ou ses observations personnelles dont il<br />
souligne le caractère particulier, relatif, et souvent provisoire), et dialogue d'autre part<br />
avec des réflexions épistémologiques contemporaines.<br />
L'existence humaine<br />
L'observation psychologique est ainsi particulièrement présente dans Humain, trop humain<br />
et Aurore ; <strong>Nietzsche</strong> souhaite alors jeter les bases d'une philosophie historique, en<br />
procédant à un genre d'analyse chimique de nos représentations et sentiments moraux,<br />
préfigurant ce qui deviendra la généalogie. Il analyse les comportements humains, sous<br />
l'influence de La Rochefoucauld ou de Voltaire (à qui Humain, trop humain est dédié) et<br />
peut-être aussi de Hobbes, et ramène souvent les mobiles de l'action et de la pensée<br />
humaine à la vanité et au sentiment de puissance. Si certaines de ses peintures sont de<br />
cette manière des tableaux de moraliste de l'existence humaine, certains thèmes, comme ce<br />
sentiment de puissance, mais aussi les différentes sortes de morales, sont des premières<br />
formulations des théories majeures qu'il développera plus tard. Cette étape de son œuvre<br />
peut être considérée comme une série d'essais plus ou moins aboutis pour décrire l'homme,