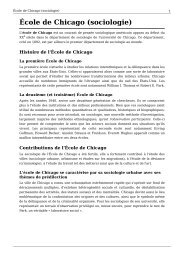Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
Friedrich Nietzsche - Sociologie:Système LMD
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Friedrich</strong> <strong>Nietzsche</strong> 8<br />
comme l'épicurisme - qui ne parvenaient pas à expliquer la persistance du mal - en tête.<br />
Cette position se retrouve notamment dans cette déclaration « il n'est pas vrai que l'homme<br />
recherche le plaisir et fuit la douleur : on comprend à quel préjugé illustre je romps ici (…).<br />
Le plaisir et la douleur sont des conséquences, des phénomènes concomitants ; ce que veut<br />
l'homme, ce que veut la moindre parcelle d'un organisme vivant, c'est un accroissement de<br />
puissance. Dans l'effort qu'il fait pour le réaliser, le plaisir et la douleur se succèdent ; à<br />
cause de cette volonté, il cherche la résistance, il a besoin de quelque chose qui s'oppose à<br />
lui… ».<br />
Pathos et structure<br />
Pour <strong>Nietzsche</strong>, la volonté de puissance possède donc un double aspect : elle est un pathos<br />
fondamental et une structure.<br />
Aussi une volonté de puissance peut-elle s'analyser comme une relation interne d'un conflit,<br />
comme structure intime d'un devenir, et non seulement comme le déploiement d'une<br />
puissance : Le nom précis pour cette réalité serait la volonté de puissance ainsi désigné<br />
d'après sa structure interne et non à partir de sa nature protéiforme, insaisissable,<br />
fluide. [32] La volonté de puissance est ainsi la relation interne qui structure un jeu de forces<br />
(une force ne pouvant être conçue en dehors d'une relation). De ce fait, elle n'est ni un être,<br />
ni un devenir, mais ce que <strong>Nietzsche</strong> nomme un pathos fondamental, pathos qui n'est<br />
jamais fixe (ce n'est pas une essence), et qui par ce caractère fluide peut être défini par une<br />
direction de la puissance, soit dans le sens de la croissance soit dans le sens de la<br />
décroissance. Ce pathos, dans le monde organique, s'exprime par une hiérarchie<br />
d'instincts, de pulsions et d'affects, qui forment une perspective interprétative d'où se<br />
déploie la puissance et qui se traduit par exemple par des pensées et des jugements de<br />
valeur correspondants.<br />
La Volonté de puissance comme interprétation<br />
Pensée par <strong>Nietzsche</strong> comme la qualité fondamentale d'un devenir, la Volonté de puissance<br />
permet d'en saisir la structure (ou type), et, partant, d'en décrire la perspective. En ce sens,<br />
la Volonté de puissance n'est pas un concept métaphysique mais un instrument interprétatif<br />
(selon Jean Granier, contre l'interprétation de Heidegger [33] ). Dès lors, pour <strong>Nietzsche</strong>, il<br />
s'agit de déterminer ce qui est interprété, qui interprète et comment.<br />
Le corps comme fil conducteur<br />
<strong>Nietzsche</strong> prend pour point de départ de son interprétation le monde qu'il considère comme<br />
nous étant donné et le mieux connu, à savoir le corps. Il prend ainsi, jusqu'à un certain<br />
point, le contre-pied de Descartes, pour qui notre esprit (notre réalité pensante) nous est le<br />
mieux connu. Toutefois, l'idée de <strong>Nietzsche</strong> n'est pas totalement opposée à la pensée<br />
cartésienne, puisque selon lui nous ne connaissons rien d'autre que le monde de nos<br />
sentiments et de nos représentations, ce qui peut se comparer à l'intuition de notre<br />
subjectivité chez Descartes. Ainsi le corps n'est-il pas pour <strong>Nietzsche</strong> en premier lieu le<br />
corps objet de la connaissance scientifique, mais le corps vécu : notre conception de l'être<br />
est une abstraction de notre rythme physiologique.<br />
Toute connaissance, comme Kant l'avait déjà établi avant <strong>Nietzsche</strong>, doit prendre pour<br />
point de départ la sensibilité. Mais, au contraire de Kant, <strong>Nietzsche</strong> tient, comme Arthur<br />
Schopenhauer, que les formes de notre appréhension de l'existence relèvent en premier