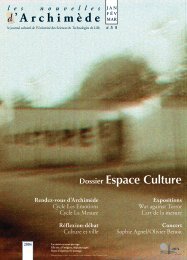les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
« Il n’y aura plus <strong>de</strong> livres, le siècle prochain. C’est trop long<br />
<strong>de</strong> lire, quand le succès est <strong>de</strong> gagner du temps » 8 . Du sophiste,<br />
il aurait donc la maîtrise <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> langage, le parti<br />
pris du sensible et l’accueil <strong>de</strong> l’événement. Ses adversaires<br />
ou ses interlocuteurs incontournab<strong>les</strong> dans l’histoire <strong>de</strong> la<br />
philosophie seraient donc Platon ou Hegel. Philosopher,<br />
c’est toujours se situer par rapport à ces <strong>de</strong>ux-là. Sophiste, le<br />
philosophe peut être aussi avocat, voire procureur, dès lors<br />
qu’il a affaire au juste.<br />
La position classique du problème du juste est celle d’Aristote<br />
9 qui place le juste au sommet <strong>de</strong> l’ordre pratique, distinct<br />
<strong>de</strong> l’ordre théorique (la connaissance). Position reprise<br />
dans <strong>les</strong> mêmes termes par John Rawls 10 : « La justice est la<br />
première vertu <strong>de</strong>s institutions socia<strong>les</strong> comme la vérité l’est<br />
<strong>de</strong>s théories. » Autrement dit, le juste comman<strong>de</strong> l’action,<br />
le vrai comman<strong>de</strong> la connaissance. Les difficultés apparaissent<br />
lorsqu’on hypostasie le Juste et le Vrai, à côté du Beau<br />
et du Bien, en universaux. Dans ce cas, celui où nous <strong>de</strong>vons<br />
nous expliquer avec Platon, le juste est juste parce qu’il<br />
est vrai : « Platon pense que, si on a une vue ‘juste’ (c’està-dire<br />
vraie) <strong>de</strong> l’être, à ce moment-là on peut retranscrire<br />
cette vue dans l’organisation sociale, avec <strong>de</strong>s intermédiaires<br />
certes (la psyché par exemple), mais, néanmoins, le modèle<br />
reste la distribution même <strong>de</strong> l’être, il faut que la société<br />
répète pour elle-même cette distribution qui sera aussi bien<br />
distribution <strong>de</strong> capacités, <strong>de</strong> responsabilités, <strong>de</strong>s valeurs, <strong>de</strong>s<br />
biens, <strong>de</strong>s femmes et ainsi <strong>de</strong> suite » 11 . Le juste ne peut être<br />
dérivé du vrai. Le <strong>de</strong>voir-être ne dépend pas <strong>de</strong> l’être, la<br />
justice n’est pas la transcription ou la sanction d’une ontologie.<br />
L’accord avec Levinas est ici profond, explicite et<br />
revendiqué. En termes techniques, le <strong>de</strong>scriptif ne fon<strong>de</strong> pas<br />
le prescriptif. Contre Platon, Lyotard établit l’hétérogénéité<br />
<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux ordres et dénonce le rabattement du second sur<br />
le premier. Mieux même, face au discours apophantique<br />
(ou propositionnel), Lyotard, comme Levinas, réhabilite la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et la prière. Non pas celle que je serais tenté <strong>de</strong><br />
faire pour qu’ « on » me ren<strong>de</strong> justice, mais celle que je<br />
suis requis d’écouter dans la rencontre d’autrui réclamant<br />
justice. Leçon adressée à la philosophie politique : « toute<br />
politique implique la prescription <strong>de</strong> faire autre chose que<br />
8 Ibid.<br />
9 Éthique à Nicomaque, livre V.<br />
10 Théorie <strong>de</strong> la justice.<br />
11 Au juste, p. 47.<br />
ce qui est » 12 . Adresse aussi à tous <strong>les</strong> philosophes, <strong>de</strong> Platon<br />
à Marx et ses discip<strong>les</strong> : on ne dérive pas le juste du vrai,<br />
la bonne société à venir <strong>de</strong> l’analyse « scientifique » <strong>de</strong> la<br />
société actuelle. Non pas qu’elle soit inutile mais, entre le<br />
régime du vrai et le régime du juste, il y a hétérogénéité.<br />
Le danger totalitaire est dans la fusion <strong>de</strong>s hétérogènes. Il<br />
n’y a pas une instance (Dieu, le Parti) qui me comman<strong>de</strong><br />
au nom <strong>de</strong> l’être. Tout ordre est à la <strong>de</strong>uxième personne : le<br />
récepteur, le <strong>de</strong>stinataire, c’est moi. Du côté <strong>de</strong> la référence, le<br />
discours théorique (« voilà comment <strong>les</strong> choses se passent, je<br />
vais vous expliquer le mécanisme d’extraction <strong>de</strong> la plus-value<br />
») reste entièrement dans le <strong>de</strong>scriptif. Un discours centré<br />
sur la référence, et non sur le <strong>de</strong>stinataire, finit toujours dans<br />
l’abstraction anonyme ou la terreur. Le projet <strong>de</strong> Lyotard<br />
était donc <strong>de</strong> penser la justice débarrassée du poids <strong>de</strong> l’être<br />
et <strong>de</strong> la vérité : « Il me semble que dans la justice, pour autant<br />
que la justice renvoie à du prescriptif, et elle y renvoie nécessairement,<br />
il y a un usage du langage qui est foncièrement<br />
différent <strong>de</strong> celui qui est son usage théorique » 13 .<br />
Le Différend se présente comme la mise à l’épreuve réciproque<br />
<strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> langage et du prescriptif. En avançant<br />
le concept <strong>de</strong> phrase et d’enchaînement <strong>de</strong> phrases, Lyotard<br />
franchit un pas décisif. Il réaffirme l’hétérogénéité <strong>de</strong>s régimes<br />
<strong>de</strong> phrase, <strong>de</strong> leurs règ<strong>les</strong> d’usage : dans l’enseignement,<br />
l’exercice <strong>de</strong> la justice, la pratique artistique, la relation<br />
amoureuse, etc. Rien ne peut ramener ces jeux à l’unité d’un<br />
langage. Ce qui arrive, c’est la phrase. Ce qui me manque,<br />
c’est la réponse à la question : comment enchaîner sur cette<br />
phrase ? « Le différend est l’état instable et l’instant du langage<br />
où quelque chose doit pouvoir être mis en phrases, ne<br />
peut pas l’être encore. Cet état comporte le silence qui est<br />
une phrase négative, mais il en appelle aussi à <strong>de</strong>s phrases<br />
possib<strong>les</strong> en principe » 14 . Silence, celui <strong>de</strong>s rescapés. Phrase<br />
à venir, jusqu’ici bloquée : « comment enchaîner après Auschwitz<br />
? ». « Le silence ne signale pas quelle est l’instance<br />
niée, il signale qu’une ou <strong>de</strong>s instances sont niées, et l’on<br />
peut entendre : 1) que la situation en question (le cas) n’est<br />
pas l’affaire du <strong>de</strong>stinataire (il n’a pas la compétence, ou il<br />
ne mérite pas qu’on lui en parle) ou 2) qu’elle n’a pas eu lieu<br />
(c’est ce qu’entend Faurisson) ou 3) qu’il n’y a rien à en dire<br />
(elle est insensée, inexprimable) ou 4) que ce n’est pas l’af-<br />
12 Ibid., p. 48.<br />
13 Ibid., p. 49.<br />
14 Ibid.<br />
libres propos / LNA#49<br />
35