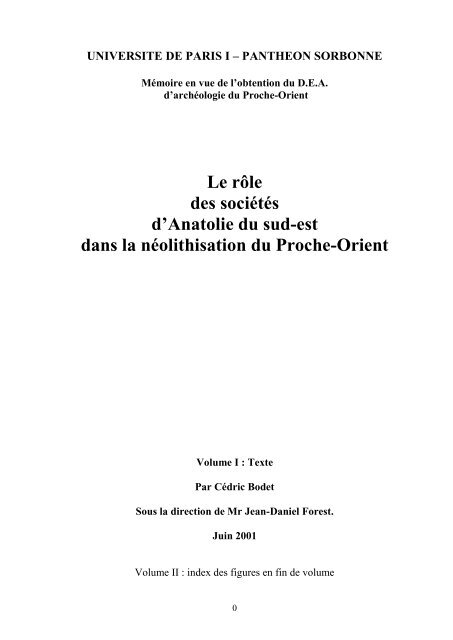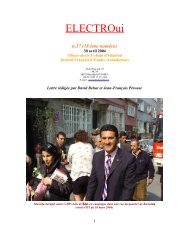Le rôle des sociétés d'Anatolie du sud-est dans la ... - IFEA
Le rôle des sociétés d'Anatolie du sud-est dans la ... - IFEA
Le rôle des sociétés d'Anatolie du sud-est dans la ... - IFEA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE DE PARIS I – PANTHEON SORBONNE<br />
Mémoire en vue de l’obtention <strong>du</strong> D.E.A.<br />
d’archéologie <strong>du</strong> Proche-Orient<br />
<strong>Le</strong> rôle<br />
<strong>des</strong> sociétés<br />
d’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong><br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation <strong>du</strong> Proche-Orient<br />
Volume I : Texte<br />
Par Cédric Bodet<br />
Sous <strong>la</strong> direction de Mr Jean-Daniel For<strong>est</strong>.<br />
Juin 2001<br />
Volume II : index <strong>des</strong> figures en fin de volume<br />
0
Je tiens à remercier les personnes qui m’ont aidé et soutenu <strong>dans</strong> l’aboutissement<br />
de ce travail: Jean-Daniel For<strong>est</strong>, Barbara Helwing, Maud <strong>Le</strong>breton, Aline Tenu, Canan<br />
Cakir<strong>la</strong>r et mes parents.<br />
Avant-propos<br />
La terminologie et <strong>la</strong> chronologie <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> en qu<strong>est</strong>ion sont en grande partie<br />
fondées sur <strong>la</strong> typologie lithique en général et sur celle <strong>des</strong> pointes de flèche en<br />
particulier. Cependant, il <strong>est</strong> plus difficile d'attribuer <strong>des</strong> datations absolues à ces pério<strong>des</strong><br />
et donc à cette séquence de pointes. Elles dépendent souvent entièrement <strong>des</strong> dates<br />
radiocarbone <strong>des</strong> échantillons issus <strong>des</strong> couches stratifiées contenant le matériel lithique<br />
qui y <strong>est</strong> associé. Celles-ci sont sujettes à d'importantes variations selon que ces dates<br />
sont calibrées ou non et selon leur provenance géographique.<br />
La calibration <strong>des</strong> dates <strong>est</strong> <strong>la</strong> conséquence récente de <strong>la</strong> découverte d’un<br />
phénomène physique qui faussait les dates 14C, surtout pour les pério<strong>des</strong> anciennes,<br />
telles que le Néolithique. En effet, <strong>la</strong> datation radiocarbone <strong>est</strong> fondée sur le calcul de <strong>la</strong><br />
radiation carbonique qui émane <strong>des</strong> corps organiques proportionnellement <strong>dans</strong> le temps.<br />
<strong>Le</strong>s scientifiques se sont aperçus par <strong>la</strong> suite que le champs magnétique de <strong>la</strong> terre s'était<br />
considérablement modifié au cours <strong>des</strong> millénaires et qu'il fal<strong>la</strong>it donc revoir certaines<br />
dates anciennes à <strong>la</strong> hausse. C'<strong>est</strong> ici qu'intervient un ensemble de techniques, notamment<br />
<strong>la</strong> dendrochronologie, appelé calibration, qui permet de réévaluer plus justement ces<br />
dates. Cauvin <strong>est</strong>, <strong>dans</strong> l'édition 1997 (p. 11-12) de Naissance <strong>des</strong> divinités, naissance de<br />
l'agriculture, l'un <strong>des</strong> premiers à en faire part.<br />
Dans cet ouvrage, nous utiliserons donc uniquement les dates calibrées (indiquées<br />
av. J.-C. ou B.C.) puisqu'elles sont plus proches de <strong>la</strong> réalité et plus conformes aux<br />
techniques de datation modernes. Il faut cependant noter que ces métho<strong>des</strong> de calibration<br />
n'ont certainement pas pu être appliquées ou éten<strong>du</strong>es à tous les sites. Par conséquent, j’ai<br />
dû procéder, pour ceux-ci, à <strong>des</strong> calculs approximatifs afin d’obtenir une idée de <strong>la</strong> valeur<br />
calibrée <strong>des</strong> dates qui ne l’étaient pas, à partir d'un tableau de périodisation (fig) établi par<br />
<strong>la</strong> Maison de l'Orient (Lyon) mettant en parallèle les deux types de dates et publié<br />
récemment par Stordeur (1999 : 34). Il semble qu'il ne s'agisse pas là d'une constante<br />
mais que <strong>la</strong> variation <strong>est</strong> inégale selon <strong>la</strong> période considérée. De cette façon, 10200-<br />
10000 BP (période khiamienne au <strong>Le</strong>vant) donne les dates de 10000-9500 av. J-C.<br />
Ainsi, les dates non-calibrées, souvent annoncées en "BP" (Before Present),<br />
d'Hal<strong>la</strong>n Cemi montrent selon Rosenberg (1999: 26; 1998:38) que l'occupation <strong>du</strong> site<br />
1
emonte à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> 11ème millénaire BP, ce qui donne donc une date calibrée beaucoup<br />
plus <strong>la</strong>rge al<strong>la</strong>nt d'environ 10600 à 9300 av J-C . C'<strong>est</strong> très important car ce<strong>la</strong> révèle, par<br />
exemple, une affiliation plus ou moins directe, et même une partielle contemporanéité<br />
entre le PPNA d’Hal<strong>la</strong>n Cemi et celui de Cayönü, ce qui multiplie par deux le nombre de<br />
sites PPNA connus <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région.<br />
2
I<br />
-<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
3
<strong>Le</strong> Néolithique <strong>est</strong> cette période au cours de <strong>la</strong>quelle l'homme, par le biais de<br />
changements radicaux, va commencer à contrôler son environnement et établir les bases<br />
communautaires qui sont les racines profon<strong>des</strong> de nos sociétés modernes. Ces<br />
changements, selon <strong>la</strong> définition de Gordon Childe, acceptée par une majorité de<br />
chercheurs depuis (Aurenche et Kozlowski 1999 : 36-7), concernent presque<br />
exclusivement le domaine <strong>du</strong> mode de subsistance, c’<strong>est</strong>-à-dire de l’apparition de<br />
l’agriculture, et c'<strong>est</strong> encore en ces termes que le Néolithique <strong>est</strong> traditionnellement<br />
considéré.<br />
Il <strong>est</strong> vrai que l'apparition de l'agriculture et de l'élevage forment une avancée<br />
nécessaire et une base indispensable à toute société complexe. Il serait cependant trop<br />
simpliste de ré<strong>du</strong>ire cette période de grands bouleversements à cette seule modification<br />
économique. Comme le note Ozdogan (1997: 9 ; 1998 : 34) « le mode de subsistance ne<br />
suffit pas à définir ni <strong>la</strong> néolithisation, ni les zones d’interactions culturelles ». La<br />
sédentarisation, le développement de l'architecture, <strong>la</strong> spécialisation <strong>du</strong> travail, l'art, <strong>la</strong><br />
circu<strong>la</strong>tion à longue distance (notamment de l'obsidienne), les prémices de<br />
l’institutionnalisation de <strong>la</strong> religion (construction de bâtiments somptuaires) et de <strong>la</strong><br />
centralisation <strong>du</strong> pouvoir sont autant d'éléments qui forment, aux côtés de l'agriculture, et<br />
non comme une conséquence de celle-ci, un tout caractéristique <strong>des</strong> sociétés avancées.<br />
L’agriculture n’<strong>est</strong> qu’un élément qui, pour reprendre les termes de T<strong>est</strong>art (1982 :<br />
201), «s’insère <strong>dans</strong> le mouvement historique de cette époque ». En effet, contrairement à<br />
ce qui a longtemps été cru, l'agriculture n'<strong>est</strong> pas l'élément déclencheur <strong>des</strong> autres ; <strong>la</strong><br />
sédentarisation, par exemple, lui <strong>est</strong> bien antérieure et son impact n’<strong>est</strong> pas moindre.<br />
Celle-ci, accompagnée de <strong>la</strong> notion de stockage de denrées saisonnières, forme d’ailleurs<br />
peut-être <strong>la</strong> vraie révolution que l’on appelle encore aujourd’hui « néolithique » ; mais<br />
elle apparaît dès le Mésolithique. Il nous semble donc inapproprié de faire commencer le<br />
Néolithique à l'apparition de l'agriculture (avec toutes les complications techniques que<br />
ce terme implique) et nous préférons considérer cette période <strong>dans</strong> son déroulement<br />
temporel (par rapport aux différentes innovations culturelles). Il <strong>est</strong> donc plus logique<br />
pour nous de parler de "néolithisation", prenant pour point de départ <strong>la</strong> plus ancienne <strong>des</strong><br />
innovations concernées, <strong>la</strong> sédentarisation.<br />
Au Proche-Orient, où <strong>la</strong> néolithisation <strong>est</strong> l’une <strong>des</strong> plus précoces au monde, <strong>la</strong><br />
succession et <strong>la</strong> chronologie de ces différents éléments nous sont connues <strong>dans</strong> les<br />
4
gran<strong>des</strong> lignes. La sédentarisation, avec, bien sûr, les débuts de l'architecture, mais aussi<br />
ceux <strong>des</strong> échanges organisés à longue distance ouvrent donc, vers 12500 calibré av. JC,<br />
<strong>la</strong> marche <strong>du</strong> processus néolithique, bien que cette période soit plus communément<br />
connue sous le nom de Mésolithique. Elle représente donc logiquement pour nous <strong>la</strong><br />
Période 1 (voir Périodisation <strong>dans</strong> Cadre spatio-temporel). Ensuite, c'<strong>est</strong> le passage, à <strong>la</strong><br />
Période 2 (10000-8700 av. JC), à l'agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique, à l'architecture<br />
rectangu<strong>la</strong>ire, à <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong>mes sur nucléus bipo<strong>la</strong>ires (remp<strong>la</strong>çant les <strong>la</strong>melles <strong>du</strong><br />
"Mésolithique") et les premières att<strong>est</strong>ations de travaux collectifs, tels que <strong>des</strong> remparts<br />
et une tour massifs à Jéricho (Cauvin 1997 : 59) ou <strong>des</strong> bâtiments publiques comme à Jerf<br />
el-Ahmar (Stordeur 2000 : 43). Enfin, à <strong>la</strong> Période 3 (8700-7000 av. JC), le sommet de <strong>la</strong><br />
complexité sociale néolithique <strong>est</strong> atteint avec <strong>des</strong> bâtiments aux dimensions<br />
monumentales, et à <strong>la</strong> fonction hautement symbolique (religieuse) notamment à Göbekli<br />
Tepe (Hauptmann 1999 : 78-81), une circu<strong>la</strong>tion de l'obsidienne et une pro<strong>du</strong>ction<br />
lithique très organisées et uniformes impliquant une certaine spécialisation <strong>du</strong> travail,<br />
ainsi que le confirme l'apparition de l’agriculture et de l’élevage dom<strong>est</strong>iques, et, enfin,<br />
celle de <strong>la</strong> poterie. Bien que de façon très re<strong>la</strong>tive (à l’échelle d’un vil<strong>la</strong>ge), à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong><br />
période, une hiérarchisation de <strong>la</strong> société se <strong>des</strong>sine et le pouvoir se centralise.<br />
S'il subsiste, <strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong> séquence chronologique et de <strong>la</strong> datation,<br />
beaucoup d'éléments à préciser ou à réajuster, c'<strong>est</strong>, il semble, <strong>dans</strong> le domaine<br />
géographique qu'il r<strong>est</strong>e le plus de travail à faire. <strong>Le</strong> fil de tous ces événements se perd<br />
quant à <strong>la</strong> région de leur apparition et à leur éten<strong>du</strong>e d'influence, et donne lieu à de<br />
nombreuses controverses souvent infructueuses entre différentes "écoles", parfois<br />
influencées par un pr<strong>est</strong>ige national ou idéologique.<br />
Il <strong>est</strong> aujourd'hui difficile d'<strong>est</strong>imer où, précisément, ces différents événements<br />
culturels sont d'abord apparus et où ils se sont ensuite diffusés, car ce n'<strong>est</strong> pas aussi<br />
simple et évident qu’on peut le <strong>la</strong>isser entendre. Voici donc l'intérêt de comprendre au<br />
préa<strong>la</strong>ble l'importance de ne pas considérer le Néolithique comme évènement en soi,<br />
mais comme une multitude de petites innovations fusionnant, et de décortiquer<br />
suffisamment leur chronologie, par un système de périodisation simplifiée, sur lequel<br />
nous reviendrons. Il semble bien en effet, après analyse de celles-ci, que tout ne soit pas<br />
parti d'un seul et même endroit, et qu'ensuite le phénomène néolithique se soit diffusé<br />
<strong>dans</strong> le r<strong>est</strong>e <strong>du</strong> Croissant Fertile. On ne peut non plus imaginer, au contraire, que<br />
5
l'ensemble de ces innovations soit apparu <strong>dans</strong> l'ensemble de cette région au même<br />
moment. La complexité <strong>du</strong> processus de néolithisation rend en effet impossible qu'une<br />
telle succession d'évènements aussi primordiaux soit intervenue pareillement, avec une<br />
même intensité et en même temps sur un si vaste territoire, ou bien qu'un seul petit<br />
territoire en soit le seul centre novateur.<br />
L'étude de l'apparition géographique <strong>des</strong> différents éléments de <strong>la</strong> néolithisation<br />
<strong>du</strong> Proche-Orient, dont l’ensemble pourra être abordé ultérieurement (travail de thèse),<br />
forme <strong>la</strong> trame de fond de cette problématique. Pour l'instant, sans, bien-enten<strong>du</strong>, ne<br />
jamais perdre de vue son cadre et son référentiel nécessaire qu'<strong>est</strong> le r<strong>est</strong>e <strong>du</strong> Croissant<br />
Fertile, nous nous attacherons plus précisément à <strong>la</strong> région qui nous a d'abord beaucoup<br />
intrigué et nous a, en premier, fait prendre conscience de ce flou géographique; il s'agit<br />
d’une région trop souvent <strong>la</strong>issée pour compte mais dont l’importance <strong>des</strong> v<strong>est</strong>iges mérite<br />
une p<strong>la</strong>ce de choix au sein de cette étude: l'Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>.<br />
<strong>Le</strong> concept de Néolithique précéramique évoque l'idée de sociétés sédentaires<br />
mais primitives, non complexes. <strong>Le</strong>s photos de sites récemment fouillés, tels que Nevali<br />
Cori et surtout Göbekli Tepe <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d'Urfa (Turquie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>), datant de <strong>la</strong><br />
Période 3, provoquent invariablement une profonde remise en cause. C'<strong>est</strong> d'abord à <strong>la</strong><br />
vue <strong>des</strong> bâtiments monumentaux et <strong>des</strong> piliers monolithiques, al<strong>la</strong>nt jusqu’à 6 m de haut,<br />
souvent décorés de bas reliefs (Hauptmann 1999 : 78-81) que nous nous sommes<br />
interrogé sur <strong>la</strong> nature réelle de ces sociétés et leur p<strong>la</strong>ce <strong>dans</strong> le processus de<br />
néolithisation <strong>du</strong> Proche-Orient. Rien de semb<strong>la</strong>ble <strong>dans</strong> l’extravagance n'a encore été<br />
trouvé jusqu'à une période beaucoup plus récente <strong>dans</strong> tout le Poche-Orient. Or, cette<br />
unicité <strong>est</strong> accompagnée d'éléments tout aussi intrigants: on <strong>est</strong> amené à penser que <strong>la</strong><br />
complexité de <strong>la</strong> société qui a construit ces bâtiments <strong>est</strong> le résultat d'une longue tradition<br />
locale, puisque rien de semb<strong>la</strong>ble n'<strong>est</strong> att<strong>est</strong>é aux alentours. Cependant, celle-ci n'existe<br />
pas puisque ces structures ont été construites sur le sol vierge et <strong>la</strong> période précédente <strong>est</strong>,<br />
sur l’ensemble de <strong>la</strong> région et selon nos connaissances actuelles, quasiment dépourvue<br />
d’architecture. Il semble à présent que les seules origines possibles se trouvent sur le<br />
Moyen-Euphrate Syrien à <strong>la</strong> période précédente (Période 2), mais à un stade de<br />
développement moindre. La nature de l'émergence de ces sociétés r<strong>est</strong>e donc un mystère;<br />
s'agit-il d'une diffusion de popu<strong>la</strong>tion ou d'idées Des liens culturels peuvent-ils prouver<br />
une re<strong>la</strong>tion quelconque avec les cultures avoisinantes <br />
6
Enfin, un autre élément vient semer <strong>la</strong> confusion, celui <strong>du</strong> problème de<br />
représentativité. Si les prospections sur le Néolithique au <strong>Le</strong>vant, spécialement en<br />
Pal<strong>est</strong>ine, étaient déjà importantes <strong>dans</strong> les années trente (l’expédition de Garstang à<br />
Jéricho) et que leur nombre n’a pas cessé de croître depuis (Ozdogan 1997: 8), le<br />
Néolithique en Turquie a été découvert <strong>dans</strong> les années soixante (le projet Iraq Jarmo par<br />
Braidwood) et n'a vraiment commencé à intéresser les chercheurs que depuis une dizaine<br />
d'années. Auparavant, l’Anatolie n’a jamais été considérée que comme une zone<br />
marginale ou un pont entre l’<strong>est</strong> et l’ou<strong>est</strong>, et souvent même ignorée en tant que point de<br />
passage <strong>dans</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>du</strong> Néolithique <strong>du</strong> Proche-Orient vers l’Europe, car, jusqu’il y a<br />
encore quelques années, beaucoup <strong>la</strong> croyaient vide de popu<strong>la</strong>tion jusqu’au 3ème<br />
millénaire (Ozdogan 1998: 25-6)! Malgré <strong>la</strong> richesse <strong>des</strong> sites explorés <strong>dans</strong> cette région<br />
depuis, on lui attribue encore trop souvent une importance mineure <strong>dans</strong> <strong>la</strong> séquence <strong>des</strong><br />
innovations néolithiques; on a beaucoup parlé de « néolithisation secondaire » pour<br />
qualifier le Néolithique anatolien (Cauvin 1997: 118-121; Ozdogan 1998 : 37-38). Pour<br />
400 sites explorés au <strong>Le</strong>vant pour <strong>la</strong> période, il en existe à peine une quarantaine sur<br />
l'ensemble de <strong>la</strong> Turquie qui couvre une surface beaucoup plus importante (Ozdogan<br />
1999: 10-11). Et, au vu de <strong>la</strong> qualité <strong>des</strong> quelques sites retrouvés, on ne peut que supposer<br />
qu'il en r<strong>est</strong>e beaucoup d'autres. Il <strong>est</strong> donc difficile aujourd'hui d'établir une séquence de<br />
développement fiable. <strong>Le</strong>s recherches à venir devront ainsi nécessairement atténuer ou<br />
modifier nos connaissances et nos hypothèses actuelles (voir infra). Cependant, les<br />
données acquises <strong>du</strong>rant cette dernière décennie sont si importantes et soudaines qu’elles<br />
sont loin d’être bien exploitées. Il <strong>est</strong> impératif que ces données soient maintenant<br />
étudiées <strong>dans</strong> le souci de leur donner un sens, de les intégrer <strong>dans</strong> un ensemble cohérent.<br />
Elles méritent ainsi, non seulement une synthèse, mais également d'être analysées en vue<br />
de formuler les qu<strong>est</strong>ions auxquelles répondront les recherches futures.<br />
En ce sens, il nous semble donc justifié de réhabiliter le statut de l'Anatolie <strong>du</strong><br />
<strong>sud</strong>-<strong>est</strong> <strong>dans</strong> le rôle qu'elle a joué <strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation <strong>du</strong> Proche-Orient. Découvrir les<br />
régions géographiques de <strong>la</strong> néolithisation, c'<strong>est</strong> aussi, en d'autres termes, rechercher les<br />
affinités culturelles <strong>des</strong> communautés qui les ont habitées, à travers l'uniformité ou <strong>la</strong><br />
variété qui apparaît <strong>dans</strong> leurs cultures matérielles. C'<strong>est</strong> en effet, <strong>dans</strong> un premier temps,<br />
l'étude de celles-ci qui permettra de déceler <strong>des</strong> traces de traditions locales, d’échanges,<br />
d'influences et de diffusions, de déclin et d'apogée, enfin, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de toute une<br />
base de comparaison. A travers les principaux témoins de ces sociétés, nous essaierons<br />
7
de reconstituer le paysage culturel de cette région et de <strong>la</strong> rep<strong>la</strong>cer au sein de son cadre<br />
proche-oriental. Ces principaux témoins sont déterminés par leur état de préservation,<br />
leur quantité ou leur qualité de caractérisation de ces sociétés, et leur niveau de<br />
développement respectif. Il s’agit, pour l’horizon culturel en qu<strong>est</strong>ion, de l'in<strong>du</strong>strie<br />
lithique, l'architecture et le mode de subsistance, et ils formeront les trois axes d’étu<strong>des</strong><br />
majeurs de cette recherche. <strong>Le</strong> domaine de l’art, tenant <strong>du</strong> symbolique et donc plus<br />
délicat à interpréter, ne sera que brièvement abordé <strong>dans</strong> le cadre r<strong>est</strong>reint de cette étude.<br />
A partir de ces domaines, étudiés par période et en comparant les données <strong>des</strong> différentes<br />
régions, nous viendrons à établir une vision de l’évolution <strong>des</strong> structures sociales et <strong>des</strong><br />
affiliations culturelles <strong>des</strong> communautés concernées. Enfin, il sera temps d’essayer de<br />
dresser un portrait, un « modèle », <strong>du</strong> rôle <strong>des</strong> sociétés anatoliennes <strong>dans</strong> le mouvement<br />
général de <strong>la</strong> néolithisation qui caractérise le Croissant Fertile à cette époque.<br />
Sur les problèmes de représentativité<br />
Nous avons déjà évoqué le problème de représentativité qui <strong>est</strong> sans doute l’un<br />
<strong>des</strong> premiers ennemis d'un travail de ce genre. Comme nous l’avons déjà signalé, il y a de<br />
fortes chances que, quelle que soit <strong>la</strong> vision établie, celle-ci soit modifiée, complètement<br />
ou en partie <strong>dans</strong> les prochaines années. Cependant, <strong>dans</strong> un premier temps, un tel travail<br />
n'<strong>est</strong> pas inutile, <strong>dans</strong> le sens où il permet de mettre en corré<strong>la</strong>tion différentes régions sur<br />
un espace assez <strong>la</strong>rge, et donc d’y voir plus c<strong>la</strong>ir et de disposer d’une base de données<br />
plus facile à manipuler. Il <strong>est</strong> temps d’établir une synthèse et de mettre en perspective les<br />
8
avancées réalisées jusqu'à présent en ce domaine, afin de faire le point sur nos<br />
connaissances et sur <strong>la</strong> direction vers <strong>la</strong>quelle il faut procéder pour mieux exploiter les<br />
informations à l'avenir. De plus, il <strong>est</strong> incont<strong>est</strong>able que les nouvelles données <strong>des</strong> dix<br />
dernières années <strong>dans</strong> de nombreuses régions (Anatolie, Zagros, Djézireh) où<br />
pratiquement rien n'était connu auparavant suffisent déjà à radicalement changer l’idée<br />
générale sur cette période. La petite dizaine de sites d’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> pèse déjà lourd<br />
sur notre interprétation de <strong>la</strong> néolithisation de l’ensemble <strong>du</strong> Proche-Orient, malgré les<br />
centaines de sites connus au <strong>sud</strong> <strong>Le</strong>vant (Ozdogan 1999: 225). <strong>Le</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> n'<strong>est</strong> plus,<br />
en dépit <strong>des</strong> décennies de recherche <strong>dans</strong> cette région, le centre novateur unique de <strong>la</strong><br />
néolithisation.<br />
C'<strong>est</strong> d'ailleurs bien à ce<strong>la</strong> que l'on reconnaît qu’il faut atténuer le problème de<br />
représentativité <strong>du</strong> matériel. Malgré le grand nombre de sites connus au <strong>sud</strong> <strong>Le</strong>vant de<br />
toutes les pério<strong>des</strong> concernées, si celui-ci conserve sa notoriété sur <strong>la</strong> période natoufienne<br />
en terme d'avancée culturelle sur les autres régions, les quelques sites <strong>du</strong> Moyen Euphrate<br />
et <strong>d'Anatolie</strong>, aux PPNA et PPNB, suffisent à eux seuls à définir un mouvement<br />
d'innovation vers le nord, alors que le <strong>sud</strong> stagne, avant de péricliter totalement à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong><br />
PPNB (Rollefson 1989: 169, 173). <strong>Le</strong> nombre <strong>des</strong> prospections de terrain sur <strong>la</strong> période<br />
en Anatolie <strong>est</strong> re<strong>la</strong>tivement élevé (Todd, Balkan Atli, Bennedict, Ozdogan, Cauvin,<br />
Cambel, Braidwood, Howe, Kansu, Senyurek, Kökten, Bostanci, Whalon) pour n’en citer<br />
que quelques-uns (Balkan-Atli 1994 : 47 ; Ozdogan, M. 1997 : 7). Même si l’Anatolie<br />
souffre de problèmes d’érosion <strong>des</strong> sols entraînant l’enlisement de nombreux sites, le su<strong>des</strong>t<br />
<strong>est</strong> particulièrement épargné par ce phénomène, à tel point que de nombreux sites<br />
néolithiques sont localisés directement sous <strong>la</strong> surface (Ozdogan 1998 : 29). De plus, <strong>la</strong><br />
construction de plusieurs barrages sur le Tigre et l’Euphrate turcs <strong>du</strong>rant les dernières<br />
décennies a amené les équipes sur p<strong>la</strong>ce à con<strong>du</strong>ire un grand nombre d’opérations de<br />
reconnaissance. Par exemple, Rosenberg, lors de <strong>la</strong> construction <strong>du</strong> barrage sur <strong>la</strong> rivière<br />
Batman fait état de seulement deux sites précéramiques repérés sur toute <strong>la</strong> région<br />
concernée (Hal<strong>la</strong>n Cemi), bien que <strong>la</strong>rgement prospectée (Rosenberg et alii 1998: 35).<br />
Enfin, les résultats concordent pour dire que le nombre de sites connus concernant les<br />
Pério<strong>des</strong> 1 et 2 particulièrement r<strong>est</strong>e très faible. La raison <strong>est</strong> facilement explicable<br />
climatiquement (voir « environnement »). Tout ceci nous invite à penser que les<br />
découvertes à venir ne viendront pas complètement bouleverser l’idée que nous pouvons<br />
9
nous faire de l’identité culturelle de <strong>la</strong> région, et que nos conclusions sont fondées sur <strong>des</strong><br />
faits, qui, très certainement, seront modifiés, mais pas entièrement remis en cause.<br />
Ce tableau montre, à ce propos, le nombre de sites d’importance connus <strong>dans</strong><br />
chaque région. Celui-ci tend tout à fait à démontrer que, finalement, l’Anatolie n’<strong>est</strong> pas<br />
plus mal lotie que les régions voisines en ce qui concerne le nombre de sites, et que <strong>la</strong><br />
base de comparaison semble extrêmement fiable.<br />
Nombre de sites<br />
par pério<strong>des</strong> et<br />
régions<br />
Période 1<br />
Période 2<br />
Période3<br />
<strong>Le</strong>vant Nord Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> Djézireh<br />
2: Abu Hureyra,<br />
Mureybet<br />
3: Mureybet,<br />
Cheickh Hassan,<br />
Jerf el Ahmar<br />
8 : Dja’de, Halu<strong>la</strong>,<br />
Abu Hureyra,<br />
Bouqras, Qdeir, El<br />
Kowm, Sabi Abyad,<br />
Assouad<br />
3: Sögüt Tar<strong>la</strong>si, Biris 2: Nemrick, Qermez<br />
Mezaligi, Hal<strong>la</strong>n Cemi Dere<br />
3: Hal<strong>la</strong>n Cemi, 4: Nemrick, Qermez<br />
Demirköy, Cayönü Dere, M’lefaat, Deir<br />
Base.(Nev.Cori,Göb ) Hall<br />
8: Nevali Cori, 2: Nemrick,<br />
Cayönü, Göbekli Tepe, Magzalia,<br />
Gürcütepe, Cafer<br />
Höyük, boytepe,<br />
Hayaz Höyük, Gritille.<br />
De plus, le nombre en soi <strong>des</strong> sites ne peut être un point de comparaison unique.<br />
C’<strong>est</strong> bien <strong>la</strong> qualité culturelle présente <strong>dans</strong> chacune <strong>des</strong> régions qui nous permet de<br />
parler de telle ou telle influence, diffusion, hégémonie…<br />
Cette constatation <strong>est</strong> toute aussi va<strong>la</strong>ble à l'inverse: il <strong>est</strong> c<strong>la</strong>ir qu'au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong>,<br />
les sites natoufiens sont beaucoup plus nombreux que ceux <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> suivantes, PPNA<br />
et PPNB (Bar-Yosef 1992: 14) et qu'ils ont été connus bien avant (Bar-Yosef 1992: 14,<br />
1989: 57). Il serait donc logique de supposer que si un tel engouement avait existé <strong>dans</strong><br />
d'autres régions à cette époque, celui-ci aurait été montré de manière plus significative.<br />
On peut donc penser avec une re<strong>la</strong>tive assurance que c'<strong>est</strong> bien le <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong>, et<br />
particulièrement <strong>la</strong> Galilée qui, à cette époque, concentre l'activité culturelle <strong>la</strong> plus<br />
intense, qu'elle partage en partie avec le Zagros, alors que les régions intermédiaires,<br />
même si elles ne sont sûrement pas vi<strong>des</strong>, présentent sans doute moins de popu<strong>la</strong>tions<br />
sédentaires.<br />
10
II<br />
-<br />
Cadre<br />
Spatio-temporel<br />
12
Environnement<br />
Nous nous étendrons, en ce qui concerne le cadre géographique général, sur ce<br />
qu'il convient d'appeler le Croissant Fertile, en se concentrant essentiellement sur son<br />
extrémité septentrionale. <strong>Le</strong> Croissant Fertile forme un arc très vaste, qui s'étend de sa<br />
pointe <strong>sud</strong>-ou<strong>est</strong> formée par le <strong>Le</strong>vant, c'<strong>est</strong>-à-dire les pays actuels d'Israël, de <strong>la</strong> Jordanie<br />
(occidentale), <strong>du</strong> Liban et de <strong>la</strong> Syrie (littoral et vallée de l'Euphrate), à sa pointe <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>,<br />
c'<strong>est</strong>-à-dire les pays actuels d'Iran et d'Iraq. Ces deux pointes se rejoignent en un croissant<br />
septentrional au <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> de <strong>la</strong> Turquie (carte ).<br />
Pour parler en termes d'environnements naturels topographiques ou<br />
hydrographiques, <strong>la</strong> branche occidentale <strong>du</strong> Croissant s’étend entre le littoral<br />
méditerranéen <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant et <strong>la</strong> section nord <strong>du</strong> Rift Africain, matérialisé par les vallées <strong>du</strong><br />
Jourdain et de l'Oronte. <strong>Le</strong> Croissant commence sa courbure à partir <strong>du</strong> coude de <strong>la</strong><br />
Vallée <strong>du</strong> Moyen Euphrate syrien et longe l'arc de cercle formé par <strong>la</strong> rangée<br />
montagneuse <strong>du</strong> Taurus oriental, qui ensuite rencontre <strong>la</strong> chaîne <strong>du</strong> Zagros qu'il va suivre,<br />
en même temps que le Tigre et l'Euphrate jusqu'au Golfe Persique.<br />
Bien que le Croissant Fertile forme le cadre référentiel de cette étude, c'<strong>est</strong> <strong>la</strong><br />
région parfois appelée Hautes Vallées (<strong>du</strong> Tigre et de l'Euphrate), autrement dit l'Anatolie<br />
<strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>, qui nous intéresse plus particulièrement ici.<br />
Selon une définition anthropologique, <strong>la</strong> culture <strong>est</strong> le moyen premier par lequel<br />
les hommes s’adaptent à leur environnement naturel (Fagan 1994: 482). La néolithisation<br />
comprend le passage à <strong>la</strong> sédentarisation, entraînant le fait que pour <strong>la</strong> première fois les<br />
hommes se trouvaient confrontés en permanence aux mêmes conditions climatiques et<br />
éléments environnementaux, facilitant ainsi les expérimentations et <strong>la</strong> compréhension <strong>des</strong><br />
phénomènes naturels. Ce<strong>la</strong> favorise ainsi les innovations techniques comme l’adoption de<br />
l’agriculture. On comprend donc <strong>la</strong> nécessité de bien connaître cet environnement en tant<br />
que cadre d’é<strong>la</strong>boration de ces techniques. Ce<strong>la</strong> <strong>est</strong> d’autant plus important qu’il s’agit là<br />
d’une période de changements climatiques constants.<br />
A <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> Pléistocène, le Mésolithique <strong>est</strong> marqué par <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> période<br />
g<strong>la</strong>cière, ou tardig<strong>la</strong>cière, et le début d’une période de réchauffement, entrecoupée <strong>des</strong><br />
pério<strong>des</strong> plus ru<strong>des</strong> <strong>du</strong> Dryas II et Dryas récent (Aurenche-Kozlowski 1999: 15). Ainsi, le<br />
13
Kébarien <strong>est</strong> re<strong>la</strong>tivement froid, humide, le <strong>Le</strong>vant <strong>est</strong> couvert d’un boisement léger, les<br />
gazelles sont abondantes ainsi que les équidés. <strong>Le</strong> Natoufien récent présente une steppe<br />
re<strong>la</strong>tivement sèche et plus chaude. Pour le Néolithique, il s’agit d’un climat simi<strong>la</strong>ire mais<br />
plus chaud et plus sec (proche de l’actuel). La fin <strong>du</strong> Dryas III <strong>est</strong> marquée par une<br />
ripisylve dense et sèche, plus aride dès le PPNB (Hemer et alii 1998 :14-7). Il <strong>est</strong> certain<br />
que ces éléments ont joué un rôle décisif <strong>dans</strong> l’imp<strong>la</strong>ntation au Proche-Orient <strong>des</strong> types<br />
sauvages de céréales qui furent dom<strong>est</strong>iquées par <strong>la</strong> suite au <strong>Le</strong>vant et en Anatolie<br />
(Hillman 1996: 195-6; Sherratt 1997: 278-81).<br />
Or, il <strong>est</strong> intéressant de constater que ce réchauffement climatique, qui a d’abord<br />
permis aux hommes de se sédentariser, <strong>est</strong> apparu au <strong>Le</strong>vant beaucoup plus tôt qu’en<br />
Anatolie, où le même climat froid et sec a per<strong>du</strong>ré jusque vers 10000 BC, comme le<br />
montrent les étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> données palynologiques et géologiques (Van Zeist - Bottema<br />
1991 : 65,118-125). Ceci serait dû à <strong>la</strong> position plus septentrionale et montagnarde <strong>du</strong><br />
<strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien, ainsi qu’à une différence <strong>du</strong> régime <strong>des</strong> vents (Balkan-Atli 1994 : 143).<br />
C’<strong>est</strong> ainsi que Balkan-Atli (1994 : 17, 59) et Ozdogan (1998 : 34) expliquent l’apparent<br />
vide de popu<strong>la</strong>tion, <strong>du</strong> moins sédentaire de plein air, à cette époque en Anatolie, alors<br />
qu’au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> florissaient les sites natoufiens. Ce n’<strong>est</strong> sans doute pas une coïncidence<br />
si, d’ailleurs, les sites <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> sont eux-mêmes beaucoup plus nombreux qu’au<br />
<strong>Le</strong>vant nord. <strong>Le</strong>s sites de <strong>la</strong> Bozova près d’Urfa en Anatolie <strong>sud</strong>-orientale (Biris<br />
Mezarligi et Sögüt Tar<strong>la</strong>si) semblent bien att<strong>est</strong>er une faible présence cependant, <strong>dans</strong> <strong>des</strong><br />
habitats de grotte, dès le Mésolithique, et d’origine probablement orientale, zarzienne ou<br />
trialétienne, qui per<strong>du</strong>rera au PPNA d’Hal<strong>la</strong>n Cemi et de Cayönü.<br />
Ensuite, à <strong>la</strong> transition <strong>du</strong> Mésolitique et <strong>du</strong> PPNA, les améliorations climatiques<br />
de l’Holocène gagne les hautes vallées anatoliennes favorisant <strong>la</strong> sédentarisation de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion, avec un point d’orgue au PPNB. Si nous partageons l’avis de M. Ozdogan<br />
(1998 : 34) sur le fait que les premières popu<strong>la</strong>tions anatoliennes ne viennent pas <strong>du</strong> <strong>sud</strong>,<br />
par <strong>la</strong> suite, l’optimum climatique de l’Holocène apportera à <strong>la</strong> région, au travers les sites<br />
de <strong>la</strong> région d’Urfa en amont de l’Euphrate, les influences <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant. A en croire <strong>la</strong><br />
capacité de stockage <strong>des</strong> céréales <strong>dans</strong> les structures <strong>des</strong> maisons <strong>des</strong> Pério<strong>des</strong> 2 et surtout<br />
3, cet optimum climatique couplé à l’environnement montagneux d’Anatolie, sera<br />
profitable non seulement à une chasse et une cueillette intenses, mais aussi à l’agriculture<br />
pré-dom<strong>est</strong>ique puis dom<strong>est</strong>ique.<br />
14
Périodisation<br />
Concernant <strong>la</strong> périodisation de l’époque néolithique au Proche-Orient, plusieurs<br />
systèmes ont été essayés sans rarement parvenir à un accord général. Celui qui <strong>est</strong> le plus<br />
utilisé jusqu'à présent <strong>est</strong> le système mis en p<strong>la</strong>ce par Kathleen Kenyon <strong>dans</strong> les années<br />
50 (Aurenche-Kozlowski 99: 36-37) à partir <strong>des</strong> données provenant de ses fouilles à<br />
Jéricho. Devant <strong>des</strong> niveaux anciens contenant un matériel d'apparence néolithique mais<br />
sans céramique, <strong>la</strong> notion de Pre-Pottery Neolithic fut intro<strong>du</strong>ite, ultérieurement séparée<br />
en deux sous-phases, PPNA et PPNB.<br />
Aujourd'hui, ces notions, surtout celle de PPNA, même si elles se prêtaient plus<br />
ou moins bien au contexte de Jéricho, ne reflètent plus les réalités <strong>des</strong> recherches<br />
récentes. Moore (1982) a proposé une périodisation en quatre phases (Néolithique 1 à 4)<br />
suivant les innovations techniques de chaque époque. Si le concept <strong>est</strong> plus sain, les<br />
recherches de ces vingt dernières années demandent que quelques modifications soient<br />
apportées à ce système. Cauvin (1997) préfère, lui, parler de cultures que d'horizons<br />
chronologiques; une méthode qui semble en effet plus en concordance avec les faits. C'<strong>est</strong><br />
ainsi qu'il parle de "culture PPNB <strong>du</strong> Taurus" (1997: 117-127) et qu'il remp<strong>la</strong>ce, au<br />
<strong>Le</strong>vant, le désuet concept de PPNA par les cultures khiamienne, puis sultanienne (au<br />
<strong>sud</strong>), mureybetienne (au nord) et aswadienne (au centre) selon les régions concernées.<br />
Enfin, <strong>la</strong> Maison de l'Orient à Lyon a proposé une périodisation de 1 à 5, publiée<br />
<strong>dans</strong> leur At<strong>la</strong>s <strong>des</strong> sites <strong>du</strong> Proche-Orient (Hours et alii 1994) et fondée sur une<br />
terminologie de phases proto-néolithiques et néolithiques suivant l’in<strong>du</strong>strie lithique, le<br />
développement architectural et le mode de subsistance (chasseur-cueilleur ou agriculteuréleveur)<br />
<strong>des</strong> groupes concernés.<br />
La périodisation que nous utilisons <strong>est</strong> empreinte <strong>du</strong> type instauré par Cauvin en<br />
essayant tant que possible d’imposer le concept de groupes culturels et d’apporter à ce<br />
panorama <strong>des</strong> limites géographiques. Nous suivrons, en parallèle, Moore et <strong>la</strong> Maison de<br />
l'Orient en adoptant un système numérique neutre (1à 3, puis subdivisé), qui s’appuie sur<br />
les changements techno-économiques apparents, pour présenter une vision plus globale<br />
<strong>du</strong> développement néolithique. Ce<strong>la</strong> nous semble un procédé viable pour présenter <strong>la</strong><br />
complexité <strong>du</strong> phénomène.<br />
15
Voici comment se présente <strong>la</strong> version simplifiée de notre système de périodisation<br />
qui concilie terminologies et dates absolues calibrées:<br />
12500-10000 av. JC Période 1 Mésolithique final<br />
10000-8700 av. JC Période 2 PPNA (Pre Pottery<br />
Neolithic A)<br />
8700-7000 av. JC Période 3 PPNB (Pre Pottery<br />
Neolithic B)<br />
Il <strong>est</strong> à noter que nous avons décerné quelques différences <strong>dans</strong> <strong>la</strong> chronologie<br />
utilisée par les archéologues travail<strong>la</strong>nt en Anatolie, qui se réfèrent généralement à <strong>la</strong><br />
chronologie mise en p<strong>la</strong>ce à Çayönü, ce qu’il faut garder à l’esprit pour éviter les<br />
confusions. Ceci vaut en particulier pour <strong>la</strong> date de transition entre le PPNA et le PPNB,<br />
comme en témoigne <strong>la</strong> comparaison de ces deux tableaux (fig. 2 et 8) pour lesquels les<br />
mêmes dates BP n’ont pas <strong>la</strong> même désignation périodique ; <strong>la</strong> confusion apportée par <strong>la</strong><br />
calibration <strong>des</strong> dates pourrait bien en être <strong>la</strong> raison. Enfin, il <strong>est</strong> possible que ce déca<strong>la</strong>ge<br />
provienne également d’un véritable fossé chronologie entre les deux régions. En d’autres<br />
termes, il <strong>est</strong> évident que le fait d’appliquer une seule et unique périodisation à <strong>des</strong><br />
régions n’ayant pas connu le même développement historique aboutit forcément à<br />
quelques approximations.<br />
Ceci dit, nous choisissons ce système périodique unique ici pour <strong>des</strong> raisons<br />
diverses : d’abord le cadre r<strong>est</strong>reint de cette étude ne nous permet pas de nous étendre sur<br />
<strong>des</strong> problèmes chronologiques trop long à résoudre et qui pourront intégrer <strong>la</strong><br />
problématique d’un travail de thèse à suivre ; d’autre part, nous considérons le Proche-<br />
Orient comme une entité régionale, et l’adoption d’une seule chronologie, viable partout<br />
<strong>dans</strong> ses gran<strong>des</strong> lignes, facilite les comparaisons et apporte une vision d’ensemble plus<br />
c<strong>la</strong>ire sur le processus de <strong>la</strong> néolithisation.<br />
16
III<br />
-<br />
L’in<strong>du</strong>strie lithique<br />
17
La poterie sert de référent principal pour les archéologues <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> à<br />
céramique afin de déterminer une certaine chronologie re<strong>la</strong>tive et le degré d’interaction<br />
<strong>des</strong> cultures anciennes. Pour les pério<strong>des</strong> précéramique, ce rôle <strong>est</strong> rempli par le matériel<br />
lithique, <strong>du</strong> fait de sa représentation dense et son état de préservation, même si l’arbitraire<br />
culturel y tient moins d’importance que <strong>dans</strong> <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong> céramique.<br />
L'état de <strong>la</strong> recherche sur le Néolithique précéramique <strong>du</strong> Proche-Orient souffre<br />
aujourd'hui de certaines <strong>la</strong>cunes quant à <strong>la</strong> compréhension de son développement<br />
chronologique et géographique. Il <strong>est</strong> donc primordial de se reporter aux assemb<strong>la</strong>ges<br />
lithiques <strong>des</strong> différentes régions concernées - que l'on pourrait définir comme <strong>la</strong> moitié<br />
nord <strong>du</strong> Croissant Fertile- pour essayer de r<strong>est</strong>ituer leurs correspondances<br />
chronologiques.<br />
<strong>Le</strong>s préhistoriens, dès <strong>Le</strong>roi-Gourhan, ont montré que l'in<strong>du</strong>strie lithique, étudiée<br />
selon <strong>la</strong> méthode de <strong>la</strong> chaîne opératoire, recèle une mine d'informations très importante<br />
sur <strong>la</strong> société pro<strong>du</strong>ctrice. Ici, nous nous attacherons à trois phases ou étapes de cette<br />
chaîne qui sont, chronologiquement, l'acquisition, <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction et le pro<strong>du</strong>it fini, car elles<br />
révèlent au mieux, <strong>dans</strong> ce cas, <strong>des</strong> tendances caractéristiques de traditions culturelles.<br />
Nous ne garderons pas cet ordre car c’<strong>est</strong>, tout d’abord, le pro<strong>du</strong>it fini qui s’<strong>est</strong><br />
établi comme véritable fossile directeur pour l'établissement d'un repère chrono-culturel<br />
de ces régions. En effet, <strong>la</strong> meilleure arme dont dispose le chercheur pour <strong>la</strong> datation <strong>du</strong><br />
Néolithique précéramique, <strong>est</strong> celle d'une typologie de pointes de flèches. Celle-ci <strong>est</strong><br />
bien documentée et assez précise pour démontrer un cheminement, <strong>dans</strong> le temps et <strong>dans</strong><br />
l'espace, <strong>des</strong> différents types puisqu’elles sont présentes <strong>dans</strong> tous les sites néolithiques,<br />
que leur développement <strong>est</strong> re<strong>la</strong>tivement rapide et qu’elles sont, par leur morphologie,<br />
<strong>des</strong> marqueurs culturels c<strong>la</strong>irs (Gopher 1989 : 44). Dès le début se distinguent, au Moyen-<br />
Orient, deux gran<strong>des</strong> familles (<strong>Le</strong>vant et Zagros), trop souvent étudiées à part, alors<br />
qu’un grand nombre de corré<strong>la</strong>tions montrent qu'elles doivent être mises en parallèle.<br />
Ensuite, <strong>la</strong> qu<strong>est</strong>ion sera de savoir, à partir <strong>des</strong> assemb<strong>la</strong>ges proposés pour chaque site, où<br />
se trouve <strong>la</strong> limite ou l’espace d'interaction de ces deux gran<strong>des</strong> zones principales et s'il y<br />
a une fluctuation de celles-ci <strong>dans</strong> le temps.<br />
Aussi, l'étude de l'acquisition et <strong>du</strong> transport de matière première a eu <strong>des</strong> résultats<br />
étonnants. <strong>Le</strong>s analyses géochimiques, en particulier, sur le matériel lithique de ces<br />
régions ont permis d'identifier l'un <strong>des</strong> premiers exemples d’échange à longue distance<br />
connus. En effet, au <strong>Le</strong>vant une partie de ces pointes de flèches <strong>est</strong> taillée <strong>dans</strong><br />
l'obsidienne, dont <strong>la</strong> provenance exacte a pu être déterminée: <strong>la</strong> Cappadoce et le <strong>la</strong>c de<br />
18
Van en Anatolie. <strong>Le</strong>s pro<strong>du</strong>its de ces gisements ont été retrouvés à plusieurs milliers de<br />
kilomètres jusque sur <strong>des</strong> sites <strong>du</strong> <strong>sud</strong> <strong>Le</strong>vant.<br />
Enfin, un marqueur temporel et géographique d'importance <strong>est</strong> constitué par<br />
l'identification de l'adoption de techniques de débitage différenciées : uni- ou bipo<strong>la</strong>ire,<br />
<strong>la</strong>minaire ou <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>ire, percussion indirecte ou par pression.<br />
La recherche sur le Néolithique s’<strong>est</strong> concentrée tout d'abord sur le <strong>Le</strong>vant,<br />
puisque c'<strong>est</strong> là qu'on pensait trouver ses origines, et notamment celle de l'agriculture<br />
(Ozdogan 1997: 3-5, 1998: 26). Même si <strong>la</strong> tendance s'<strong>est</strong> récemment atténuée, en<br />
particulier en faveur de l'Anatolie et <strong>du</strong> Zagros, il y a toujours aujourd'hui une banque de<br />
données beaucoup plus importante sur le <strong>Le</strong>vant. C'<strong>est</strong> donc pour ce<strong>la</strong> que <strong>la</strong> typologie<br />
<strong>des</strong> pointes de flèches y a été établie.<br />
Il <strong>est</strong> intéressant de présenter cette typologie et de voir ensuite comment elle<br />
s'adapte aux assemb<strong>la</strong>ges néolithiques voisins (<strong>du</strong> Zagros et <strong>du</strong> Taurus).<br />
I-Typologie <strong>des</strong> pointes de flèches<br />
De manière générale, on peut chronologiquement diviser l’ensemble de <strong>la</strong> période<br />
en qu<strong>est</strong>ion en deux gran<strong>des</strong> phases:<br />
- <strong>la</strong> phase microlithique impliquant <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de <strong>la</strong>melles (souvent moins de 3<br />
centimètres) qui caractérise <strong>la</strong> tradition mésolithique et le début <strong>du</strong> PPNA, que nous<br />
préférons appeler les Pério<strong>des</strong> 1et 2a puisqu’elles constituent bien les premières étapes <strong>du</strong><br />
phénomène de néolithisation.<br />
- <strong>la</strong> phase dénommée "Big Arrowhead In<strong>du</strong>stry"(BAI) par Kozlowski<br />
(Aurenche-Kozlowski 1999: 103), qui att<strong>est</strong>e <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction massive de <strong>la</strong>mes longues (de<br />
5 à 10 centimètres) et régulières à partir de <strong>la</strong> deuxième moitié <strong>du</strong> 9ème millénaire (bien<br />
que ses origines soient att<strong>est</strong>ées dès <strong>la</strong> Période 2) et qui caractérise <strong>la</strong> deuxième moitié de<br />
<strong>la</strong> Période 3 (PPNB Moyen et Final).<br />
-On peut donc considérer le PPNA récent (2b) et le PPNB ancien (3a) comme <strong>des</strong><br />
pério<strong>des</strong> de transition.<br />
19
A- le <strong>Le</strong>vant<br />
D’après O. Bar-Yosef (1981: 555-569), partisan et auteur d'une simplification<br />
typologique et J.Cauvin (1999), voici une c<strong>la</strong>ssification chronologique <strong>des</strong> pointes de<br />
flèches (fig Gopher). Elle a été réalisée en prenant en compte et en confrontant les<br />
artefacts stratifiés de dizaines de sites de tout le <strong>Le</strong>vant, tels que Mureybet au nord,<br />
Aswad au centre et Nahal Oren et Jéricho au <strong>sud</strong>. La typologie s'applique même au <strong>sud</strong><br />
<strong>du</strong> Sinaï (Ujrat Suleiman) à l'Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> sans oublier le Liban pour les pério<strong>des</strong><br />
anciennes et finales <strong>du</strong> PPNB.<br />
Période 1<br />
Mésolithique final ou<br />
Natoufien<br />
les pointes de Harif, Halutza<br />
et Abu Madi (fig)<br />
Période 2a PPNA ancien ou Khiamien pointe d'el-Khiam (fig)<br />
Période 2b<br />
Période 3a<br />
Période 3b<br />
Période 3c<br />
PPNA récent ou<br />
Mureybétien<br />
PPNB ancien<br />
PPNB Moyen<br />
PPNB récent<br />
baisse de <strong>la</strong> pointe d’el-<br />
Khiam, début de <strong>la</strong><br />
pointe d'Hélouan et de<br />
Nevali Cori<br />
pointe d'Hélouan et de<br />
Nevali Cori<br />
pointe de Jericho et pointe<br />
de Byblos<br />
pointe de Byblos et pointe<br />
d'Amuq<br />
Ce tableau <strong>est</strong> schématique et <strong>la</strong> réalité n’<strong>est</strong> pas, de toute évidence aussi rigide,<br />
c’<strong>est</strong> cependant bien selon ce schéma que les pointes de flèches représentent l’indice<br />
principal de caractérisation chronologique.<br />
Ces pointes de flèches ont également fait l’objet d’une analyse scientifique,<br />
fondée sur <strong>la</strong> méthode de <strong>la</strong> sériation, qui bâtit <strong>des</strong> chronologies re<strong>la</strong>tives, sous forme de<br />
courbes de popu<strong>la</strong>rité. La sériation s’appuie sur l’idée que tout type d’artefact connaît une<br />
période d’invention comprenant peu de spécimens, de croissance de sa popu<strong>la</strong>rité,<br />
d’apogée et de déclin jusqu’à sa disparition (Fagan 1994 : 89-92). Cette analyse menée à<br />
20
partir de centaines d’assemb<strong>la</strong>ges, soigneusement choisis (notamment <strong>dans</strong> <strong>des</strong> sites unistratigraphiques),<br />
totalisant quelques 15000 pointes, vient corroborer ces résultats<br />
(Gopher 1989 : 43-6).<br />
B- La typologie lithique <strong>du</strong> Zagros, qui peut plus difficilement se ré<strong>du</strong>ire à <strong>la</strong><br />
typologie d'un fossile directeur telle que celle <strong>des</strong> pointes de flèches, et qui s'étend sans<br />
doute vers l'ou<strong>est</strong> (La Djézireh et les Hautes Vallées anatoliennes) présente les caractères<br />
suivants (Aurenche et Kozlowski 1999: 84-88):<br />
- Période 1 / Epipaléolithique: le Zarzien (12000-10300) <strong>est</strong> une pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>ire à<br />
percussion indirecte de microlithes géométriques (segments, triangles) et de <strong>la</strong>melles à<br />
dos rectilignes.<br />
- Pério<strong>des</strong> 2 et 3/ PPNA - PPNB: le Mléfatien <strong>est</strong> <strong>la</strong> continuation directe <strong>du</strong> Zarzien, sauf<br />
pour ce qui <strong>est</strong> <strong>du</strong> débitage à <strong>la</strong> pression (sur nucleus conique à un p<strong>la</strong>n de frappe). La<br />
pointe de Nemrik <strong>est</strong> absente.<br />
- Pério<strong>des</strong> 2 et 3/ PPNA - PPNB: le Nemrikien s’installe <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Djézireh (10200- 6500<br />
av.JC.) et découle lui aussi <strong>du</strong> Zarzien et se distingue principalement grâce à <strong>la</strong> présence<br />
de pointes de Nemrik (fig ) <strong>dans</strong> ses assemb<strong>la</strong>ges.<br />
C- les Hautes Vallées anatoliennes<br />
Nous pouvons dès à présent ajouter un troisième type régional, originaire <strong>du</strong><br />
Caucase, qui se retrouvera <strong>dans</strong> les Hautes Vallées anatoliennes dès <strong>la</strong> Période 1et<br />
jusqu'au début de <strong>la</strong> Période 3; il s'agit de <strong>la</strong> tradition dite trialétienne, caractérisée par<br />
un débitage <strong>la</strong>mino-<strong>la</strong>mel<strong>la</strong>ire (c’<strong>est</strong>-à-dire de gran<strong>des</strong> <strong>la</strong>melles) par percussion indirecte<br />
d’éléments géométriques et d’outils de plus grande taille que ceux <strong>des</strong> deux autres<br />
traditions (fig) (Aurenche-Kozlowski 1999: 21-22). En fait, bien qu’ils soient<br />
traditionnellement rangés sous cette définition, notamment à cause de leur appartenance<br />
chronologique au Mésolithique, il ne s’agit pas vraiment de microlithes car les outils<br />
atteignent facilement 3 à 5 centimètres de hauteur. Aucun type de pointe ne caractérise<br />
vraiment le Trialétien.<br />
A partir <strong>du</strong> milieu de <strong>la</strong> Période 3 (PPNB moyen et récent), les pointes de Byblos<br />
et d’Amuq (BAI) représentent, à l’instar <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant, <strong>la</strong> quasi totalité de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>des</strong><br />
pointes, de manière particulièrement uniforme. Nous essaierons de comprendre comment<br />
s’<strong>est</strong> opéré ce changement brusque d’un type de pro<strong>du</strong>ction mésolithique à celui de <strong>la</strong><br />
BAI. S’agit-il simplement d’une diffusion levantine <br />
Pour y répondre nous allons regarder cette séquence de développement de <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction lithique plus en détail, par période, en étudiant d’abord <strong>la</strong> situation <strong>dans</strong> le<br />
21
Proche Orient en général et au <strong>Le</strong>vant et <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Zagros en particulier pour pouvoir enfin<br />
mieux comprendre et évaluer le développement <strong>du</strong> lithique en Anatolie.<br />
II- La période 1 (Mésolithique) et 2 (PPNA)<br />
L’in<strong>du</strong>strie mésolithique <strong>est</strong> caractérisée par <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de microlithes (souvent<br />
moins de 3 centimètres) et par sa forte proportion de pointes sur <strong>la</strong>melles faites en<br />
percussion indirecte, qui, emmanchés à 2 ou 3 pièces sur un support en bois ou en os,<br />
servent d’armes, notamment de pointes de flèches ou d’outils tels que <strong>des</strong> faucilles (fig).<br />
A- Au <strong>Le</strong>vant, <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique sur <strong>la</strong>melles <strong>du</strong> Mésolithique <strong>est</strong> d’abord<br />
irrégulière à retouches fines au Kébarien ancien, à retouches abruptes au Kébarien<br />
c<strong>la</strong>ssique (19000-12500 BC) et elle <strong>est</strong> ensuite caractérisée par <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de trapèzes<br />
et de rectangles au Kébarien géométrique. Ceux-ci disparaissent au profit <strong>des</strong> segments et<br />
de triangles au Natoufien (12500- 10000 BC) (Val<strong>la</strong> 1988 : 316). La plus grande<br />
concentration de sites se trouve en Galilée et près <strong>du</strong> Mont Carmel, mais ils se trouvent<br />
également <strong>dans</strong> le Néguev au <strong>sud</strong>, à l’<strong>est</strong> <strong>du</strong> Jourdain et au <strong>sud</strong> Liban.<br />
2a- L'in<strong>du</strong>strie Khiamienne, qui domine <strong>la</strong> première moitié <strong>du</strong> PPNA, hérite encore<br />
beaucoup de ses prédécesseurs natoufiens, occupant <strong>la</strong> même éten<strong>du</strong>e géographique,<br />
comme le montre son aspect microlithique, qui s’<strong>est</strong>ompe cependant peu à peu au profit<br />
de <strong>la</strong>melles plus gran<strong>des</strong>. <strong>Le</strong>s perçoirs se multiplient (Bar-Yosef 1981: 561-2). La pointe<br />
d’el-Khiam (fig) qui tient son nom <strong>du</strong> site éponyme au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong>, <strong>est</strong> un <strong>des</strong> marqueurs<br />
de cette période. Elle <strong>est</strong> généralement retouchée à <strong>la</strong> pointe et à <strong>la</strong> base qui, souvent<br />
concave ou rectiligne, dispose d'une paire 'encoches <strong>la</strong>térales. Au <strong>Le</strong>vant nord, cette<br />
pointe <strong>est</strong> seulement connue sur le site de Mureybet.<br />
2b- <strong>Le</strong> Mureybétien (fig) suit le Khiamien <strong>dans</strong> <strong>la</strong> deuxième partie <strong>du</strong> PPNA au<br />
<strong>Le</strong>vant nord (son équivalent au <strong>sud</strong> <strong>est</strong> le Sultanien). <strong>Le</strong> Mureybétien <strong>est</strong> reconnaissable à<br />
une pro<strong>du</strong>ction de plus grande taille. Même si les pointes el-Khiam y persistent, elles sont<br />
gra<strong>du</strong>ellement remp<strong>la</strong>cées par les pointes d'Hélouan (fig ) que l’on peut considérer<br />
comme le début <strong>du</strong> débitage de <strong>la</strong>mes. Elles représentent le premier pas vers <strong>la</strong> BAI<br />
(Aurenche-Kozlowski 1999: 139). Elles possèdent, en guise de base, un petit pédoncule<br />
marqué (en épaulement) et conservent <strong>la</strong> paire d'encoches qui <strong>est</strong> même fréquemment<br />
redoublée. Une autre pointe de flèche fait également son apparition à <strong>la</strong> fin de cette<br />
période, <strong>la</strong> pointe de Nevali Cori, qui ressemble à une pointe d’el-Khiam sans encoche et<br />
de taille bien plus grande. <strong>Le</strong>s faucilles sur <strong>la</strong>mes à dos, les haches polies ou affûtées par<br />
22
frappes transversales <strong>du</strong> type tranchet sont prisées. Ce type d'in<strong>du</strong>strie <strong>est</strong> présent non<br />
seulement à Mureybet, mais également à Jerf el-Ahmar et à Cheikh Hassan.<br />
Il <strong>est</strong> à noter qu’au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong>, le Sultanien (fig), ainsi qu’il <strong>est</strong> représenté à<br />
Jéricho, accuse déjà un certain retard en ceci que les pointes d'el-Khiam domineront<br />
jusqu'à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> Période 2, certaines avec une légère modification formée par l'absence<br />
d’encoche, ressemb<strong>la</strong>nt ainsi aux pointes de Nevali Cori sous un modèle encore<br />
microlithique (Aurenche Kozlowski 1999 : 139). L’analyse de sériation sur les pointes de<br />
flèches a également montré que <strong>la</strong> pointe d’Hélouan, qui annonce les gran<strong>des</strong> <strong>la</strong>mes <strong>du</strong><br />
PPNB, se diffusait c<strong>la</strong>irement <strong>du</strong> Moyen-Euphrate syrien pour se retrouver d’abord au<br />
<strong>Le</strong>vant central puis, encore plus tardivement, au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> (fig ) (Gopher 1989 : 49-51).<br />
Même si le Sultanien n’<strong>est</strong> plus une in<strong>du</strong>strie mésolithique, avec quelques pro<strong>du</strong>ctions<br />
<strong>la</strong>minaires tardives, <strong>des</strong> retouches bifaciales et de rares microlithes (<strong>Le</strong>chevallier et alii<br />
1989 : 2), le début <strong>du</strong> phénomène BAI ne s'y fera sentir qu'à <strong>la</strong> période suivante.<br />
B- La pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> Zagros <strong>est</strong> unifiée sous le terme culturel et technologique<br />
de Zarzien à <strong>la</strong> Période 1 sur tout l’<strong>est</strong> <strong>du</strong> Croissant Fertile, où <strong>la</strong> technique de percussion<br />
indirecte donne <strong>des</strong> <strong>la</strong>melles irrégulières à bords on<strong>du</strong>lés. <strong>Le</strong> site de Qermez Dere le<br />
représente au mieux. <strong>Le</strong> Zarzien se divise, à <strong>la</strong> Période 2, en deux entités régionales<br />
différentes. A l'<strong>est</strong>, le Zarzien devient Mléfatien, d'après l'assemb<strong>la</strong>ge lithique <strong>du</strong> site <strong>du</strong><br />
piedmont <strong>du</strong> Zagros, bien que cette transition soit surtout repérable à Zawi Chemi et <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> zone montagneuse. La technique change; de débitage par percussion indirecte, on passe<br />
au débitage par pression ; les segments et les géométriques en général se font donc plus<br />
rares, pour <strong>la</strong>isser une p<strong>la</strong>ce plus importante aux <strong>la</strong>melles à dos rectilignes, qui s’en<br />
trouvent moins <strong>la</strong>rges. Tout ceci vaut également pour le Nemrikien à l'ou<strong>est</strong>, <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
Djézireh, qui <strong>est</strong> seulement différencié grâce à <strong>la</strong> présence de pointes de Nemrik (fig ).<br />
Elles sont de petite taille, avec quelques retouches sur les contours de <strong>la</strong> base et de <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>me, sans pédoncule, et de forme presque parfaitement losangique (Aurenche-Kozlowski<br />
1999: 140, 2000: 84-5). Ce type de pointe, tout comme ces deux traditions lithiques,<br />
auront une longue existence, jusqu'à <strong>la</strong> période céramique. Il att<strong>est</strong>e, à <strong>la</strong> différence de <strong>la</strong><br />
branche occidentale <strong>du</strong> Croissant Fertile à <strong>la</strong> Période 3, l'absence de débitage bipo<strong>la</strong>ire.<br />
Plusieurs pointes d'el-Khiam ont été retrouvées en contexte nemrikien (Kozlowski 1989:<br />
32), et présentent une trace irréfutable de contacts plus ou moins soutenus dès <strong>la</strong> Période<br />
2, et sans doute plus tôt, entre les deux régions. Cependant, <strong>la</strong> distance qui les sépare<br />
con<strong>du</strong>it à envisager <strong>la</strong> présence de groupes sédentaires <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région intermédiaire, c’<strong>est</strong>à-dire<br />
l'Anatolie (Watkins, Baird et Betts 1989: 23-4), qui a trop longtemps été regardée<br />
23
comme inhabitée à cette époque. <strong>Le</strong>s nouvelles recherches ont d’ailleurs montré qu’elle<br />
était bien peuplée.<br />
C- <strong>Le</strong>s Hautes Vallées qui, jusqu'à très récemment, étaient perçues comme<br />
dépourvues d’habitat au Mésolithique (voir l’At<strong>la</strong>s <strong>des</strong> Sites <strong>du</strong> Proche Orient,<br />
1994, « Période 0 ») et au PPNA, révèlent peu à peu leurs secrets. D’abord, de<br />
nombreuses prospections ont permis de découvrir plusieurs campements saisonniers à<br />
cette époque et sur lesquels nous reviendrons. Ensuite, depuis les fouilles de Rosenberg à<br />
Hal<strong>la</strong>n Cemi et Demirköy, l’absence de sites sédentaires entre <strong>Le</strong>vant et Zagros <strong>est</strong><br />
partiellement comblée. L'in<strong>du</strong>strie présente une origine vraisemb<strong>la</strong>blement caucasienne<br />
ou trialétienne (fig ). La pro<strong>du</strong>ction de gran<strong>des</strong> <strong>la</strong>melles – on peut même peut-être<br />
accepter le terme de supports <strong>la</strong>minaires - géométriques (segments, <strong>la</strong>melles à dos arqué,<br />
triangles scalènes et isocèles) par débitage en percussion indirecte <strong>la</strong> caractérise<br />
(Aurenche-Kozlowski 1999: 146). Pour le Mésolithique et le PPNA, elle était, jusqu’à<br />
récemment, toujours trouvée <strong>dans</strong> <strong>des</strong> campements tels que Dam Dam Cesme ou Belt.<br />
A propos de ces sites de campement, il <strong>est</strong> d’abord important de noter que, <strong>dans</strong><br />
les sites de <strong>la</strong> Bozova comme Biris Mezarligi et Sögüt Tar<strong>la</strong>si (Benedict 1980 : 179-81),<br />
<strong>des</strong> outils microlithiques semblent faire remonter <strong>la</strong> présence de groupes locaux très tôt, à<br />
<strong>la</strong> période mésolithique (Période 1) et montrent <strong>des</strong> signes qui les rapprochent également<br />
<strong>des</strong> cultures de <strong>la</strong> Djézireh et <strong>du</strong> Zagros (Ozdogan 1998: 32). Hauptmann (1999: 68-9)<br />
semble se contredire en proc<strong>la</strong>mant une évolution lithique <strong>la</strong>rgement indépendante de<br />
celle <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant pour ces sites et en ajoutant que <strong>des</strong> éléments kébariens sont évidents<br />
<strong>dans</strong> l’in<strong>du</strong>strie <strong>du</strong> silex de Biris Mezarligi. La présence d'outils en obsidienne, à une<br />
époque où on les trouve déjà au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong>, démontre non seulement que, dès cette<br />
période ancienne, les popu<strong>la</strong>tions locales s'adonnaient au commerce de ce pro<strong>du</strong>it, mais<br />
surtout que ce commerce s’opérait avec le <strong>Le</strong>vant. Aussi, selon Balkan-Atli (1994 : 49,<br />
100), parmi les 2532 artefacts rassemblés par Benedict, ceux dits microlithiques sont en<br />
fait <strong>des</strong> micro grattoirs doubles sur <strong>la</strong>mes, mais les microlithes vraiment représentatifs <strong>du</strong><br />
Mésolithique, tels que les segments ou les triangles, y sont absents. Elle propose donc une<br />
date plus récente, le Néolithique, pour ces deux sites. En fait, nous pensons qu’il s’agit<br />
précisément de pièces de tradition trialétienne locale qui possèdent de fait <strong>des</strong><br />
caractéristiques très différentes <strong>du</strong> Natoufien qui était à l’époque de <strong>la</strong> publication de<br />
Balkan-Atli, le seul référent mésolithique connu <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région. En effet, ces pièces sont<br />
bien plus gran<strong>des</strong> que leurs contemporaines <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant et les géométriques (tels que les<br />
segments et les triangles scalènes) sont absents. Benedict parle bien d’une abondance de<br />
24
microlithes <strong>dans</strong> les sites de <strong>la</strong> Bozova. De plus, non seulement Hauptmann et Howe très<br />
récemment (Hauptmann 1999: 69 note 29), mais aussi Cambel, ont opté pour une date<br />
mésolithique. L’absence d’architecture, <strong>du</strong>e aux conditions climatiques trop ru<strong>des</strong>,<br />
interdisant l’adoption de <strong>la</strong> sédentarisation, semble également indiquer que ce soit <strong>la</strong> date<br />
<strong>la</strong> plus probable. Aussi, d’autres sites de cette date sont connus un peu plus au nord tels<br />
que Pinarbasi, Pa<strong>la</strong>nli ou Uluk (Hours et alii 1994 : « Période 1»). En 1994, avant les<br />
fouilles de Hal<strong>la</strong>n Cemi, Balkan-Atli ne pouvait soupçonner <strong>la</strong> présence de Trialétien en<br />
Anatolie, mais c’<strong>est</strong> bien de ça qu’il s’agit. Cependant, nier toute influence avec le <strong>Le</strong>vant<br />
ne semble pas correct, surtout si l’on considère le commerce de l’obsidienne. Il <strong>est</strong><br />
également possible que Sögüt Tar<strong>la</strong>si, selon Hauptmann, et peut-être Biris Mezarligi,<br />
selon Bicakci (1998: 137), continuent d’exister jusqu’au PPNB, au vu de <strong>la</strong> présence de<br />
certaines pointes de projectile, ce qui pourrait également expliquer <strong>la</strong> position tenue par<br />
Balkan-Atli.<br />
Ne faisant pas état <strong>du</strong> site de Hal<strong>la</strong>n Cemi, qui commençait à peine à être fouillé<br />
à l’époque, Balkan-Atli conclut à un vide quasi total de popu<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> Période 1 en<br />
Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>. Malgré les récentes découvertes, et <strong>la</strong> nouveauté <strong>des</strong> recherches, il<br />
faut tout de même admettre une certaine disparité <strong>des</strong> sites, comme le confirment les<br />
prospections de Todd, Benedict, Ozdögan, Kökten, Whallon, Bostanci et d’autres<br />
(Balkan-Atli 1994 : 47), par rapport au <strong>Le</strong>vant tout particulièrement. Ceci semble<br />
s’expliquer climatiquement (voir environnement).<br />
Ensuite, depuis les fouilles de Rosenberg à Hal<strong>la</strong>n Cemi et Demirköy, l’absence<br />
de sites sédentaires entre <strong>Le</strong>vant et Zagros pour les Pério<strong>des</strong> 1et 2 (respectivement) <strong>est</strong><br />
partiellement comblée. Hal<strong>la</strong>n Cemi présente, selon Rosenberg (1999 : 29), une<br />
pro<strong>du</strong>ction sur <strong>la</strong>me, ce qui semble étrange pour une pro<strong>du</strong>ction mésolithique. Ce<strong>la</strong><br />
pourrait par contre correspondre, selon <strong>la</strong> grande taille de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction qu’implique le<br />
débitage de <strong>la</strong>mes géométriques - le terme de grande <strong>la</strong>melle <strong>est</strong> peut-être ici plus<br />
approprié - par débitage en percussion indirecte, à <strong>la</strong> tradition trialétienne (Aurenche-<br />
Kozlowski 1999: 146), ce que ne dément pas <strong>la</strong> présence ponctuelle de segments et celle<br />
plus importante, de triangles scalènes. Il <strong>est</strong> intéressant de noter que tout élément<br />
natoufien, comme les <strong>la</strong>melles à dos et troncatures ou les pointes d’el-Khiam, <strong>est</strong> absent<br />
de l’assemb<strong>la</strong>ge <strong>du</strong> site, écartant cette possibilité quant à son origine (Aurenche-<br />
Kozlowski 1999: 167, 146). Cependant, une influence zarzienne <strong>du</strong> Zagros <strong>est</strong> également<br />
25
très c<strong>la</strong>ire comme le montrent les pilons sculptés et polis d’Hal<strong>la</strong>n Cemi (fig) qui<br />
ressemblent beaucoup à ceux de Nemrik 9 (fig) (Rosenberg et alii 1998: 29 ; Rosenberg<br />
1992 : 117).<br />
Nous sommes donc désormais en possession de suffisamment d’éléments pour<br />
affirmer <strong>la</strong> présence en Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> à <strong>la</strong> période mésolithique d’une popu<strong>la</strong>tion<br />
reconnue et dénommée trialétienne. L’origine de cette culture a été dite caucasienne sans<br />
doute parce que c’<strong>est</strong> <strong>dans</strong> cette région qu’elle a d’abord été découverte, mais il ne nous<br />
semble pas erroné de penser que cette culture englobe également à part entière <strong>la</strong> région<br />
<strong>des</strong> Hautes Vallées et qu’elle peut donc être considérée comme locale. <strong>Le</strong>s éléments<br />
zarziens présents <strong>dans</strong> les sites anatoliens proviennent sans doute d’une interaction<br />
commerciale, peut-être alimentée par l’obsidienne.<br />
L’étude de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique permet de discerner une certaine différence<br />
chronologique entre Hal<strong>la</strong>n Cemi et Demirköy. La plus forte présence et <strong>la</strong> plus grande<br />
standardisation <strong>des</strong> pointes de Nemrik à Demirköy, ainsi que <strong>la</strong> moindre fréquence<br />
d’obsidienne et de triangles scalènes, semblent indiquer une date postérieure (Rosenberg<br />
et Peasnall 1998 : 195-6). <strong>Le</strong> fouilleur propose qu’il s’agit de <strong>la</strong> même popu<strong>la</strong>tion,<br />
émigrée à 40 km en aval de <strong>la</strong> rivière Batman (Rosenberg et alii 1998: 35). Par exemple,<br />
les fragments de bol en pierre chlorite, décorés de motifs identiques et réutilisés de <strong>la</strong><br />
même façon en tant que pendentifs retrouvés sur les deux sites témoignent d’une<br />
appartenance culturelle commune. La chute de <strong>la</strong> présence d’obsidienne <strong>dans</strong> les<br />
assemb<strong>la</strong>ges lithiques (de 58% à Hal<strong>la</strong>n Cemi à 8% à Demirköy) étant conséquente, et les<br />
<strong>la</strong>mes de faucilles étant inversement plus nombreuses à Demirköy (avec notamment un<br />
manche de faucille en corne) il propose un changement de type socio-économique pour<br />
expliquer ce dép<strong>la</strong>cement. L’obsidienne étant momentanément absente à <strong>la</strong> même époque<br />
<strong>dans</strong> les sites <strong>du</strong> Zagros, on peut supposer une coupure <strong>dans</strong> le réseau d’échange entre ces<br />
régions. Aussi, les fouilleurs (Rosenberg-Peasnall 1998 : 195-8) supposent que<br />
Demirköy fait le lien chronologique entre <strong>la</strong> fin d’Hal<strong>la</strong>n Cemi et le début de Cayönü. On<br />
peut donc supposer, étant donné les dates que nous possédons pour Hal<strong>la</strong>n Cemi<br />
(ca.10600-9000 BC), que Demirköy s’étende sur le milieu et peut-être <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> PPNA,<br />
étendant <strong>la</strong> présence de <strong>la</strong> tradition trialétienne locale mésolithique à <strong>la</strong> Période 2.<br />
Nous verrons plus loin qu’il se peut que Cayönü commence bien plus tôt et qu’il<br />
soit contemporain, au moins en partie, à Hal<strong>la</strong>n Cemi et Demirköy. Son in<strong>du</strong>strie lithique,<br />
qui date probablement de <strong>la</strong> 2 ème moitié <strong>du</strong> PPNA, <strong>est</strong> assez proche également <strong>du</strong><br />
26
Trialétien, sans oublier de noter <strong>la</strong> présence de pointes d’el-Khiam (A. Ozdogan 1999 :<br />
44). En tous cas, les liens culturels entre Cayönü et Demirköy sont démontrés par <strong>la</strong><br />
présence <strong>dans</strong> les deux sites de meules et de pierres à rainures simi<strong>la</strong>ires. Seule <strong>la</strong> pointe<br />
de Güzir Tepe semble différencier Demirköy <strong>des</strong> sites contemporains. La pointe de Güzir<br />
Tepe <strong>est</strong> une variante de <strong>la</strong> pointe d’el-Khiam, pro<strong>du</strong>ite sur <strong>la</strong>me unipo<strong>la</strong>ire, mais avec<br />
<strong>des</strong> encoches plus basses pour former une base en queue de poisson. En fait, elle se<br />
rapproche plus de <strong>la</strong> pointe à base concave caractéristique de Cayönü ou de Nevali Cori.<br />
L’influence avec le <strong>Le</strong>vant <strong>est</strong> sans doute, encore une fois, à écarter (Rosenberg-Peasnall<br />
1998 : 198).<br />
De même, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d'Urfa, Nevali Cori et Göbekli peuvent peut-être<br />
remonter, mais <strong>dans</strong> <strong>des</strong> niveaux sans architecture, à <strong>la</strong> Période 1, comme l’indiquerait <strong>la</strong><br />
présence de microlithes sur le sol vierge. Il <strong>est</strong> donc possible que ces sites et ceux de <strong>la</strong><br />
Bozova décrits supra, proches <strong>dans</strong> l’espace, soient en partie contemporains <strong>du</strong>rant cette<br />
période. Aussi, Nevali Cori et Göbekli Tepe présentent <strong>des</strong> signes très c<strong>la</strong>irs de leur<br />
appartenance au PPNA: les assemb<strong>la</strong>ges trouvés <strong>dans</strong> les niveaux les plus anciens de ces<br />
sites présentent <strong>des</strong> pointes d'Hélouan, de Nevali Cori et d'Aswad. Ce<strong>la</strong> montre, dès cette<br />
époque, une interaction commerciale d’abord (obsidienne), puis culturelle (éléments<br />
lithiques kébariens) avec le <strong>Le</strong>vant (Hauptmann 1999: 76, 78, 80). Nous tenons sans<br />
doute là les racines d’un phénomène, qui, nous le verrons, s’accentuera de façon<br />
uniforme par <strong>la</strong> suite. La popu<strong>la</strong>tion de ces sites <strong>est</strong> cependant locale ou trialétienne,<br />
contenant également les indices d’une interaction avec le Zagros (comme le montre <strong>la</strong><br />
présence de pointes de Nemrik).<br />
D- <strong>Le</strong> commerce de l’obsidienne et autres matériaux<br />
<strong>Le</strong>s sites anatoliens de cette époque, et en particulier Hal<strong>la</strong>n Cemi, nous montrent<br />
l’éten<strong>du</strong>e <strong>des</strong> contacts entre les communautés sédentaires <strong>des</strong> différentes régions <strong>du</strong><br />
Proche-Orient tout entier. La circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne de Van et de Bingöl vers l’<strong>est</strong> <strong>du</strong><br />
Croissant Fertile et de <strong>la</strong> Cappadoce vers le <strong>Le</strong>vant (paysage qui se modifie<br />
progressivement avec l’obsidienne de Van qui va se retrouver de plus en plus au <strong>Le</strong>vant<br />
également) en <strong>est</strong> bien sûr l’exemple le plus f<strong>la</strong>grant. Aussi, <strong>la</strong> vaisselle en pierre<br />
d’Hal<strong>la</strong>n Cemi, caractérisée par <strong>des</strong> motifs en chevron et <strong>des</strong> doubles perforations sur ses<br />
parois (pour suspendre le bol), possède <strong>des</strong> exemples très simi<strong>la</strong>ires à Nevali Cori<br />
(Schmidt 1995 :9) et jusqu’en Syrie, notamment à Jerf el-Ahmar (M. <strong>Le</strong>breton,<br />
27
communication personnelle). On peut noter également l’importation de cuivre, de<br />
quelques (5) coquil<strong>la</strong>ges méditerranéens et de pilons nemrikiens retrouvés à Hal<strong>la</strong>n Cemi<br />
(Rosenberg et Inal 1993 : 125). Allié à <strong>la</strong> présence de pointes d’el-Khiam à Nemrik et à<br />
Cayönü, aux éléments levantins et zarziens présents <strong>dans</strong> les assemb<strong>la</strong>ges de <strong>la</strong> région<br />
d’Urfa, aux vases en chlorite anatolienne tant à Hal<strong>la</strong>n Cemi qu’à Jerf el-Ahmar, tout ce<strong>la</strong><br />
présente <strong>des</strong> signes f<strong>la</strong>grants de <strong>la</strong> grande mobilité existante et un grand degré<br />
d’interaction <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions <strong>du</strong> Proche-Orient à cette époque.<br />
L’autre fait remarquable <strong>est</strong> qu’il ne s’agit jamais, aux Pério<strong>des</strong> 1 et 2, même<br />
pour l’obsidienne, de gran<strong>des</strong> quantités de matériaux échangées mais plutôt de quantités<br />
assez infimes. De plus ces matériaux et ces objets ont tous un point commun ; leur aspect<br />
ou leur décoration les dote d’une certaine valeur. On peut donc conclure à <strong>la</strong> fonction non<br />
utilitaire et pr<strong>est</strong>igieuse de <strong>la</strong> plupart de ces objets que les simples vil<strong>la</strong>geois ne peuvent<br />
obtenir et qui doivent donc appartenir à <strong>des</strong> privilégiés. S’agit-il <strong>des</strong> débuts de <strong>la</strong><br />
stratification sociale (Rosenberg 1995 : 13) Il <strong>est</strong> étonnant de s’apercevoir, à ce propos,<br />
que ce sont exactement ces mêmes matériaux (cuivre, coquil<strong>la</strong>ge, obsidienne) sous forme<br />
d’objets à petit mo<strong>du</strong>le contenant une grande valeur, qui se retrouvent <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature<br />
ethnologique, sur <strong>la</strong> côte pacifique américaine par exemple, pour expliquer l’émergence<br />
de <strong>la</strong> notion de pr<strong>est</strong>ige et donc de stratification sociale chez certaines sociétés de<br />
chasseurs-cueilleurs sédentaires pratiquant le stockage (T<strong>est</strong>art 1982 : 42-3).<br />
E- Synthèse<br />
Pour résumer, au Mésolithique, l’Anatolie <strong>est</strong> peuplée de chasseurs-cueilleurs<br />
noma<strong>des</strong>, dont les traces de pro<strong>du</strong>ction lithique suggèrent une appartenance locale<br />
appelée trialétienne (faisant partie d’un plus grand groupe comprenant le Caucase). Ces<br />
sites de campement sont notamment Biris Mezarligi et Sögüt Tar<strong>la</strong>si. A <strong>la</strong> fin <strong>du</strong><br />
Mésolithique, le premier site sédentaire d’Hal<strong>la</strong>n Cemi puis, à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> PPNA, Demirköy<br />
et Cayönü à l’<strong>est</strong> font leur apparition, conservant les mêmes caractéristiques locales.<br />
Cependant, notamment grâce à <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne, les interactions et échanges<br />
d’objets pr<strong>est</strong>igieux à l’intention d’une c<strong>la</strong>sse avantagée se font jour. Enfin, à <strong>la</strong> toute fin<br />
de cette période, l’intrusion de signes levantins distinctifs (pointes d’Helouân etc.)<br />
montrent que déjà les sites de <strong>la</strong> région d’Urfa subissent une influence et même une<br />
diffusion culturelle en provenance <strong>du</strong> nord <strong>Le</strong>vant, qui <strong>est</strong> en avance technologiquement<br />
28
avec l’adoption d’une in<strong>du</strong>strie lithique purement néolithique, fondée sur une pro<strong>du</strong>ction<br />
<strong>la</strong>minaire.<br />
III- La période 3 (PPNB)<br />
A- La pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>est</strong> caractérisée d’abord par <strong>la</strong> disparition <strong>des</strong><br />
<strong>la</strong>melles et par l'adoption de <strong>la</strong> technique de débitage bipo<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> nucleus (fig),<br />
commencée dès <strong>la</strong> phase III de Mureybet à <strong>la</strong> Période 2 (M.C. Cauvin 1988 : 28). Ainsi,<br />
le nucleus <strong>est</strong> frappé bi<strong>la</strong>téralement et par côtés opposés pour obtenir <strong>des</strong> <strong>la</strong>mes plus<br />
gran<strong>des</strong> et plus résistantes, ce qui confère un aspect naviforme au nucleus (fig). <strong>Le</strong>s silex<br />
commencent à être chauffés pour permettre une plus grande maîtrise de <strong>la</strong> retouche. Ici,<br />
les haches sont pro<strong>du</strong>ites sur <strong>des</strong> éc<strong>la</strong>ts bifaciaux et les <strong>la</strong>mes de faucilles sont de forme<br />
plus allongée. <strong>Le</strong>s <strong>la</strong>mes sont, plus qu'avant, réutilisées et retouchées pour donner un taux<br />
élevé d' "outils a posteriori" (Bar-Yosef 1981: 562).<br />
A partir <strong>du</strong> PPNB moyen, c’<strong>est</strong> l’épanouissement de <strong>la</strong> BAI, fondée sur <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction de gran<strong>des</strong> <strong>la</strong>mes régulières, avec l’apparition <strong>des</strong> pointes de Byblos et<br />
d'Amuq.<br />
3a (PPNB ancien): les pointes d'Hélouân continuent d'exister et celles de<br />
Nevali Cori apparaissent sous <strong>des</strong> mo<strong>du</strong>les plus grands (Aurenche-Kozlowski 1999:<br />
139) : Dja'de <strong>est</strong> le seul site connu de cette époque sur l’Euphrate syrien.<br />
3b (PPNB moyen): <strong>la</strong> pointe de Byblos possède un pédoncule beaucoup moins<br />
marqué, sans ailerons, formant presque un losange avec le r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> pièce. <strong>Le</strong> corps de<br />
<strong>la</strong> pointe <strong>est</strong> souvent en grande partie retouché ainsi que le pédoncule. Elle <strong>est</strong> présente<br />
principalement à Halu<strong>la</strong> et à Abu Hureyra.<br />
3c (PPNB récent): <strong>la</strong> pointe d'Amuq ne possède plus de pédoncule, lequel <strong>est</strong><br />
venu se confondre <strong>dans</strong> <strong>la</strong> forme losangique, ellipsoïdale ou ovale ( en feuille) de <strong>la</strong><br />
pointe. Il arrive souvent que <strong>la</strong> pointe soit entièrement retouchée. Elle <strong>est</strong> présente à<br />
Halu<strong>la</strong>, Abu Hureyra, sur les sites <strong>du</strong> Balikh, à Bouqras, Qdeir etc.<br />
Après l'apparition de <strong>la</strong> BAI et de <strong>la</strong> pointe d'Hélouân, pro<strong>du</strong>ite à partir d'une<br />
ré<strong>du</strong>ction prismatique ou bipo<strong>la</strong>ire pour <strong>la</strong> première fois au début de <strong>la</strong> Période 3,<br />
29
l’in<strong>du</strong>strie lithique <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> (fig) <strong>est</strong> caractérisée, pour le r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> période, par <strong>la</strong><br />
pointe de Jéricho dotée d'un pédoncule et d'ailerons <strong>la</strong>téraux.<br />
B- La pro<strong>du</strong>ction lithique de <strong>la</strong> Djézireh et <strong>du</strong> Zagros semble continuer celle<br />
de <strong>la</strong> période précédente avec une séparation égale entre Nemrikien et Mléfatien, leurs<br />
caractéristiques per<strong>du</strong>rant avec peu de changements (voir supra) et r<strong>est</strong>ant à peu près<br />
imperméables à l’expansion <strong>du</strong> BAI. Cependant, après un court arrêt lors de <strong>la</strong> fin <strong>du</strong><br />
PPNA (horizon de Demirköy), le commerce de l’obsidienne reprend avec l’Anatolie. Il<br />
semble bien que si <strong>la</strong> présence de <strong>la</strong> culture zarzienne a joué un rôle important <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
formation d’une tradition locale en Anatolie au Mésolithique et au PPNA comme en<br />
témoignent le matériel de Hal<strong>la</strong>n Cemi et de Demirköy, le Nemrikien n’opère plus<br />
vraiment d’influence au PPNB en dehors de sa propre zone originaire qu’<strong>est</strong> <strong>la</strong> Djézireh.<br />
A ceci, il semble bon d’ajouter une précaution quant aux conclusions trop hâtives ; en<br />
effet, une technique aussi spécifique que celle <strong>du</strong> débitage par pression, déjà présente<br />
<strong>dans</strong> le contexte mléfatien et qui apparaît soudainement en Anatolie à <strong>la</strong> Période 3 peut<br />
être interprétée comme le signe d’une diffusion interrégionale <strong>du</strong> Zagros vers les Hautes<br />
Vallées encore à cette époque. De plus, aucun site PPNB, malgré les nombreuses<br />
prospections <strong>dans</strong> cette région, n’<strong>est</strong> connu <strong>dans</strong> l’extrême orient anatolien, le site le plus<br />
oriental étant Cayönü, ce qui <strong>la</strong>isse un étrange vide d’environ 300 km entre celui-ci et les<br />
sites de Nemrik ou Magzalia en Djézireh. <strong>Le</strong>s recherches à venir le combleront peut-être<br />
partiellement mais toujours <strong>est</strong>-il que les sites anatoliens semblent arrachés<br />
géographiquement et culturellement à <strong>la</strong> partie <strong>est</strong> de leur zone formative (le Zagros et le<br />
Caucase), pour aller se rattacher au <strong>Le</strong>vant, iso<strong>la</strong>nt ces derniers.<br />
C- La pro<strong>du</strong>ction lithique <strong>des</strong> Hautes Vallées Anatoliennes <strong>est</strong> touchée à peu<br />
près au même moment qu'au <strong>Le</strong>vant par le phénomène BAI et suit un développement<br />
parallèle avec les mêmes types de pointes de flèches. Il semble bien que ce phénomène<br />
soit d'abord apparu au <strong>Le</strong>vant, car ses origines peuvent être tracées jusque <strong>dans</strong> le<br />
Mureybétien, avec, notamment, le nucleus naviforme et <strong>la</strong> pointe d'Hélouân qui<br />
l'amorcent, alors qu'en Anatolie, rien de comparable n'a été identifié aussi tôt, à part peutêtre<br />
quelques pointes de flèche <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d'Urfa, dont le fouilleur n’exclut pas une<br />
date remontant au PPNA (Haupmann 1999: 69, 76, 78). C’<strong>est</strong> d’ailleurs les sites de <strong>la</strong><br />
région d’Urfa (Nevali Cori, Gobekli Tepe, Gürcü Tepe, Hayaz Höyük et Gritille) qui<br />
subiront, <strong>du</strong> fait de leur position géographique en amont de l’Euphrate et au piedmont <strong>du</strong><br />
30
Taurus, l’influence <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant nord en premier, comme le montrent, outre l’importation<br />
de cette technologie lithique, celle d’aiguilles à chas incisés, de meules ouvertes, de<br />
récipients en pierre et de pierres à rainures propres à <strong>la</strong> culture <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant.<br />
Cependant, plus au nord, <strong>dans</strong> les Hautes Vallées, subsiste, en certains endroits,<br />
et jusqu'à une époque re<strong>la</strong>tivement récente, <strong>la</strong> tradition lithique locale trialétienne déjà<br />
évoquée (Aurenche-Kozlowski 1999: 60). <strong>Le</strong>s éléments de <strong>la</strong> persistance de cette culture<br />
commune se retrouvent particulièrement <strong>dans</strong> les sites de Boytepe, de Cayönü et de<br />
Cafer Höyük (Balkan-Atli 1994: 111). A Boytepe, site <strong>du</strong> PPNB moyen-final, 38 % <strong>des</strong><br />
277 outils lithiques ramassés sont <strong>des</strong> microlithes et le débitage <strong>est</strong> surtout <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>ire ou<br />
sur éc<strong>la</strong>ts (305 pièces contre 152 <strong>la</strong>mes) comme le montre <strong>la</strong> figure (Balkan-Atli 1989 :<br />
87-90). On <strong>est</strong> tenté d’y voir là l’influence de <strong>la</strong> tradition trialétienne de type<br />
mésolithique qui y per<strong>du</strong>re, aux côtés d’une tradition nouvelle qui s’uniformise. Cafer<br />
Höyük montre également, tout au long <strong>du</strong> PPNB, que <strong>la</strong> tradition locale n’<strong>est</strong> que<br />
gra<strong>du</strong>ellement remp<strong>la</strong>cée par <strong>des</strong> caractéristiques nouvelles, plus uniformes. Celles-ci<br />
sont communes au r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> région et propres au BAI, incluant par exemple <strong>des</strong> outils<br />
de Cayönü, <strong>la</strong>mes à retouches abruptes probablement multi-fonctionnelles (fig), de<br />
prédilection à l’époque, puisque sur ce même site, ils sont également fortement<br />
représentés, avec 35% de <strong>la</strong> totalité <strong>des</strong> outils.<br />
La tradition locale y <strong>est</strong> notamment reconnaissable par <strong>la</strong> persistance de <strong>la</strong><br />
technique <strong>du</strong> polissage, de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de microlithes et de <strong>la</strong>melles, de "pointes à dos<br />
et crans", à quoi on peut ajouter une tradition ancienne <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> marbre, ainsi que <strong>la</strong><br />
perte de <strong>la</strong> prééminence de l'utilisation <strong>du</strong> silex au profit de l'obsidienne, autre signe<br />
d’uniformisation nouvelle (Cauvin et alii 1991: 6-7; Cauvin et alii 1999: 90-100). Aussi,<br />
<strong>la</strong> technique <strong>du</strong> débitage par pression (fig), qui forme une grande nouveauté <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
technologie lithique, et qui caractérise aussi le BAI, semble trouver son origine ici, à cette<br />
période, en Anatolie selon Cauvin M.C. (1988 : 29), ou peut-être a-t-elle été importée <strong>du</strong><br />
Zagros où elle <strong>est</strong> déjà connue à <strong>la</strong> période antérieure, mais il s’agit, nous l’avons vu<br />
entre le Zagros et l’Anatolie, d’un même dénominateur culturel commun. D’autre part, si<br />
<strong>la</strong> tradition trialétienne <strong>est</strong> une tradition de type mésolithique, sa pro<strong>du</strong>ction <strong>est</strong> reconnue<br />
pour <strong>la</strong> grande taille de ses pro<strong>du</strong>its, ce qui a sans doute grandement aidé le<br />
développement technique et l’instal<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> BAI (qui pro<strong>du</strong>it <strong>des</strong> <strong>la</strong>mes) en Anatolie.<br />
Il existe donc sûrement une interaction entre les sociétés locales qui non<br />
seulement ne disparaissent pas, mais ne sont pas non plus, au moins jusqu'au PPNB<br />
moyen et peut-être après, complètement englobées <strong>dans</strong> un "nouvel ordre" (Cauvin J. et<br />
31
alii 1999: 100), lequel n’<strong>est</strong> d’ailleurs pas, comme Cauvin le décrit, un ordre entièrement<br />
levantin. C’<strong>est</strong> cette confrontation <strong>des</strong> cultures en Anatolie qui a contribué à<br />
l’é<strong>la</strong>boration, en tant que centre formateur, et à l’expansion de cet ordre, comme nous<br />
venons de le soupçonner avec l’exemple de <strong>la</strong> tradition lithique trialétienne. Il r<strong>est</strong>e<br />
cependant tentant de penser que ce nouvel ordre, caractérisé par le BAI <strong>dans</strong> le domaine<br />
lithique, <strong>est</strong> venu, <strong>du</strong> moins <strong>dans</strong> son concept original de pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>minaire, d'un peu<br />
plus au <strong>sud</strong> où il existait déjà à <strong>la</strong> période précédente.<br />
D- La circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne<br />
Il peut paraître difficile d'attribuer un centre d'invention à partir <strong>du</strong>quel les<br />
différents types de pointes se seraient diffusés <strong>dans</strong> toute <strong>la</strong> région. Mais à partir <strong>du</strong><br />
moment où ces nouvelles techniques, surtout celle <strong>du</strong> débitage bipo<strong>la</strong>ire, sont bien<br />
installées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région <strong>des</strong> Hautes Vallées, il apparaît que <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion de l'obsidienne<br />
<strong>des</strong> sources cappadociennes et de Van prend désormais, vers 8200 av J-C (PPNB moyen),<br />
une ampleur très importante et fait sans doute l'objet d'une spécialisation artisanale. On<br />
sait que l'obsidienne arrivait au <strong>Le</strong>vant sous forme de pro<strong>du</strong>its finis ou semi-finis<br />
(Aurenche-Kozlowski 1999: 60), et que ceux-ci étaient par conséquent directement<br />
travaillés sur leur lieu d'extraction; le site de Kaletepe a mis en évidence non seulement le<br />
travail spécialisé mais aussi l'exportation de ces pro<strong>du</strong>its vers l'Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> et le<br />
<strong>Le</strong>vant (Balkan-Atli et alii 1999: 142-3, Aurenche-Kozlowski 1999: 104). Il <strong>est</strong> donc<br />
parfaitement envisageable que les nouvelles formes de pointes <strong>du</strong> PPNB moyen et récent<br />
(Byblos et Amuq) aient été é<strong>la</strong>borées là où les matières premières étaient extraites et<br />
directement travaillées ; il serait maintenant intéressant de déterminer l'origine de ces<br />
artisans.<br />
A ce sujet, aucun <strong>des</strong> types de pro<strong>du</strong>its fabriqués à Kaletepe, atelier lithique de<br />
Cappadoce, n' a été retrouvé en Anatolie centrale, à Asikli Höyük par exemple, qui <strong>est</strong><br />
cependant beaucoup plus proche que les sites <strong>des</strong> Hautes Vallées (Balkan-Atli et alii<br />
1999: 142-3). En outre, il s'agit sans doute plus d'artisans anatoliens que levantins, <strong>du</strong> fait<br />
de <strong>la</strong> plus grande proximité et de <strong>la</strong> plus grande proportion d'obsidienne <strong>dans</strong> les sites<br />
anatoliens, jusqu’à 94% <strong>du</strong> matériel de surface à Boytepe (Balkan-Atli 1989 : 87) et 95%<br />
<strong>du</strong> matériel <strong>des</strong> niveaux supérieurs de Cafer Höyük (PPNB final), alors que les<br />
pourcentages <strong>des</strong> sites levantins, nous le verrons plus loin, sont bien inférieurs. Cette<br />
disparité s'explique donc par un dép<strong>la</strong>cement <strong>des</strong> groupes d'artisans <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien<br />
vers <strong>la</strong> région d'extraction. On peut même préciser encore <strong>la</strong> provenance de ces artisans<br />
32
puisque les proportions importantes, voire le monopole, de l’obsidienne, <strong>dans</strong> les<br />
mobiliers lithiques, ne se trouvent que <strong>dans</strong> les sites d’altitude <strong>du</strong> Taurus oriental qui sont<br />
principalement Boytepe et Cafer. En comparaison, elle compte pour <strong>la</strong> moitié (45%) de<br />
l’assemb<strong>la</strong>ge un peu plus au <strong>sud</strong> à Cayönü et elle <strong>est</strong> quasiment absente plus en aval de<br />
l’Euphrate, au piedmont <strong>du</strong> Taurus, à Hayaz (4.5 %), Gritille et Nevali Cori (Cauvin<br />
M.C. 1988 : 26-27). Voir fig/carte.<br />
Ce<strong>la</strong> tend à montrer qu'au cours de cette période, le centre de pro<strong>du</strong>ction et peutêtre<br />
d'innovation majeur (peut-être même inventeur <strong>des</strong> pointes de Byblos et d’Amuq)<br />
s'installe progressivement en Anatolie <strong>du</strong> centre <strong>est</strong> ou <strong>du</strong> Taurus, et profite d'abord aux<br />
sites de Cafer, de Boytepe, et de Cayönü avant ceux de <strong>la</strong> région d’Urfa ou <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant.<br />
Il <strong>est</strong> intéressant de noter que, même si les sites anatoliens étaient plus proches <strong>des</strong><br />
mines d’obsidienne, les anatoliens n’ont utilisé cette matière que re<strong>la</strong>tivement tard,<br />
comme le prouve ce diagramme (fig) de <strong>la</strong> proportion d’utilisation d’obsidienne <strong>dans</strong><br />
l’in<strong>du</strong>strie lithique de Cayönü (Balkan-Atli 1994 : 69-70). En effet <strong>la</strong> disparité<br />
géographique de l’utilisation d’obsidienne <strong>est</strong> aussi une disparité chronologique. Après<br />
une forte consommation de cette matière première à Hal<strong>la</strong>n Cemi au Mésolithique - début<br />
PPNA (60%), on constate qu’elle <strong>est</strong> att<strong>est</strong>ée de façon très parcimonieuse (8%) à<br />
Demirköy au PPNA, et qu’au long <strong>du</strong> PPNB sa proportion varie grandement au sein <strong>des</strong><br />
mêmes sites. Ainsi, alors que le silex <strong>est</strong> <strong>la</strong>rgement majoritaire <strong>dans</strong> les niveaux inférieurs<br />
de Cayönü (round et grill phases) et à Cafer, l’obsidienne l’égale à Cayönü, avec 45% <strong>du</strong><br />
mobilier lithique vers <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> séquence (PPNB Final), et elle compte pour <strong>la</strong> quasi<br />
totalité <strong>des</strong> matières premières à Cafer à <strong>la</strong> même période (Cauvin M.C. 1988 : 26-27).<br />
Tout ceci <strong>est</strong> peut-être à mettre en parallèle avec un changement de zone d’extraction;<br />
alors que le <strong>Le</strong>vant aux Pério<strong>des</strong> 1 et 2 s’approvisionne surtout en Cappadoce, les<br />
analyses par actions neutroniques de l’obsidienne montrent que celle-ci provient, au<br />
PPNB, de Bingöl, de Nemrut Dag et Süphan Dag (<strong>la</strong>c Van), beaucoup plus à l’<strong>est</strong> et plus<br />
proches <strong>des</strong> sites de cette époque.<br />
Tout ce<strong>la</strong> montre une uniformisation <strong>dans</strong> les pratiques lithiques dont <strong>la</strong> plus<br />
grande ampleur <strong>est</strong> att<strong>est</strong>ée plus au nord qu’au <strong>sud</strong>, en amont de l’Euphrate où ce ne sont<br />
pas seulement quelques <strong>la</strong>mes, mais les principales catégories <strong>des</strong> pièces (en particulier<br />
les pointes de flèches) qui sont réalisées <strong>dans</strong> ce matériau. C’<strong>est</strong> d’ailleurs à l’apogée de<br />
<strong>la</strong> civilisation néolithique précéramique <strong>du</strong> Taurus que le commerce de l’obsidienne<br />
33
ayonne, non seulement au <strong>Le</strong>vant, avec, par exemple, 32% à Halu<strong>la</strong> au PPNB récent<br />
(Molist et alii 1996 : 5), mais aussi <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Djézireh et au Zagros où les outils de Cayönü<br />
taillés <strong>dans</strong> cette matière vont longtemps per<strong>du</strong>rer (Cauvin M.-C. 1988 : 31). Alors que<br />
l’Anatolie semble avoir beaucoup emprunté à ses voisins <strong>du</strong>rant <strong>des</strong> millénaires, elle leur<br />
rend, à son apogée, les éléments de son propre développement culturel.<br />
Si <strong>la</strong> diffusion <strong>du</strong> nord vers le <strong>sud</strong> s’opère jusqu’au début de <strong>la</strong> Période 3, c’<strong>est</strong><br />
donc, à <strong>la</strong> fin de cette période, l’inverse qui se pro<strong>du</strong>it. Pour montrer ce<strong>la</strong>, il faut<br />
comparer les données. La présence d’obsidienne au <strong>Le</strong>vant <strong>est</strong>, jusqu’au PPNB récent,<br />
infime. C’<strong>est</strong> également le cas pour les sites de <strong>la</strong> région d’Urfa, qui, bien que situés en<br />
Turquie actuelle, sont plus proches géographiquement et culturellement <strong>du</strong> Moyen-<br />
Euphrate syrien, comme le montrent les pointes de Byblos à retouches p<strong>la</strong>tes et les burins<br />
quadruples (Schmidt 1988 : 161). C’<strong>est</strong> seulement à partir de <strong>la</strong> fin de cette période<br />
(PPNB Final) que l’obsidienne représente une part bien plus conséquente <strong>des</strong> mobiliers<br />
lithiques de ces régions. A Halu<strong>la</strong> en Syrie, le pourcentage d’obsidienne <strong>dans</strong><br />
l’assemb<strong>la</strong>ge lithique passe de 6% au PPNB Moyen à 32 % au PPNB récent, avant de<br />
retomber à <strong>des</strong> quantités négligeables à <strong>la</strong> période suivante (2% <strong>dans</strong> les niveaux préha<strong>la</strong>fiens)<br />
(Molist et alii 1996 : 5). Aussi, alors que Göbekli Tepe et Nevali Cori, qui sont<br />
assignés au PPNB ancien et moyen, comptent <strong>des</strong> taux aussi bas que 0.01 %<br />
d’obsidienne, le site de Gürcü Tepe qui <strong>est</strong> <strong>la</strong> continuité et peut-être même <strong>la</strong><br />
délocalisation, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> même région, <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions <strong>des</strong> premiers sites au PPNB final 1 ,<br />
semble comporter beaucoup plus d’obsidienne, notamment pour <strong>la</strong> fabrication d’outils de<br />
Cayönü (Schmidt 95 : 9 ; Hauptmann 1999 : 77). Cette hausse remarquable de<br />
l’utilisation de l’obsidienne sur les sites de l’Euphrate moyen n’intervient donc pas avant<br />
<strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> période, alors qu’elle <strong>est</strong> déjà massivement att<strong>est</strong>ée <strong>dans</strong> les sites <strong>des</strong> Hautes<br />
Vallées dès le PPNB ancien (33%) à Cafer Höyük, et s’accentuant gra<strong>du</strong>ellement jusqu’à<br />
l’hégémonie totale de l’obsidienne visible au PPNB récent <strong>dans</strong> cette région. Comment<br />
donc s’expliquer ces chiffres autrement que par une diffusion <strong>des</strong> traditions <strong>des</strong> Hautes<br />
1 A Nevali Cori, les pointes de flèches sont le groupe le plus important de l’in<strong>du</strong>strie lithique, avec<br />
2240 pièces, les pointes de Byblos en étant les plus représentatives (Haupmann 1999: 76).<br />
L’absence de pointes d’Amuq indique que <strong>la</strong> séquence de Nevali Cori s’arrête avant le PPNB<br />
récent, ce qui <strong>est</strong> en parallèle avec les résultats de Göbekli Tepe, alors que l’in<strong>du</strong>strie de Gürcü<br />
Tepe, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> même région proche, montre une in<strong>du</strong>strie plus tardive (PPNB récent avec pointes<br />
d’Amuq et d’Ugarit) (Schmidt 1995 : 9). On peut donc conclure que les habitants <strong>des</strong> deux<br />
premiers sites se sont ensuite dép<strong>la</strong>cés vers ce dernier (entre autres), ce qui peut être analysé<br />
comme une forme de prélude au déclin de <strong>la</strong> civilisation, au PPNB final, puisque les structures<br />
architecturales montrent elles aussi <strong>des</strong> changements de type social (voir les chapitres<br />
concernés).<br />
34
Vallées vers le <strong>sud</strong> Il y a bien, à vrai dire, un autre aspect, de type social, qui peut<br />
intervenir <strong>dans</strong> ce procédé (voir infra), mais qui n’enlève rien à l’évidence de <strong>la</strong><br />
diffusion.<br />
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de tous ces chiffres et éléments. La<br />
diffusion qui se dirigeait jusque là <strong>du</strong> <strong>sud</strong> vers le nord, <strong>est</strong>, à partir <strong>du</strong> PPNB final,<br />
inversée. Aussi, l’accroissement brutal de <strong>la</strong> proportion d’obsidienne au PPNB final<br />
montre un changement de type socio-économique ; il ne s’agit plus de petite quantité non<br />
utilitaire à <strong>la</strong> disposition d’une minorité mais d’une grande démocratisation <strong>du</strong> commerce<br />
de l’obsidienne. Sachant que <strong>la</strong> disparition <strong>des</strong> bâtiments somptuaires (voir architecture)<br />
correspond précisément à cette époque, on <strong>est</strong> en droit de penser à un bouleversement<br />
social pour revenir à <strong>des</strong> sociétés plus égalitaires. Enfin, par <strong>la</strong> voie d’échange <strong>des</strong><br />
matières premières, les traces d’une diffusion culturelle sur l’ensemble <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant sont<br />
constituées par <strong>la</strong> présence massive <strong>dans</strong> cette région à cette époque, <strong>des</strong> pointes de<br />
Byblos, <strong>du</strong> débitage par pression et <strong>des</strong> outils de Cayönü.<br />
E-Synthèse<br />
L’abondance <strong>des</strong> outils de Cayönü, celle de <strong>la</strong> proportion d’obsidienne, l’adoption<br />
partout de <strong>la</strong> technique <strong>des</strong> nucleus bipo<strong>la</strong>ires naviformes et de seulement deux types de<br />
pointes de flèches différents (Byblos et Amuq) fabriqués de manière très standardisée<br />
(forme, grandeur, retouches), ainsi que l’adoption <strong>du</strong> débitage par pression développé<br />
localement (ou peut-être emprunté de ses voisins de <strong>la</strong> Djézireh) sont les éléments<br />
marquants de l’in<strong>du</strong>strie lithique anatolienne à <strong>la</strong> Période 3. Ils montrent, à notre avis,<br />
l’uniformité et <strong>la</strong> complexité croissante de <strong>la</strong> culture <strong>du</strong> Taurus oriental, née de <strong>la</strong> fusion<br />
de plusieurs traditions et qui, s’étendant au moins de Cayönü à Urfa, s’<strong>est</strong> finalement<br />
forgée une identité. Ensuite, ce phénomène culturel, comprenant le BAI, mieux att<strong>est</strong>é et<br />
plus tôt qu’ailleurs, <strong>dans</strong> le Taurus, s’étend plus au <strong>sud</strong> encore, <strong>dans</strong> presque tout le<br />
<strong>Le</strong>vant, où les pointes de Byblos connaissent également une popu<strong>la</strong>rité rare à cette<br />
époque (90% <strong>des</strong> pointes de flèches ; Gopher 1986 :46). Cependant, il semble manif<strong>est</strong>e<br />
qu’après s’être imprégnée <strong>des</strong> cultures voisines, l’Anatolie se trouve être un vrai foyer<br />
d’innovation, mais aussi, à son tour, d’expansion de cette nouvelle culture. En d’autres<br />
termes, <strong>la</strong> Culture de Cayönü forme, dès le PPNB moyen, un réseau établi et organisé de<br />
sites qui rayonne par delà l’Anatolie, <strong>dans</strong> tout le Croissant Fertile, et dont celle-ci <strong>est</strong> le<br />
centre novateur.<br />
35
IV- Conclusion<br />
Dès <strong>la</strong> Période 1, on différencie trois traditions lithiques différentes: le Natoufien au<br />
<strong>Le</strong>vant, le Zarzien au Zagros et le Trialétien en Anatolie. Toutes sont cependant de type<br />
épipaléolithique, c'<strong>est</strong>-à-dire avec une pro<strong>du</strong>ction importante de microlithes tels que les<br />
segments. Alors que le <strong>Le</strong>vant amorce avec <strong>la</strong> pointe d'Hélouân, à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> Période 2,<br />
un changement technique important - le débitage <strong>la</strong>minaire bipo<strong>la</strong>ire - le Zagros, et<br />
surtout <strong>la</strong> Djézireh désormais caractérisée par <strong>la</strong> pointe de Nemrik, r<strong>est</strong>ent fermement<br />
ancrés <strong>dans</strong> <strong>la</strong> technique de débitage unipo<strong>la</strong>ire. Cette transition vers le BAI semble assez<br />
précisément avoir été commencée au <strong>Le</strong>vant nord. En effet, <strong>la</strong> BAI ne semble s'imp<strong>la</strong>nter<br />
au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> qu'au courant de <strong>la</strong> Période 3a. Elle caractérisera <strong>la</strong> Période 3, à part <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> partie orientale <strong>du</strong> Croissant Fertile, d’une façon particulièrement uniforme.<br />
<strong>Le</strong>s communautés de <strong>la</strong> région d'Urfa notamment semblent adopter le phénomène<br />
BAI peut-être dès <strong>la</strong> transition entre les Pério<strong>des</strong> 1 et 2, ce qui pourrait montrer qu'une<br />
partie <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions anatoliennes, <strong>la</strong> plus proche <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant au piedmont <strong>du</strong> Taurus, fut<br />
<strong>la</strong> première touchée et, peut-être pendant un temps, fit partie intégrante <strong>du</strong> centre<br />
d'innovation et d'é<strong>la</strong>boration levantin de cette nouvelle technique. C’<strong>est</strong> plus tardivement<br />
que celle-ci se déploiera sur les régions plus au nord, en altitude. Cayönü Base (A.<br />
Ozdogan 1999: 44), Hal<strong>la</strong>n Cemi et Demirköy (Rosenberg 1999: 29-30) sont, en effet, en<br />
cette même Période 2, de facture locale, voire rattachés culturellement au Zagros ou au<br />
Caucase, comme le seront Cayönü, Cafer et Boytepe jusque vers le milieu de <strong>la</strong> Période<br />
3.<br />
<strong>Le</strong>s sites de <strong>la</strong> région d’Urfa ayant servi de ponts <strong>dans</strong> <strong>la</strong> diffusion technologique<br />
de <strong>la</strong> BAI entre le Moyen-Euphrate et les Hautes Vallées, ce n'<strong>est</strong> que progressivement,<br />
en remontant l’Euphrate, au cours de <strong>la</strong> Période 3, que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale d’Anatolie va<br />
se détacher de sa tradition mésolithique trialétienne, montrant qu’elle r<strong>est</strong>e présente tout<br />
le temps et, en quelque sorte, prend en main sa propre néolithisation. C’<strong>est</strong> alors, en<br />
alliant le nouveau concept (BAI) à ses propres innovations (le débitage par pression) et<br />
ses traditions lithiques (pro<strong>du</strong>ction de gran<strong>des</strong> <strong>la</strong>melles au Mésolithique qui facilite <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>minaire), et en se rendant maître <strong>du</strong> commerce de l’obsidienne qu’elles vont<br />
exporter en masse, que les popu<strong>la</strong>tions anatoliennes vont développer une nouvelle<br />
culture. Cette culture, appelée Culture <strong>du</strong> Taurus (orientale) ou de Cayönü, caractérisée<br />
<strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique par les pointes de Byblos et d’Amuq, devient<br />
36
dès lors un foyer novateur qui va s’étendre et se diffuser à son tour, à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> PPNB, sur<br />
l’ensemble <strong>du</strong> Croissant Fertile.<br />
Enfin, le commerce de l'obsidienne, commencé dès <strong>la</strong> Période 1, donne <strong>des</strong><br />
informations intéressantes. L'obsidienne extraite de régions aussi lointaines que <strong>la</strong><br />
Cappadoce, et retrouvée au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> en quantité r<strong>est</strong>reinte, suppose, puisque le silex<br />
localement abondant offre <strong>des</strong> qualités utilitaires comparables, que ces popu<strong>la</strong>tions lui<br />
attribuaient une valeur de pr<strong>est</strong>ige véhiculée par son aspect bril<strong>la</strong>nt, vitreux et noir. C'<strong>est</strong><br />
ensuite au <strong>Le</strong>vant nord qu'on <strong>la</strong> retrouve de façon plus significative à <strong>la</strong> Période 2,<br />
provenant de Bingöl et <strong>du</strong> <strong>la</strong>c Van. A <strong>la</strong> Période 3, considérant les proportions<br />
d'obsidienne <strong>dans</strong> l'in<strong>du</strong>strie <strong>des</strong> sites et <strong>la</strong> moindre distance <strong>des</strong> sites d'extraction, il<br />
semble que ce soient les sites anatoliens <strong>du</strong> Taurus oriental (comme Cafer Höyük), et non<br />
pas ceux <strong>d'Anatolie</strong> centrale, qui dominent et à qui profitent cet échange, au point de<br />
s’étendre, au PPNB final, jusqu’au <strong>Le</strong>vant et au Zagros. La différence entre le commerce<br />
<strong>des</strong> Pério<strong>des</strong> 1 et 3 <strong>est</strong> qu’il s’agit, pour <strong>la</strong> deuxième, d’un échange de masse, donc plus<br />
accessible (et non pas r<strong>est</strong>reint à une certaine catégorie sociale), contrôlé par les<br />
popu<strong>la</strong>tions <strong>des</strong> Hautes Vallées de l’Euphrate et non plus par celles <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant. <strong>Le</strong>s<br />
premiers véhiculent désormais leur culture aux derniers et au-delà, comme le prouvent <strong>la</strong><br />
diffusion remarquable, <strong>du</strong> nord vers le <strong>sud</strong>, non seulement <strong>des</strong> matières premières mais<br />
surtout <strong>des</strong> traits culturels caractéristiques tel que le débitage par pression et les pointes<br />
de Byblos et d’Amuq.<br />
En conclusion, il semblerait que le centre d'innovation de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique se<br />
soit dép<strong>la</strong>cé, suivant à peu près les trois pério<strong>des</strong> considérées, <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> et <strong>du</strong> Zagros<br />
vers le <strong>Le</strong>vant nord pour le premier, et peut-être vers <strong>la</strong> Djézireh pour le second, et qu'il<br />
se soit enfin établi en Anatolie, sous sa forme vraiment néolithique, que l'on désigne par<br />
le terme de BAI. De là, contrairement aux traditions lithiques précédentes, cette<br />
technique s’<strong>est</strong> éten<strong>du</strong>e bien au-delà de sa région d’origine et s’<strong>est</strong> uniformisée,<br />
notamment par le biais <strong>du</strong> contrôle de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion de l'obsidienne.<br />
Culturellement, l’Anatolie présente essentiellement, à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> Période 1, <strong>des</strong><br />
éléments lithiques issus d’une tradition locale (Hal<strong>la</strong>n Cemi) appartenant à <strong>la</strong> tradition<br />
trialétienne <strong>du</strong> Caucase avec une influence nemrikienne <strong>du</strong> Zagros, et nous avons décelé<br />
37
les débuts d’une interaction commerciale et culturelle avec le <strong>Le</strong>vant qui, de son côté, a<br />
déjà bien entamé sa course vers <strong>la</strong> néolithisation. Au cours de <strong>la</strong> Période 2, l’Anatolie<br />
commence à subir de façon plus marquante, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d’Urfa (Nevali Cori, Göbekli<br />
Tepe), les influences <strong>du</strong> Moyen-Euphrate syrien, où furent é<strong>la</strong>borés les premières<br />
expérimentations vers <strong>la</strong> BAI, alors que Cayönü et Demirköy et <strong>la</strong> fin de Hal<strong>la</strong>n Cemi<br />
continuent de montrer leurs appartenance à <strong>des</strong> traditions locales. A <strong>la</strong> Période 3, <strong>la</strong> BAI<br />
semble s’imp<strong>la</strong>nter et s’épanouir sur l’ensemble <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien, même si les sites<br />
plus au nord comme Cafer Höyük, Boytepe et Cayönü présentent les signes d’une<br />
persistance de <strong>la</strong> tradition locale pendant assez longtemps, mais formant paradoxalement,<br />
à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> séquence PPN, le centre novateur et rayonnant de cette nouvelle culture <strong>du</strong><br />
Taurus (ou de Cayönü). Cette lente assimi<strong>la</strong>tion démontre parfaitement qu’il ne s’agit pas<br />
là d’un mouvement de popu<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> <strong>sud</strong> vers le nord, encore moins d’une colonisation,<br />
mais plus d’une diffusion d’idées et de traditions, qui en outre s’explique très bien grâce à<br />
l’intense circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne avec le <strong>Le</strong>vant, qui, nous pensons, <strong>est</strong> passé sous<br />
contrôle anatolien, au cours de <strong>la</strong> période. Cette tendance s’affirmera jusqu’à ce que, juste<br />
avant le déclin <strong>des</strong> cultures néolithiques précéramique <strong>du</strong> Proche-Orient, l’Anatolie<br />
devienne le centre de diffusion de sa propre culture vers le r<strong>est</strong>e <strong>du</strong> Croissant Fertile et<br />
notamment vers le <strong>Le</strong>vant. Enfin, ce commerce et cette uniformisation sont, à notre avis,<br />
les témoins d’un début de spécialisation <strong>du</strong> travail, les prémices de <strong>la</strong> hiérarchisation de<br />
<strong>la</strong> société.<br />
L’examen de l’in<strong>du</strong>strie lithique nous révèle donc, à travers l’existence d’une<br />
popu<strong>la</strong>tion locale qui s’épanouit, certes au contact <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant, mais au point de former un<br />
véritable centre novateur qui va ensuite se diffuser lui-même au <strong>Le</strong>vant, une vision bien<br />
différente de ce que <strong>la</strong> littérature traditionnelle, qui prône une « néolithisation<br />
secondaire » de l’Anatolie, nous offre. Mais ce constat serait loin d’être satisfaisant et<br />
complet si nous en r<strong>est</strong>ions aux seules preuves lithiques, parfois difficiles à interpréter.<br />
L’examen <strong>du</strong> développement de l’architecture doit maintenant venir appuyer ces<br />
observations.<br />
38
V<br />
-<br />
<strong>Le</strong> mode de subsistance<br />
57
Selon <strong>la</strong> définition de Gordon Childe, le Néolithique <strong>est</strong> <strong>la</strong> période de l'histoire<br />
humaine qui se définit par l’adoption d’un mode de subsistance fondé sur <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction,<br />
c'<strong>est</strong>-à-dire <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction agricole (Aurenche-Kozlowski 1999: 37). Ces considérations<br />
matérielles et économiques ont eu un impact décisif <strong>dans</strong> <strong>la</strong> compréhension <strong>du</strong><br />
phénomène néolithique, mais elles ne reflètent plus <strong>la</strong> complexité ni les origines et les<br />
causes <strong>du</strong> processus <strong>dans</strong> son ensemble. Cependant, s'il <strong>est</strong> vrai que le processus de<br />
néolithisation ne peut se résumer au changement de mode de subsistance, il n'y a pas de<br />
néolithisation complète sans recours à l'agriculture. Et si <strong>la</strong> néolithisation <strong>est</strong> un processus<br />
très compliqué, il en <strong>est</strong> de même pour le procédé d’apparition de l'agriculture. Ainsi, il<br />
faut, <strong>dans</strong> un premier temps bien comprendre les différentes étapes et le mécanisme<br />
impliqué <strong>dans</strong> l’avènement de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction agricole pour ensuite pouvoir délimiter son<br />
véritable impact sur le processus néolithique et déterminer le rôle joué, en ce domaine,<br />
par les popu<strong>la</strong>tions anatoliennes.<br />
Il <strong>est</strong> tout d’abord nécessaire de définir le concept d'agriculture. L'agriculture <strong>est</strong> le<br />
procédé qui permet de récolter <strong>des</strong> végétaux dont les graines sont semées par l'homme.<br />
Cette intervention humaine <strong>est</strong> visible <strong>dans</strong> <strong>la</strong> morphologie <strong>des</strong>dites graines (fig). En effet,<br />
lorsque elle <strong>est</strong> dom<strong>est</strong>ique (et donc sujette à l'agriculture) <strong>la</strong> graine subit quelques<br />
modifications. <strong>Le</strong>s plus évidentes sont un grossissement, un accroissement en nombre sur<br />
chaque épis et le <strong>du</strong>rcissement de son rachis, qui devient alors non-déhiscent, de sorte que<br />
<strong>la</strong> graine <strong>est</strong> plus solidement attachée au r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte (Jurmain et alii 1990: 498,<br />
Willcox 2000: 132). Aujourd'hui, c'<strong>est</strong> cette transformation génétique qui r<strong>est</strong>e pour nous<br />
le seul témoin fiable <strong>du</strong> recours à <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction agricole (Aurenche-Kozlowski 1999: 101-<br />
2). <strong>Le</strong> principe <strong>est</strong> le même pour <strong>la</strong> morphologie animale <strong>dans</strong> l'optique de l'élevage.<br />
I- L’agriculture prédom<strong>est</strong>ique<br />
Cependant, dès le début <strong>des</strong> années 90, <strong>des</strong> chercheurs tels que Gordon Hillman<br />
ou Cauvin (1997 : 92) ont indiqué <strong>la</strong> possibilité de ce que le premier a appelé<br />
l’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique, qui tendrait à comprendre le phénomène de transformation<br />
morphologique comme un long procédé qui aurait demandé un temps d'adaptation moins<br />
soudain que le supposait <strong>la</strong> "Révolution Néolithique". Pendant peut-être plusieurs siècles,<br />
voire millénaires, les habitants sédentaires <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges natoufiens et de l'horizon PPNA<br />
auraient, <strong>dans</strong> un premier temps, intensément cueilli, puis semé, les p<strong>la</strong>ntes alimentaires<br />
disponibles à l'état sauvage <strong>dans</strong> leurs régions respectives (fig. ): le blé amidonnier à<br />
58
Cayönü, le blé engrain à Nevali Cori, et l'orge <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d’Aswad (Helmer et alii<br />
1998 : 27-9), sans que ce<strong>la</strong> <strong>est</strong> d’incidence sur leur comportement génétique. <strong>Le</strong>s derniers<br />
travaux confirment l’hypothèse que ce n'<strong>est</strong> qu'à <strong>la</strong> suite de l’intensification de <strong>la</strong> pratique<br />
agricole et de l’abandon de <strong>la</strong> cueillette qui per<strong>du</strong>rait au PPNA aux côtés de l'agriculture,<br />
que <strong>la</strong> transformation morphologique aurait été possible <strong>dans</strong> <strong>des</strong> proportions<br />
conséquentes. L’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique <strong>est</strong> bien sûr beaucoup plus difficile à<br />
démontrer que l’agriculture dom<strong>est</strong>ique, mais de nombreux indices tendent à ça.<br />
L’accroissement <strong>du</strong> nombre de <strong>la</strong>mes de faucilles <strong>dans</strong> ces sites en <strong>est</strong> en soit un<br />
indicateur. Ce phénomène <strong>est</strong> particulièrement visible en Anatolie, où <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
d’Hal<strong>la</strong>n Cemi semble même avoir abandonné ce site pour s’installer un plus loin, sur les<br />
terres plus fertiles et non boisées de Demirköy, où les <strong>la</strong>mes de faucilles sont beaucoup<br />
plus abondantes (Rosenberg et Peasnall 1998 : 200).<br />
Il n’y a très probablement pas de pratique humaine consciente qui ait provoqué <strong>la</strong><br />
dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> céréales; un rachis mutant n'<strong>est</strong> pas visible à l’œil nu et sa récolte<br />
ciblée <strong>est</strong>, à cause de sa disparité, simplement inconcevable. C'<strong>est</strong> donc <strong>la</strong> faucille qui fait<br />
cette sélection, car, sous son coup, les grains mutants r<strong>est</strong>ent plus fermement attachés à<br />
leurs rachis non-déhiscents, et deviennent, au bout d’un certain temps, les plus<br />
représentés parmi les grains cueillis (Anderson 2000: 105-6). Mais au bout de combien de<br />
temps Ce procédé n'ayant pu être accéléré volontairement par l'homme et <strong>la</strong> proportion<br />
de rachis naturellement non-déhiscents <strong>dans</strong> une popu<strong>la</strong>tion de céréales sauvages étant<br />
très faible (un pour 2 à 4 millions), ce<strong>la</strong> engendre donc plus que les quelques générations<br />
supposées originellement pour obtenir une popu<strong>la</strong>tion dom<strong>est</strong>ique. De plus, on imagine<br />
mal qu'une telle invention soit maîtrisée rapidement au point d'abandonner les anciennes<br />
pratiques de suite, surtout si l'on considère que <strong>la</strong> chasse et <strong>la</strong> cueillette requièrent<br />
beaucoup moins de travail que l’agriculture (Aurenche-Kozlowski 1999: 7). Ainsi,<br />
puisque <strong>la</strong> cueillette était également pratiquée en parallèle de l'agriculture et que le<br />
pro<strong>du</strong>it de celle-ci (constituée très majoritairement de grains sauvages) fut probablement<br />
employé pour semer les champs, le procédé de dom<strong>est</strong>ication s'en <strong>est</strong> trouvé<br />
considérablement ralenti. La même conséquence vaut aussi pour le fait que les champs<br />
cultivés étaient sans doute souvent réutilisés et que les semailles étaient irrémédiablement<br />
mêlées aux graines (toujours sauvages) tombées naturellement à <strong>la</strong> période de moisson<br />
précédente. Aussi, <strong>la</strong> présence prépondérante d'adventices, qui sont <strong>des</strong> mauvaises herbes<br />
proliférant en terres meubles, <strong>dans</strong> les r<strong>est</strong>es archéobotaniques <strong>des</strong> sites de <strong>la</strong> Période 2<br />
montrent que <strong>la</strong> terre fut sans doute travaillée. Enfin, tous ces faits théoriques s’appuient<br />
59
sur les résultats d'une expérience unique, menée à Jalès par <strong>la</strong> Maison de l'Orient, sur un<br />
champ de céréales sauvages identiques à celles qui furent l'objet <strong>des</strong> premières<br />
dom<strong>est</strong>ications (Willcox 2000).<br />
II- les origines de l’apparition de l’agriculture<br />
Il semble logique de croire que l'agriculture, une fois inventée, <strong>est</strong> passée par une<br />
longue période d'essai avant d'être utilisée à grande échelle. D'ailleurs, il me semble peu<br />
probable que son invention ait eu lieu en contexte de pression extérieure et, sans discuter<br />
ici <strong>la</strong> possibilité d'une révolution mentale, je suivrai Cauvin pour dire qu'il s'agit d'une<br />
invention mettant en scène l'homme <strong>dans</strong> sa capacité intellectuelle à s'adapter à son<br />
milieu. Si cette idée peut paraître banale, on a longtemps cru, et on croit encore, que<br />
l’invention de l’agriculture était le simple pro<strong>du</strong>it <strong>des</strong> pressions extérieures, <strong>la</strong><br />
conséquence d’une nécessité dénuée de tout génie humain. L'homme vit, à cette époque,<br />
<strong>dans</strong> le milieu d'abondance naturelle qui a suivi le dernier épisode g<strong>la</strong>ciaire <strong>du</strong> Dryas. Il<br />
<strong>est</strong> maintenant reconnu que l’homme préhistorique, vivait <strong>dans</strong> une re<strong>la</strong>tive abondance<br />
(Sahlins 1976). Cependant, au Mésolithique et au Néolithique, cette abondance en<br />
végétaux sauvages et en gibier au Moyen-Orient fut telle qu’elle a permis à l'homme<br />
d’abandonner son mode de vie mobile, désormais inutile à l'obtention de nourriture. On a<br />
longtemps cru que c'<strong>est</strong> à cause d'une certaine pression (climatique telle que <strong>dans</strong> l'Oasis<br />
Theory de R. Pumpelly, ou démographique suivant le marginality model de Binford ) que<br />
l'homme a été poussé à inventer l'agriculture (Bar-Yosef 1992: 11). Etant donné les<br />
excellentes conditions naturelles qui régnaient partout à l'époque et <strong>la</strong> difficulté<br />
d’inventer et de bénéficier d’une technique aussi complexe que l’agriculture en peu de<br />
temps (sous <strong>la</strong> menace d’une pression), cette hypothèse <strong>est</strong> à sérieusement remettre en<br />
cause. Ainsi, puisque rien ne semb<strong>la</strong>it - et ne pouvait- presser l'homme à cette découverte,<br />
le phénomène a dû prendre beaucoup plus de temps que <strong>la</strong> "Révolution Néolithique" ne<br />
l'implique. Son invention <strong>est</strong>, à mon avis, à mettre au compte de <strong>la</strong> curiosité humaine<br />
envers les mécanismes de <strong>la</strong> nature. L'hypothèse de l’accident n'<strong>est</strong> pas non plus à écarter<br />
et peut être même complémentaire à <strong>la</strong> curiosité ; il <strong>est</strong> possible, par exemple, que les<br />
nouvelles pousses, visibles chaque année autour <strong>des</strong> aires de battage, aient éveillé leur<br />
attention (Willcox 2000: 135). <strong>Le</strong>urs observations se sont peut-être affinées <strong>du</strong> fait que,<br />
depuis leur sédentarité, les hommes étaient en permanence confrontés au même<br />
environnement. Une fois le procédé compris, l'homme a dû passer par de longues<br />
60
pério<strong>des</strong> d'expérimentation pour bien le maîtriser, pour même s'apercevoir de sa réelle<br />
utilité puisque, encore une fois, <strong>la</strong> cueillette suffisait, à moindre peine, à leurs besoins.<br />
Cette période d'agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique m' apparaît donc tout à fait p<strong>la</strong>usible et<br />
même nécessaire à l'é<strong>la</strong>boration d'une agriculture suffisamment intensive pour voir<br />
apparaître <strong>des</strong> formes dom<strong>est</strong>iques. Chronologiquement, cette période, où les adventices<br />
semblent proliférer et où de véritables aménagements sont prévus pour le stockage <strong>des</strong><br />
récoltes (qui supposent eux aussi une emprise plus artificielle sur <strong>la</strong> récolte <strong>des</strong> céréales)<br />
<strong>est</strong> <strong>est</strong>imée entre 9500 et 8000 av. J.-C., c'<strong>est</strong>-à-dire de <strong>la</strong> Période 2 au début de <strong>la</strong> Période<br />
3.<br />
III- L’agriculture dom<strong>est</strong>ique<br />
C'<strong>est</strong> donc vers le milieu de <strong>la</strong> Période 3, qu'apparaissent les premières<br />
agricultures dom<strong>est</strong>iques à Halu<strong>la</strong> sur le Moyen Euphrate (Molist-Faura 1999: 301) et<br />
peut-être un peu avant, vers 8300 () en Anatolie, car c'<strong>est</strong> là que se situe l'ancêtre<br />
génétiquement sauvage <strong>des</strong> premières graines dom<strong>est</strong>iques (le blé engrain,) et c'<strong>est</strong> là<br />
qu'elles sont d'abord dom<strong>est</strong>iquées, comme le montrent <strong>des</strong> analyses d'ADN<br />
d'échantillons de sites tels que Cafer Höyük ou Cayönü (Willcox 2000: 135 ; Aurenche-<br />
Kozlowski 1999: 85).<br />
<strong>Le</strong> cas de Cayönü, étudié en détail par Frédéric Gérard, <strong>est</strong> pour l’étude <strong>du</strong> mode<br />
de subsistance, une mine considérable d’information. <strong>Le</strong> site, qui présente une longue<br />
occupation, de <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> Période 2 et sur toute <strong>la</strong> Période 3, se trouve <strong>dans</strong> une zone<br />
d'abondance optimale où figurent les indivi<strong>du</strong>s sauvages <strong>des</strong> premières espèces de<br />
céréales cultivées et, plus particulièrement, le blé engrain (Hillman 1996: 162). Dès <strong>la</strong><br />
phase en grill p<strong>la</strong>ns, au tout début de <strong>la</strong> Période 2, <strong>des</strong> aménagements sont mis en p<strong>la</strong>ce<br />
pour stocker les surplus céréaliers. <strong>Le</strong>s sols sont surélevés pour <strong>la</strong> première fois, sur <strong>des</strong><br />
fondations complexes. Sur presque deux millénaires, jusqu'à <strong>la</strong> phase de p<strong>la</strong>ns en cellules,<br />
les habitats, de dimensions assez impressionnantes (en moyenne environ 60 m² pour les<br />
grill p<strong>la</strong>n buildings) en comparaison avec <strong>la</strong> période précédente, présentent une<br />
remarquable homogénéité fonctionnelle, malgré quelques améliorations techniques,<br />
réservant près de <strong>la</strong> moitié de leur surface totale au stockage <strong>des</strong> grains (For<strong>est</strong> 1996 : 7).<br />
Il <strong>est</strong> intéressant alors de constater que <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> grains n'apparaît qu'à <strong>la</strong><br />
moitié de <strong>la</strong> phase en p<strong>la</strong>n cellu<strong>la</strong>ire et que <strong>la</strong> conception de l'architecture n’en <strong>est</strong><br />
aucunement modifiée. Il devient donc très difficile de nier l'existence d'une agriculture<br />
61
pré-dom<strong>est</strong>ique pour les niveaux inférieurs. Ce<strong>la</strong> constitue un autre exemple pour<br />
minimiser l'importance que l'on doit apporter à <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication <strong>du</strong> grain (Gérard 1996:<br />
24, 41).<br />
Si l'invention de l'agriculture se fait <strong>dans</strong> un contexte calme et prospère, il <strong>est</strong><br />
probable que son utilisation à grande échelle <strong>est</strong> <strong>du</strong>e à certaines pressions. D’ailleurs, ce<br />
n’<strong>est</strong> que vers <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> PPNB, quand commence le déclin de <strong>la</strong> culture de Cayönü, que<br />
l’agriculture dom<strong>est</strong>ique, qui implique une intensification, apparaît (Ozdogan 1997: 13).<br />
La pression démographique a sans doute joué un rôle majeur, ce qui n’empêche pas<br />
l’impact <strong>du</strong> changement climatique (aridité dont <strong>la</strong> région subit encore les conséquences<br />
aujourd'hui), et <strong>des</strong> raisons écologiques: <strong>la</strong> pastoralisation naissante aurait érodé et<br />
provoqué <strong>la</strong> défor<strong>est</strong>ation de l'environnement (Rollefson 1989: 173). Mais peut-être au<strong>des</strong>sus<br />
de ces considérations, <strong>la</strong> possibilité d'un conflit social <strong>est</strong> à garder en mémoire,<br />
étant donné <strong>la</strong> division très c<strong>la</strong>ire <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges en zones hiérarchiques, comme le montre<br />
Cayönü (Gérard 1996: 25). Ce n'<strong>est</strong> d'ailleurs pas un hasard si cette nouvelle structuration<br />
vil<strong>la</strong>geoise apparaît à peu près en même temps que les grains dom<strong>est</strong>iques, c'<strong>est</strong>-à-dire<br />
vers le PPNB moyen / récent. Cette époque amorce c<strong>la</strong>irement une période de troubles à<br />
venir, voire de désagrégation presque totale <strong>du</strong> système en p<strong>la</strong>ce, comme c'<strong>est</strong> le cas au<br />
<strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> (Rollefson 1989: 169).<br />
IV- Données ethnologiques et répercutions sociologiques<br />
Si le rôle joué par l’agriculture lors de cette néolithisation n’<strong>est</strong> pas aussi important qu’on<br />
a bien voulu le croire pendant longtemps, il faut essayer de définir ce qui a vraiment<br />
changé et pourquoi. Un partie <strong>du</strong> fond <strong>du</strong> problème réside bien <strong>dans</strong> le mode de<br />
subsistance et <strong>des</strong> stratégies adoptées pour le faire évoluer. L’ethnographie (T<strong>est</strong>art<br />
1982 : 175) rapporte <strong>des</strong> cas non rarissimes, comme les Indiens de <strong>la</strong> côte ou<strong>est</strong><br />
d’Amérique <strong>du</strong> Nord, considérés comme une c<strong>la</strong>sse à part entière de chasseurs-cueilleurs,<br />
à <strong>la</strong> différence de pratiquer le stockage (voir structures sociales), ayant constitué <strong>des</strong><br />
sociétés plus complexes que celles <strong>des</strong> chasseurs-cueilleurs traditionnels. Il semblerait<br />
que les Natoufiens fassent partie de cette même catégorie. Ces chasseurs-cueilleurs<br />
stockeurs possèdent tous <strong>la</strong> même particu<strong>la</strong>rité d’être sédentaires et d’avoir développé à<br />
un niveau non négligeable <strong>des</strong> inégalités sociales, une stratification de <strong>la</strong> société et une<br />
division sociale <strong>du</strong> travail. La cause commune de tout ceci <strong>est</strong> unique et primordiale ; il<br />
s’agit de <strong>la</strong> pratique <strong>du</strong> stockage <strong>des</strong> ressources alimentaires sur une base saisonnière.<br />
62
Ce phénomène s’<strong>est</strong> mis en p<strong>la</strong>ce très probablement grâce à deux facteurs. L’un<br />
<strong>est</strong> l’amélioration <strong>des</strong> conditions climatiques à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> période g<strong>la</strong>ciaire, qui ont<br />
favorisé l’abondance <strong>des</strong> ressources naturelles susceptibles d’être stockées, en<br />
l’occurrence les graines céréalières, mais il ne peut s’agir <strong>du</strong> seul facteur, car <strong>la</strong> Terre a<br />
connu bien d’autres réchauffements qui n’ont pas engendré de tels bouleversements.<br />
L’autre facteur <strong>est</strong> le développement <strong>des</strong> techniques, car le stockage, ainsi que<br />
l’exploitation intensive d’une ressource pendant une période r<strong>est</strong>reinte, demandent une<br />
maîtrise technique importante. Certaines de ces techniques furent développées dès <strong>la</strong> fin<br />
<strong>du</strong> Paléolithique et ont continué tout au long <strong>du</strong> Mésolithique et ont rencontré, par<br />
coïncidence () les améliorations climatiques de <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> Pléistocène. Ces techniques<br />
incluent un développement <strong>des</strong> traditions lithiques. <strong>Le</strong>s meules de broyage apparaissent et<br />
le microlithisme semble jouer un rôle important également. L’idée d’insérer <strong>des</strong> pièces de<br />
très petits mo<strong>du</strong>les <strong>dans</strong> un manche en os ou en bois, comme pour <strong>la</strong> faucille, permet<br />
d’avoir <strong>des</strong> outils beaucoup plus résistants, plus rapi<strong>des</strong> à confectionner, plus faciles à<br />
réparer (il suffit de changer <strong>la</strong> petite pièce hors d’usage plutôt que <strong>la</strong> <strong>la</strong>me entière) et,<br />
surtout, plus tranchants, ce qui prend toute sa signification <strong>dans</strong> le cas d’une récolte<br />
saisonnière intensive (T<strong>est</strong>art 1982 : 183-5, 190).<br />
C’<strong>est</strong> ainsi que les Natoufiens forment une <strong>des</strong> premières sociétés au monde de<br />
chasseurs-cueilleurs sédentaires stockeurs (T<strong>est</strong>art 1982 : 137). La technique <strong>du</strong> stockage<br />
implique forcément celle de <strong>la</strong> conservation. Celle-ci pose peu de problèmes puisque les<br />
denrées stockées sont les graines céréalières, dont le stockage nécessite peu de<br />
préparation. En effet, les causes de dégradation <strong>des</strong> matières organiques sont <strong>la</strong><br />
combinaison, en partie, d’humidité et de chaleur, favorisant <strong>la</strong> division cellu<strong>la</strong>ire. La<br />
graine, en tant qu’agent repro<strong>du</strong>cteur, bénéficie d’une <strong>du</strong>rée de vie exceptionnellement<br />
longue et sa teneur en eau <strong>est</strong> très basse. Un séchage préliminaire <strong>des</strong> graines et leur<br />
stockage <strong>dans</strong> <strong>des</strong> silos au frais, au sec et ventilés suffisent à leur conservation (T<strong>est</strong>art<br />
1982 : 105-1, 154, 158). On comprend ainsi <strong>la</strong> nécessité <strong>des</strong> habitants <strong>des</strong> Hautes Vallées,<br />
ayant affaire à un climat plus humide, de construire leurs aires de stockage sur <strong>des</strong> grils<br />
favorisant <strong>la</strong> venti<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> conservation au sec <strong>des</strong> denrées. La re<strong>la</strong>tive facilité<br />
d’adoption <strong>des</strong> techniques de conservation <strong>des</strong> graines, ajoutée aux conditions<br />
climatiques méditerranéennes (sec et frais pendant l’hiver qui <strong>est</strong> <strong>la</strong> principale période de<br />
stockage) ont probablement aidé <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce précoce et rapide de ces sociétés<br />
sédentaires. Ainsi, une denrée, exploitable qu’une petite partie de l’année, doit être<br />
63
stockée en grande quantité pour pallier aux pério<strong>des</strong> de pénurie. Ce stock qui ne peut être<br />
dép<strong>la</strong>cé et qui doit être gardé, implique <strong>la</strong> sédentarisation <strong>du</strong> groupe. <strong>Le</strong>s graines étant<br />
facilement stockables, <strong>la</strong> constitution de surplus <strong>est</strong> sans doute vite apparue comme <strong>la</strong><br />
possibilité d’appropriation <strong>des</strong> ressources par certains groupes sociaux comme en<br />
témoignent certains écrits ethnographiques. Donc, les règles de partage en vigueur <strong>dans</strong><br />
les sociétés noma<strong>des</strong> égalitaires sont changées et, par un système complexe de<br />
redistribution, de pot<strong>la</strong>tchs 2 , de dons, de l’ostentation <strong>des</strong> richesses et <strong>du</strong> développement<br />
de <strong>la</strong> notion de pr<strong>est</strong>ige à travers <strong>des</strong> objets de valeur, se met en p<strong>la</strong>ce progressivement<br />
l’idée d’une société fondée sur l’exploitation de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion au profit <strong>des</strong> élites (T<strong>est</strong>art<br />
1982 : 40-3).<br />
V- <strong>Le</strong> cas de l’élevage<br />
L'élevage, c'<strong>est</strong>-à-dire le contrôle de <strong>la</strong> repro<strong>du</strong>ction <strong>des</strong> animaux, pose <strong>des</strong><br />
problèmes comparables à ceux de <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ntes, en ce sens qu'il <strong>est</strong> bien<br />
difficile de trouver les traces d’un élevage pré-dom<strong>est</strong>ique, ainsi que sa <strong>du</strong>rée et son aire<br />
d'occupation, <strong>dans</strong> les r<strong>est</strong>es archéozoologiques. Cette supposition r<strong>est</strong>e cependant très<br />
p<strong>la</strong>usible. La dom<strong>est</strong>ication animale <strong>est</strong> elle aussi reconnaissable à différents traits<br />
morphologiques tels que <strong>la</strong> diminution de <strong>la</strong> taille <strong>des</strong> os ainsi que <strong>la</strong> modification de leur<br />
conformation (particulièrement les chevilles <strong>des</strong> cornes <strong>des</strong> caprinés). Ces deux critères,<br />
les plus souvent utilisés pour reconnaître le mode de subsistance en vigueur <strong>dans</strong> un site,<br />
bien qu'étant de bons indices, ne sont pas universels puisqu'ils supposent une bonne<br />
connaissance de <strong>la</strong> morphologie de leurs ancêtres sauvages, et de savoir si ces<br />
changements ne sont pas dûs à d’autres altérations de type climatiques par exemple. A<br />
ce<strong>la</strong>, on peut ajouter d'autres critères qui incluent <strong>la</strong> diminution de <strong>la</strong> diversité génétique,<br />
<strong>la</strong> prédominance d'une espèce particulière au sein d'un même site, avec toutes les parties<br />
de son squelette représentées, le choix de l'âge et <strong>du</strong> sexe <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s abattus, qui se<br />
tourne souvent vers les jeunes mâles <strong>dans</strong> le cas de l'élevage bien que ces paramètres<br />
soient parfois très bien imités <strong>dans</strong> le cadre d'une chasse bien maîtrisée. (Vigne 2000 :<br />
147-8).<br />
2 fêtes organisées par un groupe - généralement une unité familiale - consistant principalement<br />
en <strong>la</strong> distribution de nourriture ou autres richesses <strong>dans</strong> le but de s’acquérir un pr<strong>est</strong>ige au sein<br />
de <strong>la</strong> ou <strong>des</strong> communauté(s) impliquée(s) (T<strong>est</strong>art 1982 : 70-2, 207-8).<br />
64
<strong>Le</strong>s résultats de ces dernières années ont beaucoup changé l’avis <strong>des</strong> spécialistes<br />
quant aux dates et au lieu de l’apparition de l’élevage, et ceci nous intéresse au plus haut<br />
point. Malgré <strong>la</strong> quantité conséquente de données accumulées sur le <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> depuis<br />
<strong>des</strong> années, les quelques nouveaux sites, notamment en Turquie, ont suffi à complètement<br />
modifier l’opinion <strong>des</strong> chercheurs. Ce n’<strong>est</strong> plus <strong>du</strong> tout en Pal<strong>est</strong>ine qu’il faut chercher<br />
les premières traces de dom<strong>est</strong>ication animale (à part celle <strong>du</strong> chien), mais bien en<br />
Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>, dès le PPNB ancien, à Nevali Cori pour les caprins et les ovins et à<br />
Cayönü pour les suinés (sangliers) et peut-être même pour les premiers bovins. S’en<br />
suivront, peu après et sur l’ensemble <strong>des</strong> sites anatoliens, les bœufs, porcs, chèvres,<br />
moutons, dont les ancêtres sauvages se trouvent tous <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région (Vigne 2000 :149).<br />
Ce n’<strong>est</strong> qu’au PPNB moyen que ces formes dom<strong>est</strong>iques apparaîtront sur l’Euphrate<br />
syrien, à Halu<strong>la</strong> et Abu Hureryra, à Chypre et <strong>dans</strong> le Zagros, et, plus tardivement encore,<br />
<strong>dans</strong> le <strong>sud</strong> <strong>Le</strong>vant (transition PPNB moyen-récent) (Vigne 2000 : 151-152).<br />
Ces résultats sont quelques peu étonnants car ils remettent peut-être en cause<br />
l’ordre d’apparition de l’élevage et de l’agriculture, <strong>du</strong> moins <strong>dans</strong> leurs formes<br />
dom<strong>est</strong>iquées, puisque cette dernière n’<strong>est</strong> pas reconnue avant le PPNB récent. En tout<br />
cas c’<strong>est</strong> bien en Anatolie que les deux apparaissent, au cours d’une période faste, pour<br />
ensuite se diffuser aux alentours. Ceci confirme non seulement l’idée d’un aboutissement<br />
de <strong>la</strong> néolithisation en Anatolie et non au <strong>Le</strong>vant mais aussi une diffusion inversée à<br />
partir <strong>du</strong> PPNB d’Anatolie vers le <strong>Le</strong>vant. Quant au contexte de ces innovations, comme<br />
le note Vigne (2000 :151) « <strong>des</strong> bâtiments collectifs (…) témoignent d’une vie sociale<br />
organisée. Il s’agit probablement là d’un indice de hiérarchisation de <strong>la</strong> société (…). <strong>Le</strong><br />
débitage <strong>du</strong> silex, extrêmement é<strong>la</strong>boré témoigne d’un niveau cognitif indivi<strong>du</strong>el et<br />
collectif très avancé. L’innovation que représente l’apparition de l’élevage <strong>dans</strong> ces<br />
sociétés n’<strong>est</strong> donc qu’une <strong>des</strong> expressions de leur excellente maîtrise collective <strong>des</strong><br />
ressources naturelles et de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction ».<br />
E-Synthèse<br />
Pour résumer les différentes étapes de l’apparition de l’agriculture, les Natoufiens<br />
ont intensément cueilli les céréales et, probablement au début de <strong>la</strong> Période 2, ou peutêtre<br />
avant, les Khiamiens et les Mureybétiens au <strong>Le</strong>vant nord ont commencé à pratiquer<br />
l’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique. Ceci implique les semailles <strong>des</strong> graines, mais de façon non<br />
intensive et en pratiquant toujours <strong>la</strong> cueillette en parallèle, ce qui ralentit le processus<br />
65
naturel de dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ntes. Ce n’<strong>est</strong> pas avant le PPNB moyen que l’on voit<br />
apparaître, en Anatolie d’abord, puis au <strong>Le</strong>vant et <strong>dans</strong> les régions voisines aux pério<strong>des</strong><br />
suivantes, les premières graines, ainsi que les premiers animaux (PPNB ancien), de<br />
morphologie dom<strong>est</strong>ique. Ce<strong>la</strong> indique, en fait simplement, une intensification <strong>des</strong><br />
pratiques existant à <strong>la</strong> période précédente et ce<strong>la</strong> rejoint parfaitement les conclusions<br />
établies <strong>dans</strong> les autres domaines étudiés ; l’Anatolie, après avoir emprunté certaines<br />
techniques au <strong>Le</strong>vant nord (ici, particulièrement celle de l’agriculture), les développe,<br />
notamment grâce et à cause d’une popu<strong>la</strong>tion plus importante, si l’on en croit <strong>la</strong> taille<br />
grandissante de sites, à gérer et à exploiter. Elle devient donc un centre novateur et qui<br />
exporte à son tour cette nouvelle conception <strong>du</strong> mode de subsistance fondée presque<br />
uniquement sur l’agriculture.<br />
En conclusion, c’<strong>est</strong> certainement aux Natoufiens que l’on doit l’apparition <strong>des</strong><br />
inégalités sociales au Proche-Orient, (elles peuvent être dé<strong>du</strong>ites même si elles sont<br />
encore invisibles <strong>dans</strong> le matériel), et le début d’un mouvement de l’histoire qui va<br />
inclure l’agriculture. L’agriculture <strong>est</strong> un élément multiplicateur, certes, qui approfondit<br />
les fossés entre les différents groupes sociaux (il <strong>est</strong> encore trop tôt pour parler de<br />
c<strong>la</strong>sses), et sans lequel l’Etat <strong>est</strong> inconcevable, car il intensifie les surplus et donc <strong>la</strong><br />
richesse de celui qui se les approprie ainsi que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion exploitable. Même à<br />
l’apogée de <strong>la</strong> civilisation néolithique, il <strong>est</strong> hors de qu<strong>est</strong>ion de parler d’Etat mais l’on<br />
voit que les germes de l’institution étatique sont présents. En effet, « les inégalités<br />
semblent être fonction croissante <strong>du</strong> stockage et de <strong>la</strong> sédentarisation » (T<strong>est</strong>art 1982 :<br />
197-9). On comprend donc parfaitement, comme nous l’avons déjà indiqué, que<br />
l’agriculture n’<strong>est</strong> qu’un élément <strong>dans</strong> le développement historique de <strong>la</strong> période, mais<br />
n’<strong>est</strong> pas le déclencheur de <strong>la</strong> naissance <strong>des</strong> inégalités et de <strong>la</strong> complexité <strong>des</strong> sociétés.<br />
66
VI<br />
-<br />
Structures sociales et affiliations<br />
culturelles<br />
<strong>des</strong> sociétés anatoliennes<br />
67
Suite aux différentes innovations de type économique et technique, et aux<br />
changements environnementaux et démographiques que nous avons traités, <strong>la</strong><br />
néolithisation entraîne un changement irréversible <strong>des</strong> structures sociales, qu’il nous faut<br />
maintenant tenter d’établir et de comprendre. Pour ce<strong>la</strong>, il faut essayer d’élucider les<br />
modalités de cette transformation, afin de pouvoir identifier au mieux le type de société<br />
correspondant à chaque période. Nous pouvons supposer d’emblée que ces structures<br />
sociales évoluent par étapes, parallèlement aux autres innovations humaines <strong>du</strong><br />
Néolithique, et ainsi corroborer, ou non, nos conclusions. Parallèlement, nous résumerons<br />
les affiliations culturelles de ces groupes, <strong>dans</strong> un but de reconstitution historique et<br />
chrono-culturelle, et en les rattachant à ces types d’organisation sociale.<br />
<strong>Le</strong>s travaux <strong>des</strong> anthropologues évolutionnistes, notamment marxistes, ont<br />
échafaudé <strong>des</strong> systèmes de lignée comprenant <strong>des</strong> phases d’organisation sociale très<br />
strictes par lesquelles tout groupe humain doit, tôt ou tard, passer. Ces phases telles que <strong>la</strong><br />
bande, <strong>la</strong> tribu, <strong>la</strong> chefferie ou l’Etat sont attribuées à <strong>des</strong> concepts socio-économiques<br />
comme l’esc<strong>la</strong>vagisme, le féodalisme, le capitalisme ou le communisme (Trigger 1989 :<br />
292). Nous savons aujourd’hui que ce schéma évolutif <strong>est</strong> beaucoup plus complexe et<br />
doit tenir compte <strong>des</strong> déterminations environnementales, <strong>des</strong> diffusions culturelles<br />
brutales etc. Si l’on peut cependant définir un type de société auquel les groupes étudiés<br />
ici doivent appartenir, nous nous p<strong>la</strong>cerons <strong>dans</strong> une vision également évolutionniste.<br />
Nous nous fonderons sur <strong>des</strong> travaux ethnologiques pour nous permettre de réaliser ces<br />
identifications.<br />
Pour <strong>la</strong> Période I, il <strong>est</strong> c<strong>la</strong>ir que, même parmi les sociétés les plus anciennes<br />
étudiées ici, nous ne sommes déjà plus <strong>dans</strong> un cas de communisme primitif tel que<br />
T<strong>est</strong>art (1985 : 84-5) le définit, c’<strong>est</strong>-à-dire <strong>dans</strong> un système de non-appropriation <strong>des</strong><br />
pro<strong>du</strong>its par le pro<strong>du</strong>cteur, mais par <strong>la</strong> communauté. Nous sommes plutôt <strong>dans</strong> une<br />
société de chasseurs-cueilleurs sédentaires et stockeurs où les inégalités commencent déjà<br />
à apparaître (T<strong>est</strong>art 1982 : 136-7 ; Trigger 1989 : 399). Selon T<strong>est</strong>art, c’<strong>est</strong> le stockage et<br />
le développement <strong>des</strong> techniques de conservation <strong>des</strong> denrées saisonnières qui sont à <strong>la</strong><br />
base de <strong>la</strong> sédentarisation et <strong>des</strong> inégalités, à travers l’appropriation <strong>du</strong> surtravail <strong>des</strong><br />
pro<strong>du</strong>cteurs par un exploiteur.<br />
68
Cette période <strong>est</strong> marquée par de grands bouleversements climatiques<br />
(réchauffement global de <strong>la</strong> Terre), qui n’a pas encore d’emprise véritable sur<br />
l’environnement anatolien, mais qui font <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant une zone particulièrement abondante<br />
en ressources naturelles. Ceci, ajouté à un développement technique qui prend ses<br />
origines à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong> Paléolithique et au Mésolithique, va donner, au <strong>Le</strong>vant, les premières<br />
sociétés de type chasseur-cueilleur sédentaire et pratiquant le stockage saisonnier de<br />
graines ; ce sont les Natoufiens. Il s’agit là <strong>des</strong> éléments de base, sans avoir recours à<br />
l’agriculture, de <strong>la</strong> première forme de complexification de <strong>la</strong> société, accompagnée <strong>du</strong><br />
début de l’inégalité sociale. L’importation d’obsidienne montre que les stratifications<br />
sociales, <strong>la</strong> naissance d’une ploutocratie, a déjà commencé (T<strong>est</strong>art 1982 : 19, 20, 23-4).<br />
Ceci dit, le cas anatolien <strong>est</strong> plus difficile à traiter. Nous ne disposons, à l’heure<br />
actuelle, que d’un seul site sédentaire, celui d’Hal<strong>la</strong>n Cemi, pour cette période. Pour les<br />
sociétés de chasseurs-cueilleurs noma<strong>des</strong> qui vivaient <strong>dans</strong> les environs, <strong>dans</strong> <strong>des</strong><br />
campements comme à Biris Mezarligi, les traces sont trop succinctes pour établir avec<br />
précision leur mode de fonctionnement social. L’in<strong>du</strong>strie lithique trouvée sur ces sites,<br />
même si elle diffère de celle <strong>des</strong> sites natoufiens, <strong>est</strong> cependant de type mésolithique, ce<br />
qui implique un développement technique <strong>des</strong> armes qui remp<strong>la</strong>ce, <strong>dans</strong> le vrai<br />
communisme primitif, <strong>la</strong> chasse en coopération, suffisant pour que, selon T<strong>est</strong>art (1985 :<br />
168-73), un certain sens de l’indivi<strong>du</strong>alité soit déjà mis en p<strong>la</strong>ce. Hal<strong>la</strong>n Cemi n’<strong>est</strong> sans<br />
doute pas le seul site de chasseurs sédentaires et stockeurs existant pour cette période, ce<br />
que vérifieront probablement les recherches futures. <strong>Le</strong> choix de se sédentariser semble<br />
cependant marginal et n’intervient qu’à <strong>la</strong> toute fin de <strong>la</strong> période, quand les améliorations<br />
climatiques commencent à se faire sentir. De plus, il apparaît que les v<strong>est</strong>iges retrouvés<br />
<strong>dans</strong> les campements et à Hal<strong>la</strong>n Cemi proviennent de <strong>la</strong> même origine culturelle. Il s’agit<br />
donc bien d’un choix et cette différence de type de pro<strong>du</strong>ction ne dicte pas une différence<br />
culturelle mais environnementale.<br />
Comme le montrent ces cartes (fig), <strong>la</strong> Période 1 en Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> <strong>est</strong><br />
peuplée, bien que très mo<strong>des</strong>tement, par un groupe culturel local affilié ou pouvant faire<br />
partie, d’un plus grand groupe appelé Trialétien (d’origine caucasienne ou locale ),<br />
comme le montre <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique. Certains signes dénotent en parallèle une<br />
influence très c<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> culture qui vient <strong>du</strong> Zagros, connue sous le nom de Zarzien.<br />
69
A <strong>la</strong> Période 2, ce schéma culturel se retrouve, mais les sites sédentaires<br />
se développent, non pas tellement en nombre mais en popu<strong>la</strong>tion. Si l’on considère l’idée<br />
de T<strong>est</strong>art selon <strong>la</strong>quelle, c’<strong>est</strong> <strong>la</strong> sédentarité, et donc le stockage (<strong>des</strong> céréales, celui <strong>des</strong><br />
ressources animalières étant impossible <strong>dans</strong> ce contexte) qui <strong>est</strong> à <strong>la</strong> base <strong>des</strong> inégalités<br />
sociales et donc d’une plus forte démographie, les données <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges PPNA <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant<br />
confortent bien cette idée. Gopher (1989 : 47) a en effet montré que ce sont les petits<br />
sites, donc les moins peuplés et les moins développés (i.e. les moins enclins à <strong>la</strong><br />
stratification sociale) qui comptent le plus de pointes de flèches <strong>dans</strong> leurs assemb<strong>la</strong>ges<br />
lithiques, alors que sur les plus grands sites, où l’on suppose une stratification sociale<br />
plus forte, on trouve une moindre proportion de ces pointes, impliquant une activité<br />
cynégétique moins importante et, par conséquent, une activité de stockage <strong>des</strong> céréales<br />
plus significative.<br />
<strong>Le</strong>s vil<strong>la</strong>ges <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant nord, surtout <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région <strong>du</strong> Moyen-Euphrate, qui s’<strong>est</strong><br />
entre-temps beaucoup développée, et ceux d’Anatolie qui sont désormais entièrement<br />
sédentaires, commencent à s’organiser en communautés, ce qui implique d’importantes<br />
modifications <strong>du</strong> système sociale comme le confirment les étu<strong>des</strong> archéo-ethnologiques<br />
(For<strong>est</strong> 1996: 1-2). <strong>Le</strong> besoin se fait sentir d’avoir un bâtiment spécifique, (peut-être <strong>la</strong><br />
maison d’un chef ), réservé au stockage commun, et à <strong>la</strong> redistribution, sous contrôle,<br />
<strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its de <strong>la</strong> chasse et de <strong>la</strong> cueillette de l’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique, ce qui<br />
minimise les risques de pénuries alimentaires. Cette structure sert aussi à réunir certains<br />
membres <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge pour <strong>la</strong> prise de décisions communautaires, et à <strong>la</strong> pratique de rituels<br />
symboliques de l’ordre <strong>du</strong> surnaturel. La pro<strong>du</strong>ction agricole (pré-dom<strong>est</strong>ique) qui<br />
s’installe, au moins sur le Moyen-Euphrate et sans doute à Cayönü, voit s’accentuer <strong>la</strong><br />
sédentarisation, le nombre de sites (<strong>du</strong> moins en Anatolie) et leur densité démographique,<br />
ainsi que le sentiment d’appartenance à <strong>la</strong> terre (For<strong>est</strong> 1996: 5-6). <strong>Le</strong>s anciens,<br />
constituant le maillon le plus en amont de <strong>la</strong> chaîne de lignage familial et le plus proche<br />
de ces ancêtres qui sont le témoin le plus éloquent de cette appartenance à <strong>la</strong> terre,<br />
forment, sans doute, l’élément le plus respecté au sein de ces sociétés. <strong>Le</strong> partage de<br />
toutes les pro<strong>du</strong>ctions de <strong>la</strong> société demande un régu<strong>la</strong>teur, qui <strong>est</strong> généralement<br />
l’ancêtre. C’<strong>est</strong> peut-être lui qui possède les objets de pr<strong>est</strong>ige importés de très loin et que<br />
l’on retrouve <strong>dans</strong> ces sites en très petites quantités (objets en cuivre, mobilier lithique<br />
finement décoré, obsidienne, coquil<strong>la</strong>ges…) prouvant ainsi sa différence par rapport au<br />
r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> communauté. Et cette différence s’accroît proportionnellement au fur et à<br />
mesure que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion impliquée grandit. <strong>Le</strong>s échanges, sous forme de petits objets de<br />
70
valeur, qui nécessitent un surplus accumulé et un contrôle centralisé <strong>des</strong> ressources, se<br />
fait entre chefs de vil<strong>la</strong>ges, peut-être lors de pot<strong>la</strong>tchs, pour asseoir leur pr<strong>est</strong>ige et leur<br />
richesse au sein <strong>des</strong> leurs. L’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique a probablement encore<br />
re<strong>la</strong>tivement peu d’incidence économique sur ces sociétés, où sont cependant déjà bien<br />
ancrées, en fonction <strong>du</strong> nombre de gens impliqués, les premières inégalités sociales et le<br />
début de <strong>la</strong> spécialisation <strong>du</strong> travail (T<strong>est</strong>art 1982 : 43, 54)<br />
<strong>Le</strong> <strong>Le</strong>vant nord, héritier culturel direct <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions natoufiennes et<br />
khiamiennes devient, à <strong>la</strong> Période 2, le centre d’innovation majeur. <strong>Le</strong>s popu<strong>la</strong>tions<br />
anatoliennes gardent en règle générale et surtout au nord leurs traditions locales et leurs<br />
influences orientales, sauf <strong>dans</strong> le <strong>sud</strong> où, à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> période, le savoir-faire lithique <strong>du</strong><br />
<strong>Le</strong>vant nord se répercute déjà sur les peuples de <strong>la</strong> région d’Urfa.<br />
A <strong>la</strong> Période 3, l’Anatolie voit s’épanouir l’apogée de <strong>la</strong> culture néolithique.<br />
Plusieurs éléments permettent de décrire <strong>la</strong> complexité sociale de ces groupes et de<br />
p<strong>la</strong>cer celle-ci à un rang plus élevé que celui <strong>des</strong> premiers vil<strong>la</strong>ges sédentaires. Aussi, <strong>la</strong><br />
culture de Cayönü a <strong>des</strong> caractères très spécifiques qui en font un faciès vraiment unique<br />
de cette néolithisation (Ozdogan 1997: 9 ; 1998 : 35).<br />
La présence d’une certaine stratification de <strong>la</strong> société, plus complexe que celle <strong>des</strong><br />
vil<strong>la</strong>ges <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> précédentes, enracinée <strong>dans</strong> le Mésolithique, <strong>est</strong> reconnue entre<br />
autres grâce aux nombreux objets et structures de fonction purement ostentatoire et<br />
nécessitant cependant le temps et <strong>la</strong> spécialisation d’artisans. Outre <strong>la</strong> décoration <strong>des</strong><br />
sanctuaires et <strong>la</strong> confection de leur sol en terrazzo (qui demande une grande maîtrise de<br />
<strong>la</strong> pyrotechnologie), on trouve <strong>des</strong> objets de valeur, les mêmes qu’au pério<strong>des</strong><br />
précédentes, tels que les perles de cuivre, de l’obsidienne, <strong>des</strong> pierres semi-précieuses,<br />
<strong>des</strong> coquil<strong>la</strong>ges marins etc. (Ozdogan 1997 : 10). Ces objets ne sont pas éparpillés de<br />
façon hasardeuse, mais <strong>dans</strong> <strong>des</strong> habitations particulières, ce qui suggère une<br />
hiérarchisation <strong>des</strong> différentes parties <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge. Ainsi, après étude de l’organisation<br />
spatiale de Cayönü, on trouve que ce sont souvent les maisons regroupées autour de ces<br />
grands bâtiments somptuaires qui possèdent ces objets de pr<strong>est</strong>ige, et que ces maisons<br />
sont plus vastes et mieux construites et délimitent un périmètre à l’<strong>est</strong>, séparé <strong>des</strong> autres<br />
habitations <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge (Gérard 1996 : 65-66). Si <strong>la</strong> présence d’une élite <strong>est</strong> reconnaissable<br />
pour l’archéologue, il faut imaginer qu’elle était évidente pour les habitants <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge; en<br />
71
d’autres termes, cette disposition particulière <strong>des</strong> maisons reflète le besoin d’ostentation<br />
de cette élite.<br />
<strong>Le</strong> commerce de l’obsidienne renforce également ce point. Ce matériau <strong>est</strong> connu<br />
depuis <strong>la</strong> Période 1 au <strong>Le</strong>vant, provenant entièrement d’Anatolie. Comme le montrent les<br />
travaux ethnographiques (T<strong>est</strong>art 1982 : 100-1), l’obsidienne doit donc être très appréciée<br />
comme un matériau de valeur, de pr<strong>est</strong>ige, et non utilitaire étant donné les faibles<br />
quantités en jeu et l’effort mis <strong>dans</strong> son obtention, alors que <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> quantités de<br />
silex étaient présentes sur p<strong>la</strong>ce. Ce<strong>la</strong> prend tout son sens quand on s’aperçoit, notamment<br />
<strong>dans</strong> le mobilier funéraire natoufien, que c’<strong>est</strong> à cette époque qu’une certaine hiérarchie<br />
sociale voit le jour. Ce concept étant presque inconnu <strong>des</strong> traditions trialétiennes,<br />
popu<strong>la</strong>tions, à très peu d’exception près (Hal<strong>la</strong>n Cemi ), non sédentaire, il n’<strong>est</strong> pas<br />
étonnant que l’obsidienne y soit peu présente à <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> Période 2 et au début de <strong>la</strong><br />
Période 3, où l’on utilisait le silex. Ensuite, après que l’utilisation de l’obsidienne se soit<br />
généralisée en Anatolie, brusquement, au PPNB final, <strong>la</strong> quantité d’obsidienne augmente,<br />
et il faut peut-être y voir plus qu’une simple diffusion culturelle. Renfrew (1975: 32-8)<br />
explique théoriquement <strong>la</strong> diffusion <strong>du</strong> système de complexité sociale ainsi : en admettant<br />
que cette complexité soit présente d’abord chez un peuple (émetteur), par l’obtention<br />
depuis ces régions émettrices et l’ostentation <strong>des</strong> objets pr<strong>est</strong>igieux par les élites <strong>des</strong><br />
régions voisines en contact avec celle-ci se font respecter au sein de leur propre<br />
communautés et acquièrent un pr<strong>est</strong>ige fondé sur <strong>la</strong> richesse, le pouvoir et l’intimidation.<br />
Ensuite, elles contrôlent <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction de ces pro<strong>du</strong>its qui sont, par ailleurs, manufacturés<br />
par <strong>des</strong> experts reconnus, in<strong>du</strong>isant donc une division sociale <strong>du</strong> travail (Wattenmaker<br />
1998 : 7-9), constats encore une fois appuyés par <strong>des</strong> faits ethnologiques (T<strong>est</strong>art 1982 :<br />
100). La diffusion s’opère ensuite depuis les élites <strong>des</strong> groupes complexes vers celles de<br />
groupes receveurs. Ainsi, l’obsidienne revêt <strong>la</strong> même importance de pr<strong>est</strong>ige au sein <strong>des</strong><br />
peuples de complexité secondaire. Il faut bien être conscient que <strong>la</strong> diffusion de <strong>la</strong><br />
complexité d’une société et de sa culture n’<strong>est</strong> possible que si les popu<strong>la</strong>tions locales<br />
disposent déjà d’une certaine organisation, ce qui fut le cas en Anatolie.<br />
La complexité <strong>du</strong> système socioculturel <strong>est</strong> encore plus évidente au regard <strong>des</strong><br />
bâtiments somptuaires de Nevali Cori, Göbekli Tepe et Cayönü décorés de sculptures, de<br />
bas reliefs et sans doute de fresques aux dimensions monumentales, ce qui distingue<br />
c<strong>la</strong>irement <strong>la</strong> culture de Cayönü <strong>des</strong> premières sociétés sédentaires (Ozdogan 1998: 34).<br />
Il faut maintenant essayer de définir <strong>la</strong> cause de ce changement. T<strong>est</strong>art (1982) nous a<br />
montré, par analogie avec <strong>des</strong> observations ethnographiques, que les premiers véritables<br />
72
débuts de <strong>la</strong> complexité <strong>des</strong> sociétés ne naissaient pas avec l’agriculture mais avec <strong>la</strong><br />
sédentarité, même de chasseurs-cueilleurs qui peuvent stocker sur une base au moins<br />
annuelle <strong>des</strong> ressources alimentaires ne nécessitant pas forcément l’apport de<br />
l’agriculture. Ceci s’applique aux Indiens de <strong>la</strong> côte ou<strong>est</strong> de l’Amérique comme aux<br />
Natoufiens et à leurs <strong>des</strong>cendants de <strong>la</strong> Période 2 et même début de <strong>la</strong> Période 3. T<strong>est</strong>art<br />
(1982 : 198) ne nie cependant pas que, pour toutes les sociétés étudiées jusqu’à<br />
aujourd’hui, l’apparition de l’Etat ne peut se faire qu’avec l’apport de l’agriculture (et,<br />
étrangement, uniquement avec <strong>la</strong> céréaliculture), ceci pour <strong>des</strong> raisons entre autres de<br />
pro<strong>du</strong>ctivité, de surplus conséquents, d’accroissement démographique et de spécialisation<br />
<strong>du</strong> travail (à travers, par exemple, l’irrigation). C’<strong>est</strong> en effet seulement chez les<br />
agriculteurs céréaliers « que les inégalités se développent en opposition <strong>des</strong> c<strong>la</strong>sses et que<br />
naît l’Etat » (T<strong>est</strong>art 1982 : 198), comme en témoignent les civilisations<br />
mésopotamienne, égyptienne, chinoise, mexicaine, andine ou de <strong>la</strong> Vallée de l’In<strong>du</strong>s. Ce<br />
rôle multiplicateur ou amplificateur (T<strong>est</strong>art 1985 : 174) <strong>des</strong> effets engendrés par <strong>la</strong><br />
naissance <strong>des</strong> sociétés de chasseurs-cueilleurs, sédentaires et stockeurs, que revêt <strong>la</strong><br />
céréaliculture <strong>dans</strong> le développement historique <strong>des</strong> sociétés semble s’affirmer, à mon<br />
avis, dès le PPNB moyen anatolien. On trouve <strong>dans</strong> ces sociétés, appelées Communautés<br />
dom<strong>est</strong>iques agricoles (CDA) par Meil<strong>la</strong>ssoux (For<strong>est</strong> 1996 :2), <strong>des</strong> signes de début de<br />
stratification, une spécialisation accrue <strong>du</strong> travail, (notamment pour <strong>la</strong> fabrication de<br />
pro<strong>du</strong>its de pr<strong>est</strong>ige, <strong>la</strong> spécialisation technique - terrazzo, lithique, architecture, art - et<br />
les échanges à longue distance), une élite et donc un système d’exploitation de l’homme<br />
par l’homme. Il en résulte, peut-être par manque d’expérience face à ce nouveau système,<br />
l’éc<strong>la</strong>tement de cette société au PPNB récent comme le suggèrent les nombreux<br />
changements économiques et sociaux de cette époque, à savoir, <strong>la</strong> démocratisation de<br />
l’obtention de l’obsidienne, qui perd ainsi sa fonction de pr<strong>est</strong>ige, l’effondrement de <strong>la</strong><br />
construction de bâtiments somptuaires et <strong>la</strong> désertification <strong>des</strong> grands sites au profit de<br />
plus petits.<br />
Cette complexité <strong>est</strong>, bien enten<strong>du</strong>, re<strong>la</strong>tive et <strong>est</strong> encore bien loin <strong>des</strong> débuts <strong>des</strong><br />
véritables formations étatiques mésopotamiennes qui requièrent une popu<strong>la</strong>tion beaucoup<br />
plus importante et <strong>des</strong> mécanismes complexes de stratification sociale, lesquels sont<br />
totalement absents de toute société néolithique. Cependant, l’élite contrôle déjà de façon<br />
institutionnelle, et à sa propre échelle (il ne s’agit pas <strong>des</strong> grands bâtiments somptuaires<br />
de l’«Eanna Precinct » <strong>du</strong> 4 ème millénaire !), les organismes économiques et spirituels de<br />
73
<strong>la</strong> société. A savoir si le Néolithique anatolien <strong>est</strong> à <strong>la</strong> base de <strong>la</strong> formation étatique<br />
mésopotamienne <strong>est</strong> une toute autre qu<strong>est</strong>ion, que je ne vais qu’effleurer. Ce<strong>la</strong> pourrait<br />
sembler évident, mais on ne peut complètement rejeter l’hypothèse d’un développement<br />
autochtone. Il semble cependant difficile de concevoir que <strong>des</strong> quatre millénaires<br />
nécessaires à l’épanouissement <strong>du</strong> Néolithique, rien ne nous soit parvenu, malgré<br />
l’intensité <strong>des</strong> recherches <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région, de son développement parallèle en<br />
Mésopotamie, per<strong>du</strong>, s’il a jamais existé, sous les alluvions <strong>du</strong> Tigre et de l’Euphrate.<br />
Une certaine interaction avec <strong>la</strong> culture de Cayönü, à travers peut-être celle de Samarra<br />
géographiquement et chronologiquement, semble inéluctable. Ozdogan (1997 : 11 ;<br />
1998 : 35) va jusqu’à supposer que ce système anatolien «constitue les bases <strong>du</strong> modèle<br />
économique contrôlé par le temple <strong>des</strong> cultures syro-mésopotamiennes <strong>des</strong> pério<strong>des</strong><br />
historiques ». Alors que d’autres voient un fossé énorme entre les sociétés néolithiques<br />
pré-céramiques et les sociétés étatiques mésopotamiennes, sans être aussi radical<br />
qu’Ozdogan, il nous semble que <strong>la</strong> seule grande différence avec Cayönü soit de l’ordre de<br />
<strong>la</strong> densité de popu<strong>la</strong>tion impliquée, d’où le rôle multiplicateur, et non fondamentalement<br />
différent, de <strong>la</strong> céréaliculture dont parle T<strong>est</strong>art (1985 : 174). <strong>Le</strong>s institutions sociales et<br />
culturelles, ainsi que le fonctionnement général de <strong>la</strong> société mésopotamienne se<br />
retrouvent en grande partie, bien qu’à <strong>des</strong> degrés moindres mais avec un mécanisme de<br />
base très proche, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> culture de Cayönü. D’ailleurs, <strong>la</strong> culture de Ha<strong>la</strong>f qui a suivi<br />
celle-ci <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région, bien que formant une communauté dom<strong>est</strong>ique agricole elle aussi,<br />
r<strong>est</strong>era à un niveau de complexité sociale bien inférieure (For<strong>est</strong> 1996 : 3). Ce<strong>la</strong> montre<br />
que les sommets atteints par <strong>la</strong> culture de Cayönü ne « vont pas de soi », qu’ils sont<br />
re<strong>la</strong>tivement exceptionnels et qu’ils tra<strong>du</strong>isent <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité de cet ensemble. Nous<br />
pensons pouvoir dire que <strong>la</strong> complexité sociale d’un groupe <strong>est</strong> générée par le nombre de<br />
gens impliqués.<br />
Ce qui décide les gens à se regrouper <strong>est</strong> assez peu connu, mais il peut s’agir d’un<br />
phénomène en corré<strong>la</strong>tion avec le développement <strong>des</strong> inégalités issues de l’apparition <strong>du</strong><br />
stockage (T<strong>est</strong>art 1982 : 197). For<strong>est</strong> (1996: 3-4) suppose que c’<strong>est</strong> le besoin<br />
d’indépendance économique et de préservation de l’unité sociale (avoir <strong>des</strong> enfants pour<br />
assurer ses vieux jours) ainsi que les problèmes de repro<strong>du</strong>ction liés à l’endogamie et qui<br />
impliquent <strong>la</strong> co-existence de plusieurs lignages, qui ont amené plusieurs centaines<br />
d’indivi<strong>du</strong>s à se rassembler à Cayönü ou à Nevali Cori. Cependant, ces sociétés ne vivent<br />
pas, de toute évidence, isolées les unes <strong>des</strong> autres ; c’<strong>est</strong> ce que montre l’échange constant<br />
de matières premières, ainsi que l’expansion de traits culturels et techniques<br />
74
caractéristiques. <strong>Le</strong> site de Göbekli Tepe, comme nous avons déjà commencé à le voir,<br />
peut nous en apprendre davantage quant aux contacts intercommunautaires.<br />
<strong>Le</strong>s nombreux et grands bâtiments communautaires de Göbekli Tepe ont peut-être<br />
eu <strong>la</strong> même fonction que les salles de conseil vil<strong>la</strong>geois que nous avons vues<br />
précédemment, ainsi que le montre <strong>la</strong> présence de banquettes le long <strong>des</strong> murs<br />
(Hauptmann 1999 : 79), mais à une échelle régionale. Tout comme <strong>la</strong> communauté d’un<br />
vil<strong>la</strong>ge a besoin de déléguer <strong>des</strong> représentants pour mener à bien les affaires publiques, il<br />
<strong>est</strong> tout à fait envisageable de trouver une institution qui aurait ce même rôle, au niveau<br />
intercommunautaire, où les principaux personnages de chaque vil<strong>la</strong>ge pourraient se<br />
rencontrer <strong>dans</strong> le but d’assurer <strong>la</strong> stabilité, <strong>la</strong> paix, et <strong>la</strong> prospérité régionales (il <strong>est</strong><br />
encore trop tôt pour parler de stabilité politique et économique). Si l’<strong>est</strong> difficile de savoir<br />
si les sociétés de ces époques connaissaient <strong>la</strong> paix ou les guerres int<strong>est</strong>ines, à regarder<br />
l’ampleur que prend les échanges interrégionaux, les tensions intercommunautaires<br />
devaient être à <strong>la</strong> fois inévitables (convoitise) et contrôlées (puisqu’elle a per<strong>du</strong>ré). <strong>Le</strong>s<br />
unions intercommunautaires, auraient pu être l’occasion de gran<strong>des</strong> réunions tenues <strong>dans</strong><br />
les bâtiments de Göbekli, pourrait, par exemple, contribuer non seulement à cette<br />
stabilité, mais à l’enracinement <strong>du</strong> pr<strong>est</strong>ige <strong>des</strong> élites en démontrant par <strong>la</strong> même leurs<br />
liens intercommunautaires (où l’appartenance à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse supp<strong>la</strong>nte celle <strong>du</strong> c<strong>la</strong>n) en plus<br />
d’aider à enrayer <strong>des</strong> problèmes d’endogamie pour les vil<strong>la</strong>ges trop petits. Ces<br />
cérémonies, toujours p<strong>la</strong>cées en un même lieu pour <strong>des</strong> raisons d’ordre symbolique,<br />
auraient pu de <strong>la</strong> même façon, aider à renforcer l’idée d’appartenance à un même groupe<br />
culturel, en opposition avec les groupes de chasseurs-cueilleurs qui devaient continuer à<br />
peupler les alentours, un peu comme <strong>la</strong> citée d’Olympe, sacrée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Grèce antique, qui<br />
servait à <strong>des</strong> cérémonies régulières et organisées au cours <strong>des</strong>quelles les Grecs<br />
affirmaient, malgré les tensions intérieures endémiques, leur appartenance au même<br />
groupe culturel et leur différence par rapport au monde extérieur peuplé de barbares. En<br />
effet, comme nous l’avons vu, le passage <strong>du</strong> mode chasseur-cueilleur à celui d’agriculteur<br />
entraîne de profonds changements culturels au sein <strong>du</strong> même groupe ethnique; ainsi <strong>la</strong><br />
culture de Cayönü directement issue de <strong>la</strong> culture trialétienne présente <strong>des</strong> traditions<br />
culturelles complètement différentes. Il ne serait pas étonnant de constater que ces<br />
différences ont besoin de chercher une force et une justification <strong>dans</strong> une symbolique<br />
intercommunautaire forte.<br />
75
L’uniformisation de <strong>la</strong> culture de Cayönü <strong>est</strong> non seulement très éten<strong>du</strong>e mais<br />
également profonde. <strong>Le</strong>s outils de Cayönü, les pointes de Byblos, les techniques lithiques<br />
(<strong>la</strong> pression), l’architecture dom<strong>est</strong>ique et somptuaire, les thèmes symboliques et<br />
artistiques montrent que de nombreuses communautés au Proche-Orient, au moins à<br />
partir <strong>du</strong> PPNB moyen, partagent les mêmes affinités culturelles. Il <strong>est</strong> peut-être vrai que<br />
le choix de l’endogamie a permis à ces sociétés de vivre indépendamment. Ce<strong>la</strong><br />
n’empêche pas pour autant qu’un certain dialogue ou un contact soit instauré entre les<br />
différentes communautés, ce qui <strong>est</strong> évident au vu de l’ampleur <strong>des</strong> échanges et de<br />
l’uniformisation culturelle. D’autre part, comme nous l’avons vu, ce phénomène culturel<br />
n’<strong>est</strong> pas originaire d’un seul lieu, mais, ce que j’ai appelé les centres novateurs, évoluent<br />
géographiquement ; en d’autres termes, aucune de ces communautés ne serait assez<br />
puissante pour contrôler politiquement tout ce réseau. Tous ces contacts nécessitent donc<br />
forcément une sorte de consultation intercommunautaire. Göbekli Tepe, au carrefour de<br />
nombreux vil<strong>la</strong>ges PPNB <strong>dans</strong> <strong>la</strong> région d’Urfa (Lidar, Nevali Cori, Gritille, Hayaz, Yeni<br />
Mahalle Mevki, Garoz Tepe), elle-même au centre <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges <strong>du</strong> Moyen-Euphrate et<br />
<strong>des</strong> Hautes Vallées si l’on doit envisager une telle éten<strong>du</strong>e, pourrait jouer ce rôle.<br />
L’effondrement de <strong>la</strong> culture de Cayönü<br />
C’<strong>est</strong> vers 7000 av. J.-C. que les sites <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien commencent à se<br />
dépeupler, et c’<strong>est</strong> curieusement <strong>dans</strong> les siècles qui suivent que vont s’établir les<br />
communautés complexes d’Anatolie centrale et de Mésopotamie (l’Obeid 0 commence<br />
vers 6500 av. J.-C.). L’exode de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, peut-être devenue pastorale mais qui n’<strong>est</strong><br />
sûrement pas revenue à un stade de chasseurs-cueilleurs, vers ces régions voisines peut<br />
aujourd’hui paraître une possibilité. Tout d’abord, pour atteindre l’Europe, le phénomène<br />
néolithique <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien a bien dû se diffuser à travers l’Anatolie centrale et<br />
occidentale. De plus, il <strong>est</strong> difficile de concevoir, par exemple, que l’agriculture, base de<br />
<strong>la</strong> société étatique, ait pu être découverte et mise au point <strong>dans</strong> une région nécessitant en<br />
même temps l’invention et <strong>la</strong> maîtrise de l’irrigation. Il me semble raisonnable de penser<br />
que l’agriculture a d’abord été expérimentée en culture sèche avant d’être exportée <strong>dans</strong><br />
les régions ari<strong>des</strong>.<br />
<strong>Le</strong>s causes de <strong>la</strong> dépopu<strong>la</strong>tion ou de <strong>la</strong> disparition <strong>des</strong> sites de <strong>la</strong> culture de<br />
Cayönü n’ont pas trouvé de raison c<strong>la</strong>ire. La détérioration <strong>du</strong> climat et l’impossibilité<br />
pour <strong>la</strong> région de soutenir une popu<strong>la</strong>tion grandissante, ne sont sans doute pas les causes<br />
principales <strong>du</strong> dépeuplement, même si l’essor <strong>du</strong> nomadisme a accéléré l’érosion <strong>du</strong><br />
76
terrain. Ozdogan (1998 : 335) note que les régions voisines se peuplent au fur et à mesure<br />
que l’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> se dépeuple et que beaucoup de signes culturels semblent<br />
prouver une affiliation certaine. Par exemple, le système symbolique de Catal Höyük <strong>est</strong><br />
à étendre à toutes formes de figurines, félins, rapaces, taureaux (représentant l’élément<br />
féminin) et crânes de taureaux ou bucranes (élément masculin) qui se retrouvent sur de<br />
nombreux sites PPNA et PPNB en Syrie et avec les têtes de vautours de Nemrik (For<strong>est</strong><br />
1993 : 37). Cependant, ces sites montrent un agencement de leur architecture tout à fait<br />
différent. <strong>Le</strong>s sites de Asikli Höyük et de Catal Höyük sont les exemples les plus par<strong>la</strong>nts.<br />
Ces sites sont de type agglutinant (fig) et aucune différenciation de partie ou de quartier<br />
au sein <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge n’<strong>est</strong> visible. Même si une structure spécifique a été trouvée à Asikli,<br />
elle r<strong>est</strong>e accolée au r<strong>est</strong>e <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge et d’accès facile pour tous. Ce<strong>la</strong> montre qu’il n’y a<br />
pas de c<strong>la</strong>sse dirigeante <strong>dans</strong> ces sociétés ou bien elle jouit <strong>des</strong> mêmes droits et <strong>du</strong> même<br />
confort matériel que le r<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. En un mot il s’agit de sociétés égalitaires.<br />
La différence avec Cayönü et Nevali Cori <strong>est</strong> frappante. Ceci prouve notamment que <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tive complexité atteinte <strong>dans</strong> ces sites n’<strong>est</strong> pas naturelle, qu’il s’agit d’un phénomène<br />
assez particulier. Aussi, Ozdogan (1998 : 35) propose judicieusement que <strong>la</strong> raison de ce<br />
dép<strong>la</strong>cement de popu<strong>la</strong>tion, qui garde ses affinités culturelles mais change son système<br />
politique, vient peut-être de tensions sociales survenues <strong>des</strong> différences de condition entre<br />
<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse dirigeante et le r<strong>est</strong>e <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge.<br />
En fait l’étude de l’architecture, de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne et de <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction lithique nous apprend que le phénomène décrit ci-<strong>des</strong>sus prend sans doute ses<br />
origines <strong>dans</strong> <strong>la</strong> transition entre le PPNB récent et final. Il semblerait que le PPNB <strong>du</strong><br />
Taurus oriental soit à diviser sociologiquement en deux gran<strong>des</strong> parties. Il y a d’abord,<br />
une période de formation et de développement d’une société non égalitaire au PPNB<br />
ancien et moyen, ce qui s’accentue au PPNB récent, avec l’apparition de l’agriculture<br />
dom<strong>est</strong>ique (CDA) et <strong>est</strong> ensuite suivie d’une possible r<strong>est</strong>ructuration sociale, au PPNB<br />
final. D’ailleurs, le PPNB final <strong>est</strong> caractérisé en architecture dom<strong>est</strong>ique par <strong>la</strong> phase <strong>des</strong><br />
gran<strong>des</strong> pièces (<strong>la</strong>rge room phase), sans subdivision intérieur, ce qui implique déjà en<br />
soit, une conception plus égalitaire de <strong>la</strong> société. A Cafer Höyük, il semblerait que <strong>la</strong><br />
phase <strong>la</strong>rge room commence après <strong>la</strong> <strong>des</strong>truction par le feu, signe possible de tensions, de<br />
<strong>la</strong> phase <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ns en cellule <strong>du</strong> PPNB moyen (Cauvin et alii 1999 : 95-96). <strong>Le</strong><br />
phénomène que nous venons de décrire entre les sites où le pouvoir <strong>est</strong> centralisé et fort<br />
au vu <strong>des</strong> édifices importants qu’elle pro<strong>du</strong>it semble donc se finir avant <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong><br />
77
Période 3. Une cassure pour revenir à une société plus égalitaire se remarque <strong>dans</strong> cette<br />
région dès le PPNB final. Nevali Cori et Göbekli Tepe sont abandonnés en plein apogée<br />
pour donner naissance au vil<strong>la</strong>ge de Gürcü Tepe. <strong>Le</strong>s imposants édifices publiques et<br />
religieux ne sont pas reconstruits à l’exception d’un édifice à fonction collective mais pas<br />
ostentatoire, aux mesures conformes au r<strong>est</strong>e <strong>des</strong> maisons et de fonction sans doute<br />
utilitaire, seulement reconnaissable aux orthostates le long de ses murs intérieurs<br />
(Schmidt 1995 : 9). Il en <strong>est</strong> de même à Cayönü où <strong>la</strong> <strong>la</strong>rge room phase (PPNB final) <strong>est</strong><br />
<strong>la</strong> seule <strong>du</strong> PPNB à <strong>la</strong>quelle aucun bâtiment spécifique n’<strong>est</strong> associé.<br />
En général, à cette période précise, le nombre de sites imp<strong>la</strong>ntés en Anatolie<br />
comme en Syrie grandit mais avec une popu<strong>la</strong>tion moins importante, <strong>des</strong> instal<strong>la</strong>tions<br />
moins développées (Molist–Stordeur 1999 : 400 ) comme en témoigne parfaitement les<br />
prospections <strong>dans</strong> <strong>la</strong> vallée <strong>du</strong> Balikh où, pour un site PPNB moyen, on en dénombre pas<br />
moins de 24 à <strong>la</strong> période suivante (Akkermans 1999: 524 ). Ce<strong>la</strong> tend à montrer une<br />
moindre centralisation <strong>du</strong> pouvoir, une plus grande démocratisation <strong>du</strong> neolithic way of<br />
life . Tous ces points communs ne sont pas une coïncidence et montrent bien un<br />
changement d’ordre social qu’appuient ainsi les sites d’Anatolie centrale comme Asikli<br />
Höyük. Ceci <strong>est</strong> également montré par l’étude de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion de l’obsidienne que nous<br />
avons déjà établie. Alors qu’au PPNB moyen et récent, seuls les sites <strong>des</strong> Hautes Vallées<br />
présentent une parité entre l’utilisation de l’obsidienne et <strong>du</strong> silex, <strong>la</strong> première <strong>est</strong> peu<br />
présente plus au <strong>sud</strong>, juste suffisamment pour contenter les besoins d’ordre ostentatoire<br />
de ce qu’il convient d’appeler l’élite. Enfin, au PPNB final, l’obsidienne se propage en<br />
<strong>des</strong> quantités telles (32% à Halu<strong>la</strong>, 45 % à Cayönü, Gürcü Tepe) qu’elles permettent de<br />
penser que non seulement <strong>la</strong> civilisation de Cayönü se répand, (jusqu’au Zagros où les<br />
outils de Cayönü deviennent communs) mais aussi que <strong>la</strong> possession d’obsidienne <strong>est</strong><br />
devenue beaucoup plus démocratique, que sa fonction <strong>est</strong> utilitaire et que les échanges<br />
sont plus fréquents et massifs et ne concernent plus l’élite.<br />
78
Tableau de l’évolution chrono-culturelle et sociologique <strong>du</strong>rant <strong>la</strong><br />
néolithisation <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien<br />
Affiliations<br />
culturelles<br />
Type de structures<br />
sociales<br />
sites<br />
<strong>Le</strong>vant<br />
Chasseurs-cueilleurs<br />
Biris<br />
Natoufien : Chass –<br />
Période<br />
1<br />
Trialétien<br />
noma<strong>des</strong> (communisme<br />
primitif ) 3<br />
Mezarligi,<br />
Sögüt Tar<strong>la</strong>si<br />
cueill sédentaires et<br />
stockeurs<br />
Période<br />
2<br />
Trialétien 4<br />
Chass –cueill sédentaires et<br />
stockeurs<br />
Hal<strong>la</strong>n Cemi,<br />
Demirköy,<br />
Cayönü base<br />
Mureybetien :<br />
Transition CDA,<br />
Agric. Pré-dom<strong>est</strong>ique<br />
P. 3 a<br />
PPNB<br />
ancien<br />
Transition :<br />
Influence <strong>du</strong><br />
Mureybétien<br />
Chass – cueill sédentaires<br />
et stockeurs. Transition<br />
vers CDA. Agric. Prédom<strong>est</strong>ique<br />
Cayönü grill,<br />
Cafer<br />
Dja’de<br />
P. 3 b<br />
PPNB<br />
moyen et<br />
récent<br />
Culture de<br />
Cayönü<br />
Communautés<br />
Dom<strong>est</strong>iques Agricoles<br />
Non-égalitaire<br />
Cayönü<br />
channel, cell<br />
Nevali Cori,<br />
Cafer, Göbekli<br />
Culture de Cayönü ( )<br />
P. 3 c<br />
PPNB<br />
final<br />
Culture de<br />
Cayönü<br />
Communautés<br />
Dom<strong>est</strong>iques<br />
Agricoles<br />
égalitaire<br />
Cayönü <strong>la</strong>rge<br />
room,<br />
Gürcütepe,<br />
Gritille,<br />
Hayaz<br />
Culture de Cayönü ( )<br />
3 Il y a une exception à l’extrême fin de <strong>la</strong> Période 1 avec le site d’Hal<strong>la</strong>n Cemi qui a sans doute<br />
une société de type sédentaire et stockeur.<br />
4 Influence <strong>du</strong> Mureybétien sur <strong>la</strong> région d’Urfa.<br />
79
Notes : _ L’appel<strong>la</strong>tion culture de Cayönü pour les sites <strong>du</strong> Moyen-Euphrate<br />
syrien pour le PPNB moyen et récent peut surprendre. Il nous semble cependant, au vu<br />
<strong>des</strong> analyses précédentes, que les éléments culturels qui caractérisent cette période, tels<br />
que <strong>la</strong> pointe de Byblos et d’Amuq ainsi que <strong>la</strong> forte hausse de <strong>la</strong> présence d’obsidienne<br />
anatolienne <strong>dans</strong> ces sites, montrent que c’<strong>est</strong> bien <strong>la</strong> culture <strong>des</strong> Hautes Vallées (de<br />
Cayönü) qui prend un ton décisif quant à l’emprise culturelle régionale, même si,<br />
paradoxalement, les origines de celle-ci se trouvent en Syrie.<br />
_ Nous avons également décelé au cours de notre analyse de <strong>la</strong> dernière<br />
partie <strong>du</strong> PPNB que <strong>la</strong> structure sociale et économique de ces sociétés, sans s’effondrer,<br />
montrait de forts signes de changements, avec une possible disparition de l’élite (que<br />
montrent <strong>la</strong> disparition <strong>des</strong> bâtiments somptuaires et <strong>la</strong> démocratisation <strong>des</strong> matériaux de<br />
valeur comme l’obsidienne). Nous ne saurions ici décrire avec précision à quel type de<br />
structure sociétale nous avons affaire mais il s’agit toujours de communautés dom<strong>est</strong>iques<br />
agricoles sans stratification sociale très marquée : un communisme secondaire (en<br />
opposition avec le communisme primitif <strong>des</strong> chasseurs-cueilleurs noma<strong>des</strong> )<br />
80
VII<br />
-<br />
Conclusion<br />
81
La néolithisation <strong>est</strong> un phénomène très complexe qui <strong>est</strong> <strong>la</strong> transition d’un mode<br />
de société à un autre. <strong>Le</strong>s éléments de cette complexité sont <strong>la</strong> rapidité et <strong>la</strong> densité de<br />
tous les changements occasionnés qui forment un point de non-retour; il s’agit non<br />
seulement de modifications fondamentales <strong>du</strong> mode de vie et de <strong>la</strong> technologie, mais<br />
aussi <strong>du</strong> bouleversement <strong>des</strong> bases culturelles de <strong>la</strong> société. Au Proche-Orient, tout ce<strong>la</strong><br />
s’<strong>est</strong> passé en moins de quatre millénaires, c’<strong>est</strong>-à-dire très rapidement à l’échelle de<br />
l’histoire de l’humanité. Cette intensité, telle qu’elle <strong>est</strong> montrée <strong>dans</strong> l’invention et le<br />
développement de l’architecture, qui <strong>est</strong> r<strong>est</strong>ée d’ailleurs à <strong>la</strong> base de l’architecture<br />
traditionnelle de <strong>la</strong> région jusqu’à nos jours, n’a d’égale que celle pro<strong>du</strong>ite lors de <strong>la</strong><br />
formation de l’Etat ou de <strong>la</strong> révolution in<strong>du</strong>strielle. Ce changement constant <strong>est</strong> en partie<br />
dû à une attitude active de l’homme par rapport à <strong>la</strong> nature qui devient le <strong>la</strong>boratoire de<br />
nombreuses expérimentations, et dont les résultats sont rapidement propagés <strong>dans</strong><br />
l’ensemble <strong>du</strong> Croissant Fertile, ce qui dénote un système efficace d’interaction entre les<br />
différents groupes.<br />
A <strong>la</strong> lumière de tous ces éléments, voici le "modèle" que nous proposons pour <strong>la</strong><br />
néolithisation de l’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> et, de manière plus globale, <strong>du</strong> Proche-Orient:<br />
On peut tout d’abord discerner un mouvement géographique au fil <strong>des</strong> millénaires<br />
qui correspond finalement une phase progressive de mise en p<strong>la</strong>ce <strong>du</strong> phénomène<br />
néolithique. Nous n’entendons pas parler de "diffusion" à proprement parler, car ceci<br />
implique que le processus de néolithisation soit déjà épanoui et qu'il s'exporte tel quel<br />
<strong>dans</strong> les régions périphériques. C'<strong>est</strong> ce qui se passera pour l'Anatolie centrale,<br />
occidentale et ensuite pour l'Europe. Ici, tout le temps que <strong>du</strong>rera cette période, le modèle<br />
néolithique se met en p<strong>la</strong>ce avec ce que ce<strong>la</strong> comporte de temps d’expérimentation,<br />
d'innovations et de découvertes pour parvenir à un fully developped Neolithic stage.<br />
<strong>Le</strong> phénomène néolithique <strong>est</strong> inauguré par une période de sédentarisation et donc<br />
par <strong>la</strong> construction d'habitats fixes qui se sont d'abord installés en masse à <strong>la</strong> Période 1,<br />
surtout au <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> et plus particulièrement entre <strong>la</strong> Galilée et le Mont Carmel<br />
(Mal<strong>la</strong>ha) en Pal<strong>est</strong>ine. Ainsi que le montre l’At<strong>la</strong>s <strong>des</strong> sites <strong>du</strong> Proche-Orient (Hours et<br />
alii 1994), le Liban <strong>sud</strong> possède également de nombreux sites (Jiita, Saaidé, Beyrouth,<br />
Yabroud etc.), bien que cette région se dépeuple drastiquement aux pério<strong>des</strong> suivantes<br />
pour <strong>des</strong> raisons inconnues qui demandent une recherche approfondie (Yazbeck 2001 : 9-<br />
10). En même temps, <strong>dans</strong> le Zagros, un phénomène très comparable se pro<strong>du</strong>it (Zawi<br />
Chemi).<br />
82
Si l’on en croit les travaux ethnographiques dont nous avons parlé, cette<br />
sédentarisation serait le fruit de récoltes céréalières abondantes, de <strong>la</strong> pratique <strong>du</strong><br />
stockage et de <strong>la</strong> maîtrise <strong>des</strong> techniques de conservation <strong>des</strong> denrées. Ces innovations<br />
auraient fait naître les toutes premières inégalités et forment pour nous le premier pas de<br />
<strong>la</strong> néolithisation, dont le <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> et, <strong>dans</strong> une moindre mesure le Zagros, sont les<br />
centres novateurs.<br />
<strong>Le</strong> vide noté au <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> de <strong>la</strong> Turquie au Paléolithique supérieur et au<br />
Mésolithique, bien qu’il soit partiellement comblé à <strong>la</strong> fin de celui-ci, <strong>est</strong> un antécédent<br />
très étonnant à l’apparition si soudaine de sociétés néolithiques aussi sophistiquées aux<br />
pério<strong>des</strong> suivantes. Comme le note justement Ozdogan (1998 : 34 ; 1999b : 226), si une<br />
culture sophistiquée avait vu le jour en Anatolie au Paléolithique supérieur, elle aurait été<br />
découverte aujourd’hui. Un phénomène de dép<strong>la</strong>cement de popu<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> fin <strong>du</strong><br />
Mésolithique vers l’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> <strong>est</strong> donc inéluctable. Plusieurs hypothèses ont été<br />
é<strong>la</strong>borées quant à son origine : le <strong>sud</strong> avec le peuplement natoufien, l’<strong>est</strong> avec le Zagros<br />
et le Caucase, et même le nord de <strong>la</strong> région pontique (Ozdogan 1999b : 227). A <strong>la</strong> lumière<br />
<strong>des</strong> recherches de ces dernières années et <strong>des</strong> sites récemment fouillés tels que Biris<br />
Mezarligi et Hal<strong>la</strong>n Cemi, nous pouvons remarquer que l’in<strong>du</strong>strie lithique montre une<br />
appartenance, ou <strong>du</strong> moins un rapprochement <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions anatoliennes vers les<br />
groupes zarzien et caucasien, avec notamment une influence très marquée <strong>des</strong> sites de <strong>la</strong><br />
Djézireh tels que Nemrik. <strong>Le</strong>s cultures anatoliennes forment cependant une entité propre<br />
appelée trialétienne, caractérisée par leurs microlithes de gran<strong>des</strong> tailles. L’hypothèse de<br />
<strong>la</strong> diffusion levantine, qui a longtemps prévalue quant au peuplement de l’Anatolie, <strong>est</strong> à<br />
écarter. Mais attention, si <strong>la</strong> diffusion de popu<strong>la</strong>tion levantine n’a plus lieu d’être, ou à<br />
<strong>des</strong> effectifs r<strong>est</strong>reints, il en <strong>est</strong> autrement pour une diffusion culturelle, ce que nous<br />
avons démontré pour <strong>la</strong> période suivante.<br />
A <strong>la</strong> Période 2, le phénomène néolithisant s'<strong>est</strong> dép<strong>la</strong>cé <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant <strong>sud</strong> vers le<br />
nord-<strong>est</strong>, <strong>la</strong> région <strong>du</strong> Moyen-Euphrate syrien (Mureybet, Jerf el-Ahmar). Si un tel<br />
mouvement peut être décelé depuis le Zagros vers <strong>la</strong> Djézireh (Qermez Dere, Nemrik) au<br />
nord-ou<strong>est</strong>, l’influence de <strong>la</strong> Djézireh ne se fera désormais plus beaucoup sentir en<br />
Anatolie. Ce dép<strong>la</strong>cement <strong>est</strong> suivi de changements gra<strong>du</strong>els <strong>dans</strong> <strong>la</strong> technologie lithique<br />
fondée de plus en plus sur <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>minaire, <strong>dans</strong> l’invention de l’architecture<br />
rectangu<strong>la</strong>ire, et d’un mode de subsistance marqué par l’adoption de l’agriculture prédom<strong>est</strong>ique.<br />
Ces deux nouvelles régions novatrices, le Moyen-Euphrate syrien et <strong>la</strong><br />
83
Djézireh, ne forment pas nécessairement une même unité culturelle, mais <strong>des</strong> échanges<br />
entre les deux sont bien documentés.<br />
En Anatolie, à cette période, Hal<strong>la</strong>n Cemi, Demirköy, Cayönü, et peut-être<br />
certains sites de <strong>la</strong> région d’Urfa montrent que l’élément caucasien per<strong>du</strong>re sans autre<br />
influence étrangère que l’échange de matières et d’objets précieux qui confirment <strong>la</strong><br />
progression re<strong>la</strong>tive de <strong>la</strong> stratification progressive de <strong>la</strong> société.<br />
La culture <strong>du</strong> Moyen-Euphrate n’<strong>est</strong> plus simplement une société de chasseurscueilleurs<br />
sédentaires, mais le mode de subsistance, <strong>la</strong> complexification de l’organisation<br />
<strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges et l’apparition d’un pouvoir de plus en plus unique et central (voir les<br />
bâtiments communautaires de Jerf el-Ahmar) montrent qu’il s’agit d’une phase de<br />
transition entre <strong>des</strong> chasseurs-cueilleurs stockeurs et <strong>des</strong> sociétés <strong>des</strong> communautés<br />
dom<strong>est</strong>iques agricoles.<br />
Enfin, à <strong>la</strong> Période 3, le mouvement de <strong>la</strong> néolithisation se dép<strong>la</strong>ce vers le nord,<br />
en Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>. Ce sont les peuples locaux qui vont, en l’adoptant, le porter à son<br />
épanouissement final, à un moment où le climat le permettait enfin. <strong>Le</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> anatolien<br />
hérite c<strong>la</strong>irement <strong>des</strong> avancées réalisées par les cultures <strong>du</strong> Mureybétien. Il faut prendre<br />
note qu’il ne s’agit pas d'une diffusion de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion levantine mais d’emprunts faits à<br />
celles-ci par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale, qui garde les traits de sa culture trialétienne locale<br />
même au contact <strong>des</strong> levantins jusque tard <strong>dans</strong> le PPNB, ainsi que le montre par exemple<br />
<strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction lithique à Cafer Höyük. <strong>Le</strong> rôle joué par les popu<strong>la</strong>tions locales <strong>dans</strong> de<br />
telles transformations <strong>est</strong> primordial et ne peut être sous-<strong>est</strong>imé car elles doivent déjà<br />
posséder les infrastructures nécessaires pour être capables d’en adopter de nouvelles<br />
(Renfrew 1975 : 34-5 ; Wattenberg 1998 : 7-9). Ce<strong>la</strong> se conforme aux sites anatoliens<br />
locaux qui connaissaient déjà à <strong>la</strong> Période 2 <strong>des</strong> non egalitarian , complex forms of socio<br />
economic patterns ainsi que le montre l’existence de bâtiments à fonction communautaire<br />
à Hal<strong>la</strong>n Cemi et à Cayönü Base (Ozdogan 1999b : 228).<br />
Ces avancées sont visibles en matière de technologie lithique avec l’adoption<br />
complète de <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>minaire, de l’architecture rectangu<strong>la</strong>ire mis au point sur le<br />
Moyen Euphrate syrien, notamment à Jerf el Ahmar (qui <strong>est</strong> constatée sans doute trop<br />
brutalement à Cayönü, qui passe directement <strong>des</strong> fosses circu<strong>la</strong>ires semi enterrées aux<br />
bâtiments en grill très complexes, pour être une innovation locale, surtout qu’elle <strong>est</strong> déjà<br />
présente à Dja’de à l’époque), et l’adoption <strong>des</strong> bâtiments<br />
spécifiques.<br />
84
Ces emprunts ne seront pas bouleversés <strong>dans</strong> leur concept, mais intensifiés à un<br />
degré important qui ne sera égalé (et <strong>la</strong>rgement dépassé) que plusieurs millénaires plus<br />
tard, lors de l’édification <strong>des</strong> premières sociétés étatiques. Cette intensification <strong>est</strong><br />
parfaitement à l’image <strong>des</strong> observations ethnographiques qui voient <strong>dans</strong> l’adoption de <strong>la</strong><br />
céréaliculture dom<strong>est</strong>ique, non pas un changement radical de <strong>la</strong> société mais une<br />
amplification <strong>des</strong> phénomènes nés <strong>des</strong> sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires et<br />
stockeurs, notamment celui de l’inégalité. C’<strong>est</strong> principalement en ce<strong>la</strong> que <strong>la</strong> fameuse<br />
Révolution Néolithique de Gordon Childe a besoin, au moins à une échelle<br />
macroscopique, de sérieuses révisions.<br />
Cette amplification attribuée, comme nous avons essayé de le montrer, à <strong>la</strong> culture<br />
de Cayönü qui devient à partir <strong>du</strong> PPNB moyen le nouveau centre novateur, <strong>est</strong>, par<br />
exemple, celle de l’adoption <strong>du</strong> BAI c’<strong>est</strong>-à-dire, une pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>minaire plus<br />
importante par <strong>la</strong> taille de ses pro<strong>du</strong>its, aidée par l’invention (locale ou venant <strong>du</strong><br />
Zagros) <strong>du</strong> débitage par pression et <strong>du</strong> nucléus bipo<strong>la</strong>ire naviforme, et remarquable par<br />
sa quantité ainsi que son aire de diffusion. L’uniformité <strong>est</strong> un signe très c<strong>la</strong>ir : <strong>du</strong> nord<br />
<strong>du</strong> Taurus au <strong>sud</strong> <strong>Le</strong>vant les pointes de Byblos et d’Amuq régneront avec une<br />
homogénéité sans égale. Il en va de même pour l’architecture dom<strong>est</strong>ique qui, <strong>dans</strong> son<br />
développement, malgré les changements de p<strong>la</strong>ns au cours <strong>des</strong> siècles et leur grande<br />
complexité, se retrouve chronologiquement de façon uniforme sur tous les sites<br />
anatoliens et au delà. C’<strong>est</strong> cependant l’architecture somptuaire qui recèle les exemples<br />
les plus remarquables de <strong>la</strong> démesure re<strong>la</strong>tive atteinte par cette culture. <strong>Le</strong>s nombreuses<br />
constructions monolithiques (juqu’à 4 mètres de haut) entièrement décorées de bas-reliefs<br />
ne <strong>la</strong>issent plus de doute quant à <strong>la</strong> présence de <strong>la</strong> stratification de <strong>la</strong> société, l’émergence<br />
d’une élite qui contrôle <strong>la</strong> vie spirituelle et économique de <strong>la</strong> communauté (Ozdogan<br />
1999b 228-231). Celle-ci se développe essentiellement grâce à cette dernière<br />
intensification importante : le mode de subsistance <strong>est</strong> maintenant fondé sur une<br />
agriculture entièrement dom<strong>est</strong>ique (qui apparaît <strong>dans</strong> <strong>la</strong> phase <strong>du</strong> p<strong>la</strong>n en cellule de<br />
Cayönü) et sur <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication animale.<br />
Encore une fois, l’apparition de ces c<strong>la</strong>sses, de cette élite, n’atteint pas, et de loin,<br />
ne serait-ce qu’à cause de l’importance de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion impliquée, les sommets de <strong>la</strong><br />
stratification <strong>du</strong> quatrième millénaire mésopotamien. Il n’y a pas <strong>dans</strong> le néolithique<br />
anatolien de formation étatique. On doit cependant reconnaître qu’à cette époque, <strong>la</strong><br />
céréaliculture dom<strong>est</strong>ique a dû créer une surpro<strong>du</strong>ction qui a permis une semie<br />
85
spécialisation d’une partie de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ainsi qu’on le retrouve <strong>dans</strong> l’é<strong>la</strong>boration de<br />
l’architecture, <strong>la</strong> fabrication d’objets précieux, <strong>la</strong> maîtrise de <strong>la</strong> pyrotechnologie<br />
(terrazzo), le commerce à longue distance, l’uniformisation de <strong>la</strong> technologie, de<br />
l’artisanat et <strong>des</strong> armes etc. La possibilité d’un surtravail amène forcément l’exploitation<br />
<strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur par un non pro<strong>du</strong>cteur, qui ici peut prendre une ampleur re<strong>la</strong>tivement<br />
importante : il s’agit de vil<strong>la</strong>ges de plusieurs centaines d’habitants et l’apparente<br />
abondance <strong>des</strong> ressources le montre. « Re<strong>la</strong>tivement » <strong>est</strong> bien le mot car sans pouvoir<br />
nier l’existence d’une élite qui contrôle les structures monumentales et en admettant qu’il<br />
ne s’agit pas là de sociétés étatiques, il <strong>est</strong> bien difficile d’identifier le degré de<br />
complexité auquel nous sommes confronté.<br />
Un autre aspect que nous avons découvert <strong>est</strong> celui <strong>du</strong> changement social qui<br />
semble se perpétrer en Anatolie <strong>du</strong>rant le PPNB récent. Celui-ci pourrait être confon<strong>du</strong><br />
avec l’effondrement de <strong>la</strong> culture de Cayönü, mais il faut bien distinguer les deux<br />
évènements. Il y a d’abord un arrêt brutal de <strong>la</strong> construction de bâtiments monumentaux<br />
ou somptuaires, une démocratisation de l’obtention de l’obsidienne <strong>dans</strong> l’ensemble <strong>du</strong><br />
Proche-Orient ainsi que l’abandon ou le fort rétrécissement de grands sites tels que<br />
Nevali Cori, Göbekli Tepe ou Cayönü. Cependant, ces popu<strong>la</strong>tions ne disparaissent pas et<br />
vont peupler de nouveaux sites perpétuant <strong>la</strong> culture de Cayönü, ainsi que <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion<br />
florissante de l’obsidienne l’illustre. Il <strong>est</strong> difficile de ne pas interpréter ces évènements<br />
comme l’effondrement d’un système social (Ozdogan 1999b : 232) et <strong>des</strong> c<strong>la</strong>sses<br />
dominantes pour donner un nouveau système qu’il n’<strong>est</strong> pas aisé de comprendre. Celui-ci<br />
sera à <strong>la</strong> base <strong>des</strong> sociétés néolithiques d’Anatolie centrale à <strong>la</strong> période suivante et qui ont<br />
un lien culturel indéniable avec les sociétés <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> ainsi que l’iconographie et le<br />
domaine <strong>du</strong> symbolique, visibles à Catal Höyük, le <strong>la</strong>issent entrevoir (For<strong>est</strong> 1993 : 32-3,<br />
37, 40).<br />
Enfin, on voit que le rôle <strong>des</strong> sociétés anatoliennes <strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation <strong>du</strong><br />
Proche-Orient a été celui de l’épanouissement final pour porter ce néolithique à un<br />
summum insoupçonné il y a encore quelques années. Si l’on peut maintenant réfuter<br />
l’idée de néolithisation secondaire de Cauvin concernant <strong>la</strong> néolithisation de l’Anatolie<br />
<strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong>, impliquant que le Moyen-Euphrate avait en quelque sorte inventé le<br />
Néolithique, on ne peut nier, comme nous avons essayé de le démontrer, que <strong>la</strong> culture de<br />
Cayönü a beaucoup emprunté à ses voisines et tout particulièrement au Mureybétien, sans<br />
oublier <strong>la</strong> région <strong>du</strong> Zagros. La néolithisation <strong>est</strong> avant tout un développement temporel,<br />
86
géographique et social. <strong>Le</strong> point de non-retour atteint par ces sociétés n’<strong>est</strong> pas<br />
simplement économique ; les bases de <strong>la</strong> stratification et de l’inégalité sociales sont<br />
jetées ; alors se pose <strong>la</strong> qu<strong>est</strong>ion qui en découle inévitablement : l’Etat mésopotamien<br />
prend-il ses racines à Cayönü <br />
87
Bibliographie<br />
Akkermans P.M.M.G.,<br />
1999 « Pre-Pottery Neolithic B Settlement Patterns Along the Balikh and the<br />
Euphrates – Fact or Fiction” In: Archaeology of the Upper Syrian<br />
Euphrates: the Tishrin Dam Area Proceedings, Olmo <strong>Le</strong>te G.d., Fenollos<br />
M. (eds), editorial AUSA, Barcelona: 523-531.<br />
Anderson P.C.,<br />
2000 La tracéologie comme révé<strong>la</strong>teur <strong>des</strong> débuts de l'agriculture. In : Premiers<br />
paysans <strong>du</strong> monde, Gui<strong>la</strong>ine J. (ed), editions Errance, Paris: 99-119.<br />
Aurenche O., Calley J.,<br />
1988 L’architecture de l’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong> au Néolithique Acéramique,<br />
Anatolica XV : 1-25.<br />
Aurenche O., Kozlowski SK.,<br />
1999 Naissance <strong>du</strong> Néolithique au Proche Orient, Editions Errance, Paris.<br />
2000 Préhistoire récente de <strong>la</strong> Mésopotamie. In : Premiers paysans <strong>du</strong> monde,<br />
Gui<strong>la</strong>ine J. (ed), editions Errance, Paris: 61-80.<br />
Balkan N.,<br />
1989 L’in<strong>du</strong>strie lithique de Boytepe (Turquie), Paléorient 15/1 : 87-90.<br />
Balkan-Atli N.,<br />
1994 La néolithisation de l’Anatolie, De Boccard, Paris.<br />
Balkan-Atli N., Binder D., Cauvin M.C.,<br />
1999 Obsidian: Sources, Workshops and Trade in Central Anatolia. In<br />
Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N. (eds), Arkeoloji ve Sanat<br />
Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul: 133-146.<br />
Bar-Yosef O.,<br />
1981 The 'Pre Pottery Neolithic' Period in the Southern <strong>Le</strong>vant. In<br />
Préhistoire <strong>du</strong> <strong>Le</strong>vant, Editions <strong>du</strong> CNRS, Lyon: 555-568.<br />
1989 The PPNA in the <strong>Le</strong>vant - an Overview, Paléorient 15/1: 57-63.<br />
1992 The Neolithic Period. In Archaeology of Ancient Israel, A. Ben-Tor<br />
(ed.): 10-31.<br />
Benedict P.,<br />
1980 Survey Work in Southeastern Anatolia. In :Prehistoric research in<br />
Southern Anatolia, Cambel H.- Braidwood R.J. (eds), Istanbul Univ.<br />
Edebiyat Fakultesi pub. 2589: 151-191.<br />
Bicakci E.,<br />
1998 An Essay on the Chronology of the Pre-Pottery Neolithic Settlements of<br />
the East<br />
Taurus Region (Turkey). In : Light on top of the B<strong>la</strong>ck Hill,<br />
In Arsebuck G. et alii. (eds) Istanbul, Ege Yayin<strong>la</strong>ri, 257-266.<br />
88
Cauvin, J.,<br />
1989 La stratigraphie de Cafer Höyük <strong>est</strong> (Turquie) et les origines <strong>du</strong> PPNB <strong>du</strong><br />
Taurus, Paléorient 15/1 : 75-90.<br />
1997 Naissance <strong>des</strong> divinités, naissance de l'agriculture, Edition <strong>du</strong> CNRS,<br />
Paris.<br />
Cauvin J., Aurenche O., Cauvin, M.C., Balkan-Atli N.,<br />
1999 The Pre-Pottery Site of Cafer Höyük. In : Neolithic in Turkey,<br />
Ozdögan, M., Basgelen N. (eds), Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul, :<br />
87-104.<br />
Cauvin J., Cauvin M.C., Anderson Gerfaud P., Helmer D.,<br />
1991 <strong>Le</strong>s travaux de 1986-8 sur le site précéramique de Cafer Höyük<br />
(Ma<strong>la</strong>tya-Turquie), De Anatolia Antiqua I: 4-10.<br />
Cauvin M.C.,<br />
1988 L’in<strong>du</strong>strie lithique en Turquie orientale au VIIe millénaire, Anatolica<br />
XV : 25-35.<br />
Coqueugniot E.,<br />
2000 Dja'de (Syrie), un vil<strong>la</strong>ge à <strong>la</strong> veille de <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication (2nde moitié <strong>du</strong><br />
IXe Millénaire av. J-C). In : Premiers paysans <strong>du</strong> monde, Gui<strong>la</strong>ine J. (ed),<br />
Errance, Paris: 61-80.<br />
Esin U., Hamankaya S.,<br />
1999 Asikli. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N. (eds),<br />
Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul: 115-133.<br />
Fagan B.M.,<br />
1994 In the<br />
Beginning, Harper Collins, New York.<br />
For<strong>est</strong> J.-D.,<br />
1996 <strong>Le</strong> PPNB de Cayönü et de Nevali Cori : pour une approche archéoethnologique<br />
de <strong>la</strong> néolithisation <strong>du</strong> Proche-Orient. Anatolia Antiqua IV: 1-31.<br />
1993 Catal Höyük et son décor: pour le déchiffrement d’un code<br />
symbolique, De Anatolica Antiqua II : 1-42.<br />
Gérard F.,<br />
1996 Etude de <strong>la</strong> structure d'un vil<strong>la</strong>ge Néolithique <strong>d'Anatolie</strong>. Mémoire de<br />
DEA, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.<br />
Gopher A.,<br />
1989 Neolithic Arrowheads of the <strong>Le</strong>vant : Results and Implications of a<br />
Seriation Analysis. Paléorient 15:1: 43-56.<br />
89
Hauptmann H.,<br />
1993 Ein Kultgebäude in Nevali Cori. In : Between the Rivers and Above the<br />
Mountains, Frangipane M., Hauptmann H., Liverani M., Matthiae P., Mellink<br />
M. (eds), Universita di Roma, Roma: 37-69.<br />
1999 The Urfa Region. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M.,<br />
Basgelen N. (eds), Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul, : 65-86.<br />
Hemer D., Roitel V., Sana M., Willcox G.,<br />
1998 <strong>Le</strong>s débuts de <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ntes et <strong>des</strong> animaux. In :Espace<br />
habité en Syrie <strong>du</strong> Nord (10ème-2ème millénaires av. J.-C.), Fortin M.,<br />
Aurenche O. (eds), the Canadian Society for Mesopotamian studies,<br />
Toronto: 9-33.<br />
Hillman G.,<br />
1996 Late Pleistocene Changes in Wild P<strong>la</strong>nt Food Avai<strong>la</strong>ble to Hunter-<br />
Gatherer of the Northern Fertile Crescent: Possible Prelu<strong>des</strong> to Cereal<br />
Cultivation. In : The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism<br />
in Eurasia, Harris D.R. (ed), London: 159-203.<br />
Hours F., Aurenche O., Cauvin J., Cauvin M.C., Cope<strong>la</strong>nd L., San<strong>la</strong>ville P.,<br />
1994 At<strong>la</strong>s <strong>des</strong> Sites <strong>du</strong> Proche Orient, de Boccard, Paris.<br />
Jurmain R., Nelson, H., Turnbaugh W.A.<br />
1990 Understanding Physical Anthropology and Archaeology, W<strong>est</strong><br />
Publishing Company, St Paul.<br />
Kozlowski S.K.,<br />
1989 Nemrik 9, a PPN Site in Northern Iraq, Paléorient 15/1: 25-31.<br />
Kozlowski, S. K., Szymczack K.,<br />
1989 Flint In<strong>du</strong>stry from the House 1:1A/1B at the PPN Site in Nemrick 9,<br />
Northern Iraq, Paléorient 15/1: 32-42.<br />
<strong>Le</strong>chevallier M., Philibert D., Ronene A., Samzun A.,<br />
1989 Une occupation khiamienne et sultanienne à Hatou<strong>la</strong> , Paléorient 15/1.<br />
Molist M., Faura J.M.,<br />
1999 Tell Halu<strong>la</strong>: un vil<strong>la</strong>ge <strong>des</strong> premiers agriculteurs-éléveurs <strong>dans</strong> <strong>la</strong> vallée de<br />
l'Euphrate. In : Archaeology of the Upper Syrian Euphrates: the Tishrin<br />
Dam Area Proceedings, Olmo <strong>Le</strong>te G.d., Fenollos M. (eds), editorial<br />
AUSA, Barcelona: 27- 36.<br />
Molist M., Palomo T., Ferrer A.,<br />
1996 The evolution of the Tell Halu<strong>la</strong> (Syria) Chipped Stone In<strong>du</strong>stry During<br />
the 9-8th Millennia bp, Neo-Lithics 1: 5.<br />
Molist, M, Stordeur D.,<br />
1999 <strong>Le</strong> moyen Euphrate syrien et son rôle <strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation, spécificité et<br />
évolution <strong>des</strong> architectures. In : Archaeology of the Upper Syrian<br />
90
Euphrates: the Tishrin Dam Area Proceedings, Olmo <strong>Le</strong>te G.d., Fenollos<br />
M. (eds), editorial AUSA, Barcelona: 395-409.<br />
Moore, A.M.T.,<br />
1982 A Four-Stage Sequence for the <strong>Le</strong>vantine Neolithic, ca 8500-3750 BC,<br />
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 246, : 1-34.<br />
Ozdogan, A.,<br />
1999 Cayönü. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N.(eds),<br />
Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul: 35-63.<br />
Ozdogan, M.,<br />
1995 Neolithization of Europe: a View from Anatolia, Porocilo o raziskovanju<br />
paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji XXII,<br />
Ljubljana: 25-46.<br />
1997 The Beginning of Neolithic Economies in Southeastern Europe: an<br />
Anatolian Perspective, Journal of European Archaeology<br />
5.2: 1-33.<br />
1998 Anatolia from the Late G<strong>la</strong>cial Maximum to the Holocene Climatic<br />
Optimum:<br />
Cultural Formations and the Impact of the<br />
Environmental Setting, Paléorient 23/2: 25-38.<br />
1999a<br />
Preface. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N. (eds),<br />
Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul: 10-12.<br />
1999b Concluding Remarks. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N.<br />
(eds), Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul: 225-236.<br />
Ozdogan, M., Ozdogan A.,<br />
1989 Cayönü, a Conspectus of Recent Work, Paléorient 15/1 : 65-74.<br />
Renfrew, C.,<br />
1975 Trade as Action at a Distance. In : Ancient Civilization and Trade, Sabloff<br />
J. A., Lamberg-Karlovski C.C. (eds), School of American Research,<br />
Albuquerque: 3-59.<br />
Rollefson G.O.,<br />
1989 The Late Aceramic Neolithic of the <strong>Le</strong>vant: a Synthesis, Paléorient 15/1:<br />
168-173.<br />
Roodenberg J.,<br />
1989 Hayaz Höyük and the Final PPNB in the Taurus Foothills, Paléorient 15/1:<br />
91-101.<br />
Rosenberg, M.,<br />
1992 Hal<strong>la</strong>n Cemi excavations: 1991, Kazi Sonuç<strong>la</strong>ri Top<strong>la</strong>ntisi XIV: 117-130.<br />
1993 Hal<strong>la</strong>n Cemi excavations: 1992, Kazi Sonuç<strong>la</strong>ri Top<strong>la</strong>ntisi XV : 123-129.<br />
91
1995 Hal<strong>la</strong>n Cemi excavations: 1994, Kazi Sonuç<strong>la</strong>ri Top<strong>la</strong>ntisi XVII : 9-19.<br />
1999 Hal<strong>la</strong>n Cemi. In : Neolithic in Turkey, Ozdögan, M., Basgelen N. (eds.),<br />
Arkeoloji ve Sanat Yayin<strong>la</strong>ri, Istanbul : 25-34.<br />
Rosenberg M., Nesbitt R., Redding R.W., Peasnall B.L.,<br />
1998 Hal<strong>la</strong>n Cemi, Pig Husbandry, and Post-Pleistocene Adaptations along the<br />
Taurus- Zagros Arc (Turkey). Paléorient 24/1: 25-41.<br />
Rosenberg M., Peasnall B.L.,<br />
1998 A Report on Soundings at Demirköy Höyük: an Aceramic Neolithic Site in<br />
Eastern Anatolia, Anatolica XXIV: 195-209.<br />
Sahlins M.D.,<br />
1976 Âge de pierre, âge d’abondance, Paris : Gallimard.<br />
Schmidt K.,<br />
1988<br />
Cori: Zum Typenspektrum der Silexin<strong>du</strong>strie und der Übringen Kleinfunde,<br />
XV: 161-202.<br />
Nevali<br />
Anatolica<br />
1995 Inv<strong>est</strong>igation in the Upper Mesopotamian Neolithic : Göbekli Tepe and<br />
Gürcü Tepe, Neo-Lithics 2: 9-10.<br />
Sherratt A.,<br />
1997 Climatic Cycles and Behavioural Evolutions : the Emergence of modern<br />
Humans and the Beginning of Farming, Antiquity 71 :272.<br />
Stordeur D.,<br />
1998 Espace naturel, espace construit à Jerf el-Ahmar sur l’Euphrate. In :<br />
Espace habité en Syrie <strong>du</strong> Nord (10è-2è millénaires av. J.-C.), Fortin M.,<br />
Aurenche O. (eds), the Canadian Society for Mesopotamian Studies,<br />
Toronto: 93-107.<br />
2000 Jerf el-Ahmar et l'émergence <strong>du</strong> Néolithique au Proche Orient. In :<br />
Premiers paysans <strong>du</strong> monde, Gui<strong>la</strong>ine J. (ed), Errance, Paris: 33-60.<br />
Stordeur D., Brenet M., Der Aprahamian G., Roux J.-C.<br />
2001 <strong>Le</strong>s bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet horizon<br />
PPNA (Syrie), Paléorient 26/1 : 29-44.<br />
T<strong>est</strong>art A.,<br />
92
1982 <strong>Le</strong>s chasseurs-cueilleurs ou l’origine <strong>des</strong> inégalités, Société<br />
d’ethnographie, Paris.<br />
1985 <strong>Le</strong> communisme primitif, Maison <strong>des</strong> sciences et de l’homme, Paris.<br />
Trigger B.,<br />
1989 A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press,<br />
Cambridge.<br />
Val<strong>la</strong> F. R .,<br />
1988 En guise de synthèse : quelques qu<strong>est</strong>ions posées par l’Epipaléolithique<br />
levantin, Paléorient 14/1 : 316-320.<br />
2000 La sédentarisation au Proche-Orient. In : Premiers paysans <strong>du</strong> monde,<br />
Gui<strong>la</strong>ine J. (ed), Editions Errance, Paris: 13-30.<br />
Van Zeist, Bottema S.,<br />
1991 Late Quaternary Vegetation of the Near East, Reichert: Wiesbaden.<br />
Vigne J.-D.,<br />
2000 <strong>Le</strong>s débuts néolithiques de l’élevage <strong>des</strong> ongulés au Proche Orient et en<br />
Méditerranée. In : Premiers paysans <strong>du</strong> monde, Gui<strong>la</strong>ine J. (ed),<br />
Editions Errance, Paris: 141-168.<br />
Watkins T., Baird D., Betts A.,<br />
1989 Qermez Dere and the Early Aceramic Neolithic of N. Iraq, Paléorient<br />
15/1: 19-24.<br />
Wattenmaker, P.,<br />
1998 Household and State in Upper Mesopotamia, Smithsonian Institution<br />
Press,<br />
Washington.<br />
Willcox G.,<br />
2000 Nouvelles données sur l'origine de <strong>la</strong> dom<strong>est</strong>ication <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ntes au Proche<br />
Orient. In : Premiers paysans <strong>du</strong> monde, Gui<strong>la</strong>ine J. (ed),<br />
Editions Errance, Paris: 123-142.<br />
Yazbeck C.,<br />
2001 <strong>Le</strong> Liban <strong>dans</strong> <strong>la</strong> Préhistoire, bi<strong>la</strong>n <strong>des</strong> acquis et perspectives d’avenir,<br />
Orient- Express 2001/2 : 8-10.<br />
93
Table <strong>des</strong> Matières<br />
<strong>Le</strong> rôle <strong>des</strong> sociétés d’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong><br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation<br />
<strong>du</strong> Proche-Orient<br />
Avant-Propos<br />
I- Intro<strong>du</strong>ction<br />
Sur le problème de représentativité<br />
II- Cadre spatio-temporel<br />
Environnement<br />
Périodisation<br />
III- L'in<strong>du</strong>strie lithique<br />
I- Typologie<br />
A- <strong>Le</strong> <strong>Le</strong>vant<br />
B- <strong>Le</strong> Zagros<br />
C- <strong>Le</strong>s Hautes Vallées<br />
II- Période 1 et 2<br />
A- <strong>Le</strong> <strong>Le</strong>vant<br />
B- <strong>Le</strong> Zagros<br />
C- <strong>Le</strong>s Hautes Vallées<br />
D- <strong>Le</strong>s échanges interrégionaux<br />
III- Période 3<br />
A- <strong>Le</strong> <strong>Le</strong>vant<br />
B- <strong>Le</strong> Zagros<br />
C- <strong>Le</strong>s Hautes Vallées<br />
D- <strong>Le</strong> échanges interrégionaux<br />
E- Synthèse<br />
IV- Conclusion<br />
IV- L'architecture<br />
I- Période 1<br />
II- Période 2<br />
A-<strong>Le</strong> Proche-Orient<br />
B- <strong>la</strong> Djézireh<br />
C- l'Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong><br />
III- Période 3<br />
A- <strong>Le</strong> Proche-Orient<br />
94
B- l'Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong><br />
IV- les Bâtiments somptuaires<br />
V- Synthèse générale<br />
V- Mode de subsistance<br />
I- L’agriculture pré-dom<strong>est</strong>ique<br />
II- <strong>Le</strong>s origines de l’apparition de l’agriculture<br />
III- L'agriculture dom<strong>est</strong>ique<br />
IV- Données ethnologiques et répercussions sociologiques<br />
V- <strong>Le</strong> cas de l’élevage<br />
VI- Synthèse<br />
VI- Structures sociales et affiliations culturelles<br />
I- Période 1<br />
II- Période 2<br />
III- Période 3<br />
IV- L’effondrement de <strong>la</strong> culture de Cayönü<br />
VII- Conclusion<br />
Bibliographie<br />
Volume II : Index <strong>des</strong> figures<br />
95
UNIVERSITE DE PARIS I – PANTHEON SORBONNE<br />
Mémoire en vue de l’obtention <strong>du</strong> D.E.A.<br />
d’archéologie <strong>du</strong> Proche-Orient<br />
<strong>Le</strong> rôle<br />
<strong>des</strong> sociétés<br />
d’Anatolie <strong>du</strong> <strong>sud</strong>-<strong>est</strong><br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> néolithisation <strong>du</strong> Proche-Orient<br />
Volume II : Figures<br />
Par Cédric Bodet<br />
Sous <strong>la</strong> direction <strong>du</strong> professeur Jean-Daniel For<strong>est</strong>.<br />
Juin 2001<br />
96
100
101