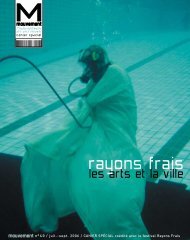La scène suisse dans tous ses éclats - Mouvement
La scène suisse dans tous ses éclats - Mouvement
La scène suisse dans tous ses éclats - Mouvement
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Aux limitesdu fédéralisme/ Anne-Catherine Sutermeister<strong>La</strong> politique culturelle <strong>suisse</strong> repose surune accumulation de strates – communales,cantonales et fédérale – auxquelles s'ajoutentdes fonds semi-publics (comme les loteries)et privés. L'entrée en vigueur de la premièreloi fédérale sur la culture amène son lotd'interrogations.S'il existe une notion à laquelle l'on ne peut échapper, si l'on souhaitecomprendre ne serait-ce que superficiellement le fonctionnement despolitiques culturelles <strong>suisse</strong>s, c'est bien la subsidiarité.Magnifique outil de déresponsabilisation pour certains, la subsidiarité est,<strong>dans</strong> les états fédéraux, un outil d'organisation et de répartitions destâches politiques : partant du principe que la responsabilité des actionspolitiques échoit à l'échelon le plus adapté, la subsidiarité s'organise demanière ascendante en Suisse. Ainsi la culture est d'abord du ressort desvilles, puis des cantons, la Confédération n'intervenant qu'ensuite à titresubsidiaire. Les chiffres témoignent bien de ces champs de force : 48 %des subventions culturelles proviennent des villes (dont pratiquement lamoitié des villes de Genève, <strong>La</strong>usanne, Berne et Zurich), et 41 % sontattribués par les cantons, tandis que la Confédération ne participe qu'àhauteur de 11 % (265,2 millions de francs <strong>suisse</strong>s, soit 219,3 millionsd'euros). Quant aux montants provenant du secteur privé, ilsreprésentent environ 320 millions de francs <strong>suisse</strong>s par an(264,6 millions d'euros), en tenant compte d'un partenaire semi-privédéterminant en Suisse : les loteries.Les chiffres, s'ils reflètent les responsabilités financières assurées par lesdifférentes collectivités, ne peuvent rendre compte des mécanismessouvent complexes en fonction desquels s'organisent les responsabilitésentre les 26 cantons <strong>suisse</strong>s et les communes situées sur leur territoire.En effet, un même projet peut-être soutenu par les trois échelonspolitiques au terme d'un savant jeu de concertation déterminé par unautre principe éminemment helvétique, la souveraineté que revendiquechaque échelon politique. <strong>La</strong> multiplication des guichets cantonaux etcommunaux complique de toute évidence les cho<strong>ses</strong>. Alors que certainscantons comme Fribourg se sont clairement approprié un champ decompétence – en l'occurrence le soutien à la création –, laissant ladiffusion des activités culturelles aux collectivités communales, d'autrescantons souhaitent aujourd'hui énoncer de véritables politiques globales,comme en témoignent les nouveaux projets de lois <strong>dans</strong> les cantons deVaud et de Genève. Au sacro-saint principe de subsidiarité succèdedonc progressivement l'idée d'une répartition des tâches entre cantonset villes. Ainsi la boutade longtemps de mise selon laquelle « il y a enSuisse autant de politiques culturelles que de communes et de cantons » esten train d'évoluer, au rythme paisible des pendules à coucouhelvétiques. L'entrée en vigueur de la première loi fédérale surl'encouragement à la culture le 1 er janvier 2012 apporte une nouvellepierre à l'édifice. Elle confère enfin une légitimité à l'action de laConfédération, fixe <strong>ses</strong> compétences par rapport aux cantons et auxcommunes et définit selon des plans quadriennaux les lignes directricesen matière de politique culturelle.Les prémices timides de la politique culturelle <strong>suisse</strong>Si des résolutions ont été pri<strong>ses</strong> dès le XIX e siècle par les villes, lescantons et la Confédération pour soutenir le patrimoine culturel(création d'archives, bibliothèques, musées), on peut situer les prémicesd'une action politique <strong>dans</strong> le domaine de la culture en 1939, avec lafondation de la communauté de travail Pro Helvetia. Incarnant uneéphémère unité nationale <strong>dans</strong> le contexte de la Seconde Guerremondiale, Pro Helvetia n'est pas à <strong>ses</strong> débuts le fruit d'une politiquedélibérée mais bien l'expression d'une réaction visant à défendre les« valeurs spirituelles de la Suisse ».<strong>La</strong> subsidiaritéprécarise davantagequ'elle ne rassure.Le développement à partir de 1945 d'une culture professionnelle propre– et non plus importée de France ou d'Allemagne, comme c'était le casauparavant – amène les collectivités communales à lancer les premiersinstruments de soutien à la création. Les premières lois cantonalesconsacrées à l'encouragement de la culture entrent en vigueur dès lesannées 1970 et des unités administratives spécialisées sont créées pourrépondre aux sollicitations des artistes et des institutions. C'est aussi aucours de ces années que la Confédération publie le fameux RapportClottu (1975), qui analyse de manière très fouillée la vie culturelle etartistique en Suisse, identifie les besoins et propose une réflexionambitieuse sur le rôle des collectivités publiques. <strong>La</strong>rgement influencépar les réflexions sur la démocratisation culturelle en France, le rapportmet aussi en lumière les faibles<strong>ses</strong> du système fédéraliste : aucunepolitique culturelle ne pourra émerger sans une vision concertée entreles différents échelons fédéraux.Les paradoxes du fédéralismeUne trentaine d'années plus tard, les dynamiques de la vie culturelle etscène <strong>suisse</strong> / 2