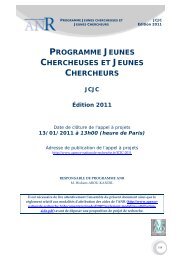Bulletin num. 19 du 16-12-2009 - Institut des Amériques
Bulletin num. 19 du 16-12-2009 - Institut des Amériques
Bulletin num. 19 du 16-12-2009 - Institut des Amériques
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TransaméricainesPage 64 of 71- Survol <strong>des</strong> recherches qui se sont effectuées sur ces différents domaines et résultats deces recherches- Bilan <strong>des</strong> savoirs autochtones mobilisés pour ces revendications- Un contrepoint sur ces problématiques en Bretagne permettra de ne pas essentialiser laquestion autochtone et de donner une ouverture théorique supplémentaire auxdoctorants travaillant sur <strong>des</strong> thèmes bretons, celtiques ou autochtonesDescription complète <strong>du</strong> projet :La question de la dynamique <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> Autochtones est importante alors que l’onassiste au renouveau de la lutte indienne (Le Bot <strong>2009</strong>) depuis une vingtaine d’années etsurtout à son succès, qu’il s’agira d’évaluer. Cette lutte a permis l’obtention nonseulement de nouveaux droits mais aussi, dans certains pays, de la négociation d’unenouvelle place <strong>des</strong> Autochtones dans la Nation avec la reconnaissance souvent explicite<strong>du</strong> multiculturalisme. Les Autochtones ont réussi à porter leurs préoccupations et leursrevendications pour la préservation de leurs territoires devant les instancesinternationales À quelques exceptions près, les États nations <strong>du</strong> monde ont ratifiéquelques instruments internationaux les concernant, que ce soit la Convention relativeaux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (Convention <strong>16</strong>9 de l’OIT,<strong>19</strong>89) et, plus récemment, la Déclaration <strong>des</strong> Nations Unies sur les droits <strong>des</strong> peuplesautochtones (2007). Une <strong>des</strong> raisons de leur réussit! e a été la transnationalisation deleurs mouvements, c’est-à-dire leur intégration dans l’espace <strong>des</strong> <strong>Amériques</strong>.Pourtant, dans la majorité <strong>des</strong> cas, les peuples autochtones sont marginalisés par lesÉtats-nations. Quelquefois même, ils sont considérés comme <strong>des</strong> entraves à l’entreprisede développement néolibéral dont les promoteurs sont désireux de s’approprier lesressources naturelles qui se trouvent sur les territoires revendiqués. En ce sens,plusieurs peuples autochtones sont maintenant surreprésentés parmi les populationsdéplacées par la violence et l’injustice. Indépendamment de ce phénomène, les donnéesdémographiques, économiques, sociales et autres sur les Autochtones témoignent deconditions de vie difficiles et ce, même lorsqu’ils se retrouvent au sein de paysdéveloppés comme c’est le cas au Canada.Pour comprendre comment s’est jouée la dynamique <strong>des</strong> revendications et <strong>des</strong> droits ilfaut arriver à se défaire <strong>du</strong> regard ethnocentriste et favoriser les échanges entrechercheurs et Autochtones autour de la question <strong>des</strong> savoirs et de leur circulation dans lemonde d’aujourd’hui. Avec la mondialisation, si l’on tient compte <strong>du</strong> rétrécissement del’espace et de la compression <strong>du</strong> temps, les savoirs hégémoniques semblent avoirconsolidé leur emprise sur le monde d’aujourd’hui. Pourtant, les peuples autochtones ontpu profiter <strong>des</strong> différents canaux mis en place par ces savoirs hégémoniques pour porterleurs revendications pour la préservation de leur culture et le respect de leurs droits surla scène internationale. Il y a là un paradoxe extraordinaire – c’est ce que nousdésignons par le terme « exemplarité » - qu’il sera intéressant d’examiner. Ce que cetteécole propose, c’est de l’examiner en tant que chercheurs mais dans le cadre d’undialogue avec <strong>des</strong> Autochtones, qu’ils soi! ent chercheurs ou non.Plus précisément, il s’agira d’examiner la spécificité de la mobilisation <strong>des</strong> savoirs et <strong>des</strong>pratiques autochtones en matière de revendications culturelles et de justice sociale. Cesrevendications touchent <strong>des</strong> domaines aussi variés que le territoire et les questionsenvironnementales, les politiques publiques en matière de développement social etéconomique, la justice sociale, la condition <strong>des</strong> femmes, les migrations, et enfinl’autonomie gouvernementale et la revalorisation culturelle. Il importe de se questionnersur les façons spécifiques, inédites et originales dont les savoirs autochtones ont étémobilisés dans ces revendications et de débattre <strong>des</strong> façons dont ces démarches peuventêtre valorisées dans d’autres domaines et par d’autres populations.Le questionnement est loin d’être banal car malgré <strong>des</strong> acquis remarquables de la part<strong>des</strong> peuples autochtones avec la Convention <strong>16</strong>9 de même qu’avec la Déclaration <strong>des</strong>Nations Unies sur les droits <strong>des</strong> peuples autochtones, il est clair que leurs savoirs ontsouvent été instrumentalisés et le sont encore. Ils sont toujours considérés comme <strong>des</strong> «<strong>16</strong>/<strong>12</strong>/<strong>2009</strong>