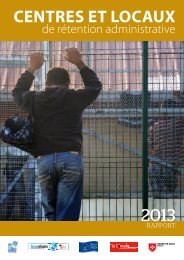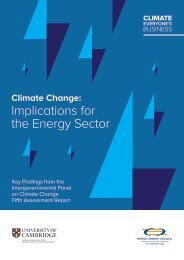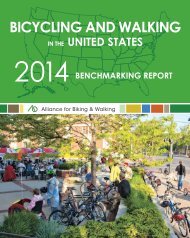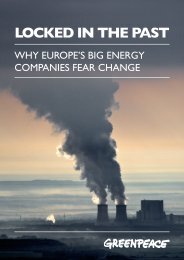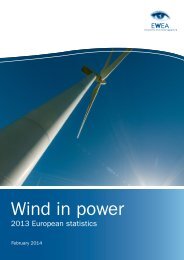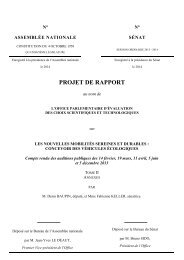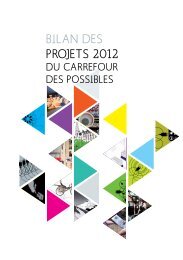RAPPORT
iR3VBh
iR3VBh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Droit à l’eau et industries extractives : la responsabilité des multinationales<br />
Le droit à l’eau, une arme pour les résistances<br />
et les alternatives ?<br />
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution consacrant la<br />
reconnaissance du droit à l’eau parmi les droits humains fondamentaux. Dans quelle mesure cette<br />
notion juridique de « droit humain à l’eau » peut-elle être mise à profit par les communautés, les<br />
collectifs citoyens et les organisations non gouvernementales qui s’opposent aux projets extractifs,<br />
ou du moins s’efforcent de contraindre les entreprises et les gouvernements qui les portent<br />
à atténuer leurs impacts et procéder aux réparations nécessaires ?<br />
UNE NOTION EN CONSTRUCTION<br />
La consécration internationale du droit à l’eau est donc relativement<br />
récente. Si quelques pays ont expressément reconnu ce<br />
droit dans leur constitution, très peu lui ont à ce jour donné une<br />
traduction juridique opérationnelle, qui permette aux communautés<br />
de donner effet à ce droit, et encore moins de l’opposer à<br />
de nouveaux projets de mines ou d’extraction d’hydrocarbures.<br />
Par ailleurs, la référence explicite au droit à l’eau reste l’apanage de<br />
certaines régions du monde – principalement l’Amérique latine et<br />
l’Europe. Sur le vieux continent, la référence au droit à l’eau s’inscrit<br />
le plus souvent dans une problématique spécifique, qui est celle<br />
de la résistance à la privatisation ou à la marchandisation de l’eau<br />
(cf. l’initiative citoyenne européenne Right2Water ou le mouvement<br />
« Right to Water » en Irlande contre la transformation du service<br />
national de l’eau en société anonyme). C’est surtout en Amérique<br />
latine que la notion de droit à l’eau est mise en avant dans le cadre<br />
de la résistance à l’extractivisme.<br />
Non sans une certaine ironie, les pays qui ont été les premiers<br />
à inscrire le droit à l’eau dans leur constitution – notamment<br />
en Amérique latine – ont ensuite adopté des législations qui<br />
paraissent aller dans le sens exactement contraire. Au Mexique,<br />
après que le droit à l’eau a été inscrit dans la constitution en<br />
2012, la nouvelle loi sur l’eau proposée récemment par le gouvernement<br />
– pourtant censée donner effet à cette modification<br />
constitutionnelle - paraît répondre à un objectif exactement inverse,<br />
puisqu’elle favorise la gestion privée des services de l’eau<br />
et l’implantation de barrages hydroélectriques, de mines ou de<br />
sites de gaz de schiste 1 . Un projet de loi alternatif a été élaboré<br />
par la société civile mexicaine qui « reconnaît l’eau comme un<br />
bien commun de la Nation, provenant de la Nature et devant<br />
être géré sans fins lucratives », s’oppose à la multiplication des<br />
1 Marie-Pia Rieublanc, « Le Mexique va-t-il se vider de son eau au profit<br />
des multinationales ? », réf. citée.<br />
barrages, prévoit de démonter le système de concessions « qui<br />
a mené à la privatisation, l’accaparement et la surexploitation de<br />
l’eau » et d’interdire « l’usage des eaux nationales pour l’industrie<br />
minière toxique et pour le fracking ».<br />
De même en Équateur : dès 2008, la nouvelle constitution du<br />
pays consacrait le droit humain à l’eau et plus largement les<br />
droits de la nature. Mais la nouvelle loi sur l’eau adoptée par<br />
les mêmes dirigeants politiques en 2014 a suscité un vaste<br />
mouvement de révolte, notamment de la part des populations<br />
indigènes, qui y ont vu une tentative de favoriser la privatisation<br />
de l’eau et le développement de nouveaux projets extractifs.<br />
De fait, si cette nouvelle loi interdit d’un côté toute forme de<br />
privatisation de l’eau, elle autorise de l’autre l’intervention du<br />
secteur privé en cas de circonstances « exceptionnelles » et<br />
surtout donne au gouvernement central tout pouvoir sur les<br />
ressources en eau, au détriment des communautés locales.<br />
De même, au Pérou, le futur président Ollanta Humala avait<br />
fait campagne en 2011 sous le slogan « De l’eau avant l’or », en<br />
référence aux grands projets miniers comme celui de Conga,<br />
mais il a fini par faire adopter des législations favorisant les<br />
projets extractivistes et limitant drastiquement le droit de regard<br />
des communautés et des autorités environnementales 2 .<br />
LE BESOIN D’UNE CONCEPTION ÉLARGIE DU DROIT À L’EAU<br />
Face à l’ampleur et à la variété des impacts des industries extractives<br />
sur les ressources en eau, mettre l’accent sur le seul problème<br />
de l’accès à l’eau potable pour la consommation humaine directe<br />
ne suffit pas. Dans de nombreux cas, des mines ou des sites<br />
2 Simon Gouin, « Conga : quand l’or du Pérou attire de nouveaux<br />
conquistadors », 9 septembre 2013, réf. citée ; Manuela Picq, « Conflict<br />
over water rights in Ecuador », Aljazeera, 16 juillet 2014, http://www.<br />
aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/conflict-water-rights-ecuador-201471364437985380.html<br />
19