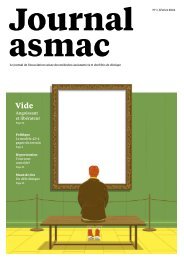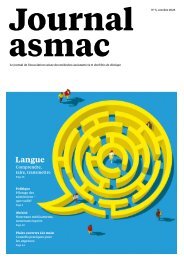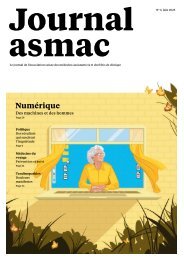Journal asmac No 4 - août 2022
Traces - A propos de loupes et télescopes Politique - Où va l’argent destiné à la formation postgraduée? Oncologie - Les tumeurs germinales chez l’homme Infectiologie - Pathologie de maladies infectieuses
Traces - A propos de loupes et télescopes
Politique - Où va l’argent destiné à la formation postgraduée?
Oncologie - Les tumeurs germinales chez l’homme
Infectiologie - Pathologie de maladies infectieuses
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Journal</strong><br />
N o 4, <strong>août</strong> <strong>2022</strong><br />
<strong>asmac</strong><br />
Le journal de l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique<br />
Traces<br />
A propos de loupes<br />
et télescopes<br />
Page 20<br />
Politique<br />
Où va l’argent destiné à la<br />
formation postgraduée?<br />
Page 6<br />
Oncologie<br />
Les tumeurs germinales<br />
chez l’homme<br />
Page 30<br />
Infectiologie<br />
Pathologie de maladies<br />
infectieuses<br />
Page 35
Anzeigen<br />
Médecine<br />
Interne Générale<br />
Update Refresher<br />
09. – 12.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
32 h<br />
Médecine Interne<br />
Update Refresher<br />
06. – 10.12.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
39 h<br />
Médecin de famille<br />
Journées de<br />
formation continue<br />
29. – 30.09.<strong>2022</strong> Montreux<br />
14 h<br />
Gynécologie<br />
Update Refresher<br />
09. – 10.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
16 crédits SSGO<br />
Pédiatrie<br />
Update Refresher<br />
16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
21 h<br />
Psychiatrie et<br />
Psychothérapie<br />
Update Refresher<br />
16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
23 h<br />
Information / Inscription<br />
tél. 041 567 29 80 | info@fomf.ch<br />
www.fomf.ch<br />
Présence sur place ou participation via Livestream<br />
CONCOURS<br />
Grâce au partenariat entre mediservice vsao-<strong>asmac</strong> et SWICA, vous bénéficiez<br />
d’avantages pour tout ce qui a trait à votre santé. Participez en plus au concours gourmet:<br />
SWICA met en jeu 20 x 2 bons de la Guilde d’une valeur de 200 francs chacun.<br />
Participez maintenant en ligne sur swica.ch/mediservice-gilde<br />
ou en scannant le code QR.<br />
En partenariat avec:
Sommaire<br />
Traces<br />
A propos de loupes et télescopes<br />
Illustration de la page<br />
de couverture: Stephan Schmitz<br />
Editorial<br />
5 A la loupe et au télescope<br />
Politique<br />
6 Un monstre de 50 lettres<br />
9 L’essentiel en bref<br />
Formation postgraduée/<br />
Conditions de travail<br />
10 Une Rose pour la bonne planification<br />
des services<br />
12 Constructif, agréable, intense<br />
<strong>asmac</strong><br />
14 <strong>No</strong>uvelles des sections<br />
16 <strong>asmac</strong>-Inside<br />
18 Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />
Point de mire: Traces<br />
20 A la recherche de la vie dans l’univers<br />
22 Traces d’animaux<br />
24 Le langage du sang<br />
28 En quête de nos ancêtres<br />
Perspectives<br />
30 Actualités en oncologie:<br />
Les tumeurs germinales chez l’homme<br />
Stratégies thérapeutiques actuelles<br />
35 Aus der «Therapeutischen Umschau» –<br />
Übersichtsarbeit: Pathologie von<br />
Infektionskrankheiten<br />
41 Mission en Haïti<br />
mediservice<br />
42 Boîtes aux lettres<br />
44 Sept étapes pour accéder à la propriété<br />
du logement<br />
46 Que proposent les portails en ligne<br />
et applications?<br />
48 La cuisine saine et savoureuse<br />
Recettes rafraîchissantes pour les<br />
beaux jours<br />
50 Impressum<br />
Annonce<br />
Geborgenheit<br />
CH-3860 Meiringen<br />
Telefon +41 33 972 81 11<br />
www.privatklinik-meiringen.ch<br />
Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />
Ärztliche Leitung:<br />
Prof. Dr. med. Thomas J. Müller<br />
Wo Patienten auch Gäste sind.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 3
Annonces<br />
Engagement, motivation,<br />
compétence<br />
Voila ce qui définit le Service Croix-Rouge.<br />
Vous aussi, vous souhaitez faire bénéficier le Service<br />
Croix-Rouge de vos compétences techniques et de votre<br />
sens de l’engagement?<br />
Pour plus d’informations:<br />
Service Croix-Rouge, 058 400 41 70<br />
info@rkd-scr.ch, www.rkd-scr.ch<br />
<strong>No</strong>us pouvons proposer de bons services aux médecins, parce que nous les comprenons bien.<br />
En tant que membre de mediservice <strong>asmac</strong>, vous appartenez à un groupe privilégié: vous avez<br />
un accès exclusif à un portail de l’emploi en ligne et sur un agenda en ligne avec des offres de<br />
séminaires. En tant que médecin en formation, vous avez par ailleurs la possibilité de participer<br />
à des congrès de carrière de très haut niveau. www.mediservice-<strong>asmac</strong>.ch<br />
· Neue Station für internistische<br />
und onkologische Rehabilitation<br />
CH-6083 Hasliberg Hohfluh<br />
Telefon +41 33 972 55 55<br />
www.rehaklinik-hasliberg.ch<br />
Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />
Chefarzt:<br />
Dr. med. Salih Muminagic, MBA<br />
Wo Patienten auch Gäste sind.
Editorial<br />
A la loupe et<br />
au télescope<br />
Catherine Aeschbacher<br />
Rédactrice en chef<br />
du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong><br />
Lorsque deux corps entrent en contact l’un avec l’autre, il y a<br />
nécessairement un transfert entre ceux-ci. Ainsi se résume le<br />
principe d’échange de Locard. Le juriste et médecin français<br />
Edmond Locard a formulé l’un des principes les plus importants<br />
de la criminalistique. Chaque individu laisse en permanence des<br />
traces. Il suffit de les déceler. A l’époque, Sherlock Holmes et ses collègues<br />
du monde réel se contentaient encore d’une loupe. Aujourd’hui,<br />
les experts en criminalistique disposent de nombreux outils pour<br />
déceler et conserver les traces biologiques, mais aussi les fibres et les<br />
matériaux inorganiques. Dans notre Point de mire, une experte des<br />
traces de sang décrit son travail.<br />
Pour détecter d’autres objets, il faut des moyens tout à fait différents.<br />
En 2019, les deux physiciens genevois Michel Mayor et Didier Queloz<br />
ont reçu le prix <strong>No</strong>bel pour la découverte de la première exoplanète<br />
en 1995. Jusque-là, l’existence de planètes en dehors de notre système<br />
solaire relevait de la pure spéculation et était réservée aux romans de<br />
science-fiction ou à d’autres réflexions philosophiques. Avec la découverte<br />
de la première exoplanète, l’hypothèse selon laquelle il pourrait<br />
y avoir de la vie en dehors de notre système solaire est devenue nettement<br />
plus vraisemblable. La recherche de traces dans l’astronomie<br />
a donc pris une nouvelle orientation comme le montre notre article.<br />
Nul besoin de loupe ou de télescope, ni nécessairement de lieu du<br />
crime ou de laboratoire. Pourtant, sans persévérance et planification,<br />
ça ne marche jamais. Celui qui souhaite par exemple savoir combien<br />
de frères et sœurs ses deux arrière-grands-mères paternelles avaient,<br />
et ce que ceux-ci sont devenus, peut lancer sa recherche personnelle.<br />
Dans notre Point de mire, une généalogiste professionnelle explique<br />
comment elle procède pour établir un arbre généalogique et donne<br />
des conseils pour une expérimentation personnelle.<br />
L’été est la saison des roses, aussi pour l’<strong>asmac</strong>. En juillet, la Rose<br />
d’hôpital a été remise à l’Hôpital cantonal de Lucerne lors d’une cérémonie<br />
solennelle. L’<strong>asmac</strong> récompense ainsi le l’Hôpital cantonal de<br />
Lucerne pour ses efforts dans le domaine de la planification des services.<br />
Vous découvrirez à la rubrique «Formation postgraduée/Conditions<br />
de travail» quels autres efforts sont entrepris à Lucerne pour<br />
rester un employeur attractif.<br />
Elle s’appelle Convention sur le financement de la formation postgrade<br />
(CFFP). Son entrée en vigueur est prévue en 2023. En ratifiant cette<br />
convention, les cantons s’engagent à soutenir la formation postgraduée<br />
avec une contribution minimale de 15 000 francs par tête et par<br />
année. Il s’agit maintenant de contrôler à quoi ces fonds sont destinés<br />
et si les établissements de formation postgraduée proposent effectivement<br />
la formation postgraduée convenue. Vous trouverez plus de<br />
détails à ce sujet à la rubrique Politique. Avec cet article, Marcel Marti,<br />
responsable politique et communication, prend congé de l’<strong>asmac</strong><br />
pour se consacrer à un nouveau défi. La rédaction du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong><br />
remercie Marcel Marti pour son engagement exceptionnel.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 5
Politique<br />
Un monstre de<br />
50 lettres<br />
La Convention sur le financement de la formation postgrade (CFFP)<br />
a pour but de promouvoir la formation médicale postgraduée. Après plus de<br />
sept ans, un nombre suffisant de cantons l’ont maintenant ratifiée<br />
pour qu’elle entre en vigueur. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement?<br />
Marcel Marti, responsable politique et communication / directeur adjoint de l’<strong>asmac</strong> (jusqu’ à juillet <strong>2022</strong>)<br />
Pour certains, la Convention sur le financement de la formation postgrade représentera déjà un défi linguistique. Pour tous, c’est la mise en œuvre<br />
qui en est un, afin que le soutien financier bénéficie effectivement à la formation médicale postgraduée.<br />
Tout a commencé avec l’intention<br />
de la Confédération et des<br />
cantons de garantir la formation<br />
médicale postgraduée,<br />
également sous le régime du nouveau financement<br />
hospitalier (modèle des forfaits<br />
par cas DRG, en vigueur depuis le<br />
1 er janvier 2012). Pour ce faire, on a développé,<br />
dans le cadre du dialogue «Politique<br />
nationale de la santé», le modèle<br />
PEP (pragmatique, simple, forfaitaire). Il a<br />
vu le jour dans un groupe thématique de<br />
la plate-forme «Avenir de la formation<br />
médicale» de l’Office fédéral de la santé<br />
publique (OFSP) à laquelle nous avons<br />
participé. L’idée du modèle est d’obliger<br />
tous les hôpitaux et cliniques figurant sur<br />
la liste des hôpitaux de former des médecins-assistant(e)s<br />
selon leurs possibilités.<br />
Le nombre exact de postes de formation<br />
postgraduée fait partie des conventions<br />
de prestations avec les cantons.<br />
Un forfait par tête et par année<br />
Le modèle «PEP» prévoit que les cantons<br />
soutiennent la formation postgraduée par<br />
le versement d’un montant forfaitaire annuel<br />
de 15 000 francs par tête. Le versement<br />
dépend toutefois du respect de certains<br />
critères de qualité. De plus, il s’agit<br />
de compenser les différences entre les<br />
cantons. «Pour une raison toute simple»,<br />
explique Patrizia Kündig, responsable du<br />
ressort formation postgraduée de l’<strong>asmac</strong>:<br />
Photo: <strong>asmac</strong><br />
6<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Politique<br />
«La situation à Zurich avec un nombre important<br />
d’hôpitaux de grande taille est totalement<br />
différente de celle que l’on trouve<br />
par exemple en Suisse centrale.»<br />
La Conférence suisse des directrices et<br />
directeurs cantonaux de la santé (CDS) a<br />
adopté en novembre 2014 une convention<br />
à cet effet: la Convention sur le financement<br />
de la formation médicale postgrade<br />
(CFFP). Ce faisant, la CDS a souligné que la<br />
prise en charge médicale de la population<br />
par un nombre suffisant de médecins spécialistes<br />
devait être garantie à long terme.<br />
La Confédération, les cantons et les universités<br />
devant par conséquent davantage<br />
s’engager dans la formation postgraduée.<br />
Enfin 18!<br />
Voilà pour ce qui concerne la théorie et les<br />
nobles intentions. Dans la pratique, ce<br />
sont ensuite les procédures de ratification<br />
cantonales de longue haleine qui ont suivi.<br />
Ce n’est finalement qu’il y a six mois que le<br />
quorum nécessaire de 18 cantons a été atteint<br />
et que la voie à l’entrée en vigueur de<br />
la CFFP a été ouverte. Concernant les prochaines<br />
étapes, la CDS a informé dans son<br />
communiqué qu’une séance constitutive<br />
des cantons ayant adhéré à la convention<br />
était prévue le 24 novembre <strong>2022</strong>. A cette<br />
occasion, il est également prévu de fixer<br />
les montants compensatoires définitifs<br />
pour 2023. «Plus les cantons qui ratifient la<br />
convention seront nombreux, plus l’impact<br />
de la convention sera important. Les<br />
cantons restants sont par conséquent invités<br />
à engager les procédures politiques en<br />
vue d’une adhésion.»<br />
L’Institut suisse pour la formation médicale<br />
postgraduée et continue (ISFM) a été<br />
à l’origine de la CFFP. Pour son directeur<br />
Christoph Hänggeli, il s’agit maintenant en<br />
particulier de préciser à quoi seront destinées<br />
les contributions de soutien. Dans le<br />
«Bulletin des médecins suisses», il a déclaré<br />
à ce propos que l’argent devait exclusivement<br />
servir à couvrir les coûts de la formation<br />
postgraduée structurée prodiguée.<br />
L’ISFM étant responsable de la mise en<br />
œuvre correcte et du respect des règles de<br />
la formation postgraduée. «Dans le cadre<br />
de la Réglementation pour la formation<br />
postgraduée (RFP), les établissements de<br />
formation postgraduée reconnus sont tenus<br />
de proposer quatre heures de formation<br />
postgraduée structurée par semaine.<br />
De plus, ils doivent démontrer comment<br />
les contributions accordées par le canton<br />
sont effectivement utilisées.»<br />
Pour venir en aide aux 2500 établissements<br />
de formation postgraduée, l’ISFM a<br />
clairement défini dans une directive la notion<br />
de formation postgraduée structurée<br />
et l’a illustrée par des exemples. <strong>No</strong>us allons<br />
veiller à ce que les fonds soient utilisés<br />
à bon escient, en particulier dans le cadre<br />
des visites et de l’enquête auprès des médecins-assistant(e)s,<br />
explique Christoph<br />
Hänggeli: «Un moyen efficace pour garantir<br />
la qualité de la formation postgraduée!»<br />
Davantage former les visiteurs<br />
A l’<strong>asmac</strong>, on réfléchit aussi aux répercussions<br />
de la nouvelle situation sur l’association.<br />
Lors d’un état des lieux, le Comité<br />
directeur a exprimé son accord avec<br />
l’ISFM. «<strong>No</strong>us soutenons ses efforts, entre<br />
autres en renforçant la formation de nos<br />
visiteuses et visiteurs», explique Patrizia<br />
Kündig. Indépendamment de cela, il est<br />
fondamental que les jeunes médecins<br />
fassent valoir leurs droits conformément<br />
au programme, au concept et au contrat<br />
de formation postgraduée. «Pour cela, le<br />
Comité central a approuvé une procédure<br />
à plusieurs étapes allant des entretiens<br />
avec les responsables de la formation<br />
postgraduée et des cliniques sur place<br />
jusqu’à des dénonciations et une pression<br />
politique accrue.»<br />
Concernant les succès annoncés, Patrizia<br />
Kündig renvoie à une proposition<br />
de l’<strong>asmac</strong> déposée au comité de l’ISFM.<br />
«Chaque établissement de formation<br />
postgraduée doit confirmer dans son<br />
concept de formation postgraduée qu’il<br />
propose au moins quatre heures de formation<br />
postgraduée structurée aux médecins-assistant(e)s.<br />
Dans un deuxième<br />
temps, il s’agit d’intégrer cette condition<br />
dans tous les programmes de formation<br />
postgraduée.»<br />
Reste à voir sur quels autres points<br />
l’association s’exprimera dans le contexte<br />
de la CFFP. Qu’en est-il par exemple des<br />
15 000 francs par médecin-assistant(e)?<br />
Ce montant est-il suffisant? Et à quelles<br />
(autres) conditions pourrait-on/faudrait-il<br />
lier l’octroi de la contribution? «Ce sont des<br />
questions importantes», admet la responsable<br />
du ressort formation postgraduée.<br />
«<strong>No</strong>us allons dès que possible discuter des<br />
réponses envisageables au sein de nos organes<br />
décisionnels.»<br />
Pour en savoir plus sur le sujet:<br />
vsao.ch/fr/formation-medicalepostgraduee/financement<br />
@vsao<strong>asmac</strong><br />
Comme ça ou<br />
autrement …<br />
<strong>No</strong>s membres savent que le chemin<br />
vers l’indépendance professionnelle<br />
est semé d’embûches. <strong>No</strong>us nous engageons<br />
d’autant plus au niveau du nouveau<br />
pilotage des admissions pour<br />
que les carrières ne se terminent pas<br />
prématurément dans un labyrinthe<br />
de restrictions. Mais alors que la mise<br />
en œuvre des règles est encore en<br />
cours de réflexion, la Commission de la<br />
sécurité sociale et de la santé publique<br />
du Conseil national (CSSS-N) veut les<br />
modifier partiellement.<br />
La CSSS-N souhaite que les cantons<br />
puissent, en cas de sous-approvisionnement<br />
chez les médecins de famille, les<br />
pédiatres et les psychiatres et psychothérapeutes<br />
d’enfants et d’adolescents,<br />
les autoriser à pratiquer même si ces<br />
derniers n’ont auparavant pas travaillé<br />
pendant trois ans dans un établissement<br />
de formation postgraduée suisse<br />
reconnu. L’exception s’appliquera aux<br />
détenteurs d’un diplôme étranger<br />
équivalent. Une consultation abrégée<br />
sur l’avant-projet est prévue. L’<strong>asmac</strong><br />
y participera.<br />
Pour en savoir plus sur le sujet:<br />
vsao.ch/fr/politique/pilotage-desadmissions<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 7
Vos besoins, notre<br />
centre d’intérêt<br />
Visites<br />
Evaluations, salaires, horaires de<br />
travail, crèches, offres d’emploi<br />
et bien plus encore: Medicus<br />
est le portail global pour votre<br />
carrière. Vous y trouverez le<br />
poste parfaitement adapté à vos<br />
attentes!<br />
Les hôpitaux et sections de<br />
l’<strong>asmac</strong> mettent à disposition des<br />
informations importantes relatives<br />
aux conditions de travail.<br />
Toutefois, c’est vous qui apportez<br />
la contribution la plus importante:<br />
en évaluant de manière<br />
anonyme votre ancien employeur.<br />
Vous aidez ainsi les autres et profitez<br />
de leurs expériences.<br />
Quelle est la qualité de la formation<br />
postgraduée dans les cliniques?<br />
Les visites se penchent en détail<br />
sur cette question. Il y a toujours un<br />
membre de l’<strong>asmac</strong> qui fait partie<br />
de l’équipe d’experts. Les visites<br />
sur place permettent d’identifier les<br />
possibilités d’amélioration. Car en<br />
tant que membre, nous voulons que<br />
vous puissiez profiter d’une formation<br />
postgraduée de qualité.<br />
Si vous souhaitez accompagner<br />
des visites, envoyez un e-mail<br />
à ribeaud@<strong>asmac</strong>.ch et vous en<br />
saurez plus!<br />
www.<strong>asmac</strong>.ch/visites<br />
www.medicus.ch<br />
Feedback-<br />
Pool<br />
Pour vous en tant que membre,<br />
elle est fondamentale: la formation<br />
postgraduée. C’est pourquoi nous<br />
réalisons régulièrement des sondages<br />
à ce sujet auprès de notre<br />
base. Grâce au Feedback-Pool,<br />
nous pouvons orienter notre travail<br />
de manière ciblée sur vos attentes.<br />
Vous voulez y participer? Alors écrivez<br />
un e-mail à ribeaud@<strong>asmac</strong>.ch.<br />
www.<strong>asmac</strong>.ch/etudes-etsondages<br />
Profession de<br />
médecin et famille<br />
• Comment puis-je concilier famille, loisirs et<br />
profession?<br />
• Comment puis-je reprendre mon travail<br />
après mon congé maternité?<br />
• Comment puis-je surmonter les défis<br />
quotidiens?<br />
En tant que membre de l’<strong>asmac</strong>, vous obtiendrez<br />
des réponses à ces questions avec notre<br />
coaching gratuit. Le conseil téléphonique est<br />
assuré par le Bureau UND.<br />
044 462 71 23<br />
info@und-online.ch<br />
www.<strong>asmac</strong>.ch/coaching-telephonique
Politique<br />
L’épineuse question du<br />
pilotage des admissions<br />
Bild: zvg<br />
«Comment ça se passe dans ton canton?»<br />
«Chez nous, ce n’est pas encore à l’ordre du jour!»<br />
«Vraiment?» Eh bien chez nous, les choses sont<br />
bien différentes: déjà le 1er avril <strong>2022</strong>, les autorités<br />
sont passées à l’acte et ont immédiatement instauré un gel<br />
partiel des admissions!»<br />
«Et comment définit-on la surmédicalisation chez vous?»<br />
«Aucune idée, ça n’existe pas chez nous!»<br />
Voilà plus ou moins ce que l’on entend<br />
lorsque les juristes des sections <strong>asmac</strong> se réunissent<br />
pour discuter de la mise en œuvre<br />
du pilotage des admissions. En effet, depuis<br />
le 1er janvier <strong>2022</strong>, les fournisseurs<br />
de prestations qui souhaitent<br />
nouvellement travailler à la charge<br />
de l’assurance obligatoire des soins<br />
(AOS) ne peuvent le faire qu’à condition<br />
de bénéficier d’une admission<br />
du canton sur le territoire duquel ils<br />
exercent. Par ailleurs, jusqu’à fin<br />
juin 2025, les cantons doivent limiter<br />
dans une ou plusieurs disciplines ou<br />
dans certaines régions le nombre de<br />
médecins qui fournissent des prestations<br />
dans le secteur ambulatoire.<br />
Le Conseil fédéral est chargé de définir les<br />
critères et principes méthodologiques pour cela.<br />
La fixation des nombres maximaux doit s’appuyer sur un<br />
modèle avec lequel sont calculés les taux d’approvisionnement<br />
régionaux par discipline. Le tout dans le but d’éviter une<br />
«surmédicalisation». Ou pour le dire plus simplement: pour<br />
économiser de l’argent.<br />
Il y a environ deux ans, le Parlement a créé les bases nécessaires<br />
pour le futur pilotage des admissions en révisant la loi.<br />
Depuis lors, la mise en œuvre du pilotage des admissions tient<br />
en haleine tous les cantons, d’innombrables autorités et tous<br />
les fournisseurs de prestations. Et donc aussi l’<strong>asmac</strong>. Comme<br />
souvent en Suisse, le Conseil fédéral se contente de définir<br />
les conditions-cadres sur la base desquelles les cantons doivent<br />
ensuite, conformément au principe fédéraliste, trouver voire<br />
inventer des solutions praticables. Alors que certains cantons<br />
ont déjà entamé la mise en œuvre et imposé des restrictions<br />
dans certaines disciplines, d’autres en sont encore à leurs<br />
débuts. Ce faisant, il s’agit d’aborder divers problèmes, et non<br />
des moindres.<br />
L’essentiel<br />
en bref<br />
Il s’agit par exemple de savoir comment maîtriser les taux<br />
d’approvisionnement calculés par la Confédération compte<br />
tenu du fait que pour définir les nombres maximaux, les cantons<br />
disposent d’un facteur de pondération qu’ils peuvent assez<br />
librement interpréter. En outre, il existe un risque de voir les<br />
propriétaires actuels de cabinets vouloir vendre leurs cabinets<br />
à des prix surfaits à leurs successeurs, ce qui empêcherait<br />
de nombreux jeunes médecins de franchir le pas<br />
vers une activité indépendante et qui ne saurait<br />
être dans l’intérêt d’une prise en charge<br />
des patients de bonne qualité, et encore<br />
moins d’un encouragement de<br />
la relève.<br />
Et avant que les cantons<br />
n’aient mis en œuvre le pilotage des<br />
admissions à large échelle, une<br />
nouvelle initiative parlementaire<br />
demande déjà des exceptions.<br />
Il s’agit concrètement d’une<br />
exception à l’obligation d’avoir<br />
exercé pendant trois ans dans<br />
un établissement de formation<br />
postgraduée suisse reconnu dans<br />
les cas suivants:<br />
a. médecine interne générale comme<br />
seul titre postgrade;<br />
b. médecin praticien comme seul titre postgrade;<br />
c. pédiatrie.<br />
Cette solution doit s’appliquer «en cas de pénurie<br />
de médecins» ...<br />
Et maintenant?<br />
Surmédicalisation, pénurie, mise en œuvre cantonale ...<br />
Il me semble qu’un certain travail reste à accomplir jusqu’à<br />
ce que l’histoire soit ramenée à l’essentiel!<br />
Yvonne Stadler,<br />
responsable droit/directrice adjointe de l’<strong>asmac</strong><br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 9
Formation postgraduée / Conditions de travail<br />
Une Rose pour<br />
la bonne planification<br />
des services<br />
La neuvième remise de la Rose d’hôpital a été l’occasion de présenter<br />
deux nouveautés: une nouvelle sculpture et le thème de la planification des<br />
services. L’Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) a acquis des mérites<br />
particuliers dans ce domaine.<br />
Marcel Marti, responsable politique et communication / directeur adjoint de l’<strong>asmac</strong> (jusqu’ à juillet <strong>2022</strong>)<br />
Edith Muff (service du personnel), Barbara Flubacher (responsable du personnel) et le Prof. Dr méd. Christoph Henzen (Chief Operating Officer, COO)<br />
reçoivent le prix pour l’Hôpital cantonal de Lucerne (de gauche à droite). Helen Manser et Mirjam Ulmi, les deux coprésidentes de la section Suisse<br />
centrale, ainsi que Marcel Marti (de droite à gauche), en tant que responsable politique et communication, représentaient l’<strong>asmac</strong>.<br />
Photos: màd; <strong>asmac</strong><br />
10<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Formation postgraduée / Conditions de travail<br />
Il y aurait beaucoup à faire si l’<strong>asmac</strong><br />
devait distribuer des cactus.<br />
«En effet, les problèmes concernant<br />
la situation de travail de nos<br />
membres restent très répandus», déclare<br />
la vice-présidente de l’<strong>asmac</strong> <strong>No</strong>ra Bienz.<br />
Elle renvoie à ce propos aux études internes<br />
de l’association qui révèlent des situations<br />
intenables et illégales, en particulier<br />
concernant la durée de travail.<br />
«Mais nous ne mettons pas seulement le<br />
doigt sur les points sensibles. <strong>No</strong>us souhaitons<br />
surtout aussi présenter des solutions<br />
et lever le pouce quand nous constatons<br />
que les employeurs entreprennent de<br />
vrais efforts pour améliorer la situation.»<br />
Le conseil en matière de planification<br />
des services figure parmi les solutions proposées<br />
par l’association. Depuis son lancement<br />
il y a environ huit ans, les cliniques<br />
et hôpitaux qui souhaitent profiter de<br />
l’offre sont toujours plus nombreux. «En<br />
2021, nous étions actifs sur plus de 40 sites<br />
dans tout le pays», explique <strong>No</strong>ra Bienz.<br />
Parmi les thèmes principaux figurent notamment<br />
la planification du nombre de<br />
postes, la réduction de la durée réglementaire<br />
et quotidienne de travail, la grossesse<br />
et la maternité, la formation postgraduée<br />
et la gestion des heures supplémentaires.<br />
De plus, des formations sont proposées.<br />
La récompense de l’<strong>asmac</strong> a la forme d’une<br />
vague de cristal avec une gravure intérieure<br />
en trois dimensions de la Rose, du logo de<br />
l’<strong>asmac</strong> et de l’inscription. Grâce à l’éclairage<br />
LED, la Rose brille même dans l’obscurité.<br />
«Un facilitateur»<br />
Compte tenu de son importance, la remise<br />
de la Rose d’hôpital <strong>asmac</strong> de cette année<br />
est placée sous le signe de la planification<br />
des services. <strong>No</strong>us levons donc le pouce<br />
pour l’Hôpital cantonal de Lucerne<br />
(LUKS). Mirjam Ulmi, co-présidente de la<br />
section <strong>asmac</strong> Suisse centrale, explique<br />
que le service du personnel de l’Hôpital<br />
cantonal de Lucerne a déjà adressé une<br />
première demande de soutien à l’association<br />
en 2016. «Depuis lors, nous entretenons<br />
une coopération continue fondée sur<br />
la confiance. La direction de l’hôpital a<br />
recommandé aux cliniques de faire appel<br />
à nos services et donc joué le rôle de facilitateur.<br />
<strong>No</strong>us avons pu conseiller de nombreux<br />
services et cliniques, aussi bien<br />
pour ce qui concerne les médecins-assistant(e)s<br />
que les chef(fe)s de clinique et ainsi<br />
améliorer la planification.»<br />
Lors de la remise du prix, Christoph<br />
Henzen, Chief Operating Officer (CCO) de<br />
l’Hôpital cantonal de Lucerne, s’est réjoui<br />
que l’<strong>asmac</strong> rende hommage à son hôpital.<br />
L’Hôpital cantonal de Lucerne a réalisé<br />
une analyse approfondie des processus de<br />
travail des médecins. Avec pour résultat<br />
que «nous devons mieux délimiter les<br />
tâches et les responsabilités». En conséquence,<br />
des blocs horaires fixes ont été introduits<br />
pour certains services, comme<br />
par exemple le service des urgences.<br />
Etre un employeur attrayant<br />
Dans un deuxième temps, l’accent a été<br />
mis sur la planification des services. Pour<br />
cela, les ressources humaines de l’Hôpital<br />
cantonal de Lucerne ont mis à disposition<br />
les données de la saisie du temps de travail<br />
pour développer, en collaboration avec<br />
l’<strong>asmac</strong>, une planification des services<br />
conforme aux conditions-cadres applicables.<br />
Cela avec pour objectif manifeste<br />
de renforcer l’attractivité en tant qu’employeur.<br />
«<strong>No</strong>us voulons proposer à nos<br />
collaboratrices et collaborateurs une collaboration<br />
interdisciplinaire, un encouragement<br />
personnel et professionnel ainsi que<br />
des conditions de travail au goût du jour»,<br />
explique Christoph Henzen. Des collaborateurs<br />
et collaboratrices motivés sont le<br />
facteur-clé d’un hôpital, notamment pour<br />
le bien-être des patientes et patients.<br />
L’Hôpital cantonal de Lucerne veut<br />
résolument poursuivre dans cette voie.<br />
Christoph Henzen souligne que cela signifie<br />
aussi poursuivre la collaboration avec<br />
l’<strong>asmac</strong>. «Compte tenu de la pénurie aiguë<br />
de personnel spécialisé, il est dans l’intérêt<br />
même de l’hôpital de prendre soin du<br />
personnel.»<br />
Pour en savoir plus sur le sujet:<br />
vsao.ch/fr/formation-medicale-continue/<br />
rose-dhopital-<strong>asmac</strong><br />
@vsao<strong>asmac</strong><br />
De quoi s’agit-il?<br />
Fais du bien et parles-en! La Rose<br />
d’hôpital que l’<strong>asmac</strong> décerne depuis<br />
2014 s’inspire de cette devise. Faire du<br />
bien incombe aux établissements de<br />
santé qui souhaitent améliorer la situation<br />
de travail des jeunes médecins par<br />
des mesures ciblées. Quant à l’<strong>asmac</strong>,<br />
elle en fait son devoir d’en parler en<br />
honorant chaque année une institution<br />
pour de bons résultats.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 11
Formation postgraduée / Conditions de travail<br />
Constructif,<br />
agréable, intense<br />
Le programme de mentorat «Coach my Career» lancé avec<br />
le concours de l’<strong>asmac</strong> poursuit sur la voie du succès.<br />
Les derniers chiffres et les réactions des participants en témoignent.<br />
Il s’agit maintenant de le perfectionner.<br />
Marcel Marti, responsable politique et communication / directeur adjoint de l’<strong>asmac</strong> (jusqu’ à juillet <strong>2022</strong>)<br />
118 médecins expérimentés s’engagent actuellement pour «Coach my Career».<br />
Une vingtaine d’entre eux se sont réunis à Olten pour un échange d’expériences.<br />
«Mentor, nom masculin:<br />
guide attentif et sage,<br />
conseiller expérimenté. Synonymes:<br />
guide, conseiller,<br />
inspirateur.» Le dictionnaire Larousse<br />
fournit une définition courte et sobre du<br />
travail que 118 médecins expérimentés<br />
accomplissent pour la relève professionnelle<br />
dans le cadre de «Coach my Career».<br />
Avec passion et à titre bénévole. Une vingtaine<br />
d’entre eux se sont retrouvés à Olten<br />
pour un atelier animé par la vice-présidente<br />
de l’<strong>asmac</strong> <strong>No</strong>ra Bienz. D’une part<br />
pour un bilan intermédiaire et un état<br />
des lieux, d’autre part pour la réflexion<br />
(auto-)critique dans le but de développer<br />
l’offre. Deux exposés ont servi de source<br />
d’inspiration.<br />
Mais chaque chose en son temps.<br />
Venons-en d’abord aux chiffres. D’après<br />
Markus Gubler, responsable de projet auprès<br />
de l’Association des médecins dirigeants<br />
d’hôpitaux de Suisse (AMDHS), les<br />
mentors couvrent actuellement 47 disciplines,<br />
y compris les formations approfondies.<br />
C’est un nombre conséquent, même<br />
s’il reste encore de la marge. Sans compter<br />
que les besoins évoluent. «A l’heure actuelle,<br />
la chirurgie plastique est très demandée»,<br />
explique Markus Gubler. «<strong>No</strong>us<br />
répondons à ces tendances et tentons de<br />
satisfaire la demande.» Car celle-ci augmente<br />
continuellement depuis le lancement<br />
de «Coach my Career» et s’est traduite<br />
par 117 entretiens de conseil.<br />
Positif pour les deux parties<br />
Le sondage réalisé dans la salle a montré<br />
que les coaches considèrent le dialogue<br />
et la confrontation avec les jeunes médecins<br />
en premier lieu comme constructif,<br />
agréable et intense. Cette appréciation positive<br />
est partagée par les personnes encadrées:<br />
dans les évaluations de 2019 et <strong>2022</strong>,<br />
l’atmosphère agréable lors de l’échange, la<br />
Photos: <strong>asmac</strong><br />
12<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Formation postgraduée / Conditions de travail<br />
durée des entretiens ainsi que l’intérêt<br />
manifeste des conseillers plus leur compétence<br />
professionnelle ont été particulièrement<br />
relevés. La concrétisation des<br />
objectifs professionnels, le bénéfice à long<br />
terme du coaching et la présentation de<br />
nouvelles possibilités ont également été<br />
évalués très positivement.<br />
Vu que l’idée pour l’offre de mentorat<br />
a été développée sur la base d’un modèle<br />
mis en œuvre chez ABB Suisse, il était<br />
logique d’inviter deux représentantes du<br />
groupe actif à l’échelle mondiale. Les explications<br />
données par Nicole Kamm Steiner<br />
et Barbara Fehr ont bien montré la<br />
complexité et diversité du sujet et l’investissement<br />
de leur employeur dans la transmission<br />
des connaissances. En conséquence,<br />
le développement de la carrière<br />
ne se limite pas aux femmes, mais s’adresse<br />
également aux collaborateurs plus âgés et<br />
aborde les questions telles que la diversité<br />
et l’inclusion.<br />
Apprendre de «Aiming Higher»<br />
Marie-Claire Flynn, cheffe de clinique à<br />
la clinique d’oncologie médicale et hématologie<br />
de l’Hôpital cantonal de St-Gall, a<br />
apporté sa contribution dans un exposé<br />
consacré aux expériences acquises avec<br />
«Aiming Higher». Il s’agit d’un programme<br />
de mentorat de l’Université de St-Gall<br />
(HSG) pour les médecins-assistantes à<br />
partir de la deuxième année qui visent une<br />
carrière à l’hôpital. Parmi les thèmes principaux<br />
figurent la conduite/le self-leadership,<br />
la compétence de négociation et<br />
d’expression en public ainsi que la planification<br />
de carrière. «Et renforcer le réseau,<br />
car cela facilite les choses et est très enrichissant»,<br />
a souligné Marie-Claire Flynn.<br />
A son avis, la bonne entente entre la<br />
personne prise en charge et la personne<br />
chargée de l’encadrement constitue une<br />
condition essentielle pour un conseil réussi.<br />
Bienveillance et respect mutuels sont<br />
nécessaires ainsi qu’un équilibre entre<br />
soutien et défi. De plus, les coaches doivent<br />
être capables de gérer les retours et les<br />
jeunes médecins doivent avoir le sens<br />
des responsabilités. Cela veut dire «qu’ils<br />
s’occupent d’organiser l’entretien, se préparent<br />
et définissent les thèmes». Sans<br />
oublier de formuler leurs objectifs.<br />
Choisir la bonne orientation<br />
Christof Bieri, participant à l’atelier, a présenté<br />
un exemple pertinent à ce propos.<br />
L’étudiant en médecine bernois de sixième<br />
année a expliqué avoir réfléchi à ses intérêts<br />
et les avoir intégrés dans un schéma et<br />
La vice-présidente de l’<strong>asmac</strong>, <strong>No</strong>ra Bienz, a présenté le programme de l’atelier.<br />
Il incluait deux exposés consacrés à d’autres programmes de mentorat.<br />
représentés par des recoupements avant<br />
de rencontrer les deux mentors. Car à son<br />
âge ou dans sa situation, on a beaucoup<br />
d’idées, mais on ne sait pas encore où elles<br />
peuvent nous conduire, a expliqué Christof<br />
Bieri. Sur la base de son schéma, ses<br />
conseillers ont ensuite pu lui montrer les<br />
orientations envisageables. «Ce qui a été<br />
d’un grand soutien. De plus, on m’a montré<br />
que l’on ne peut pas tout planifier. Je<br />
vais donc commencer dans une clinique et<br />
ensuite éventuellement m’orienter vers la<br />
médecine interne générale.»<br />
De nombreuses questions ont été soulevées<br />
pendant la manifestation. Particulièrement<br />
celles concernant la nécessité<br />
de disposer de connaissances préalables<br />
pour prodiguer les coachings d’environ<br />
deux heures. Les mentors ont estimé que<br />
plus il y a d’informations sur la personne à<br />
encadrer, mieux c’est. La vice-présidente<br />
de l’<strong>asmac</strong> <strong>No</strong>ra Bienz a promis de revoir<br />
encore une fois ce point et a souligné que<br />
l’on s’efforçait systématiquement de chercher<br />
de manière ciblée des conseillers sur<br />
la base des indications fournies par les<br />
jeunes médecins.<br />
La déclaration suivante dans le public<br />
a cependant aussi fait l’unanimité: «De<br />
nombreux points qui font partie de notre<br />
programme de mentorat devraient tout<br />
naturellement être assumés par les supérieurs<br />
hiérarchiques.»<br />
Pour en savoir plus sur le sujet:<br />
www.vlss.ch/fr/carriere/coach-my-career<br />
@vsao<strong>asmac</strong><br />
De quoi s’agit-il?<br />
La FMH en collaboration avec l’AMDHS,<br />
l’<strong>asmac</strong>, mfe, la swimsa et l’ISFM sont<br />
à l’origine de «Coach my Career». L’offre<br />
s’adresse aux étudiant(e)s en médecine<br />
de dernière année et aux jeunes médecins-assistant(e)s<br />
et chef(fe)s de clinique<br />
sur le point de faire des choix professionnels<br />
importants. Le conseil et la<br />
promotion sont assurés par des médecins-chef(fe)s<br />
et -cadres ainsi que des<br />
médecins de famille fraîchement retraités<br />
ou encore actifs disposant d’un<br />
réseau professionnel et d’expérience<br />
dans le domaine de la formation<br />
postgraduée.<br />
Les médecins-assistant(e)s et chef(fe)s<br />
de clinique paient 150 francs, les étudiant(e)s<br />
50 francs. Les coaches travaillent<br />
bénévolement, mais peuvent<br />
demander le remboursement de leurs<br />
frais de voyage.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 13
<strong>asmac</strong><br />
<strong>No</strong>uvelles<br />
des sections<br />
St-Gall /<br />
Appenzell<br />
A l’est, du nouveau<br />
«C’est à chaque fois la même chose, la<br />
section St-Gall/Appenzell n’a jamais rien<br />
à proposer de nouveau, bordel de *****.<br />
Que fait leur comité?»<br />
C’est ce que l’un ou l’autre a peut-être<br />
pensé parfois en lisant la rubrique «<strong>No</strong>uvelles<br />
des sections» à la recherche d’actualités<br />
de Suisse orientale. <strong>No</strong>us pouvons<br />
vous rassurer, le comité de notre section<br />
reste à l’affût. De nombreux projets sont<br />
actuellement en cours: l’analyse de notre<br />
sondage consacré à la situation de travail<br />
de nos membres envoyé l’automne dernier<br />
est sur le point d’être terminée. Et les<br />
choses bougent aussi dans d’autres domaines.<br />
Comme notre comité est exclusivement<br />
composé de jeunes membres, il<br />
faut en permanence s’attendre à des surprises.<br />
Ainsi, Lorena Rohner a quitté notre<br />
comité pour pouvoir pleinement se<br />
concentrer sur son nouveau poste en<br />
Thurgovie. Merci pour ton engagement<br />
Lorena! Et comme nous attachons une<br />
grande importance à la relève, nous recevons<br />
régulièrement des avis de naissance.<br />
Cela a pour conséquence que notre comité<br />
devra se reconstituer. La présidence sera<br />
progressivement transférée des deux<br />
co-présidentes Claudia Enz et Deborah<br />
Seitz à Severin Baerlocher. Le passage de<br />
témoin officiel est prévu lors de la prochaine<br />
assemblée générale en novembre.<br />
Le fait que notre comité se trouve aujourd’hui<br />
dans une situation favorable,<br />
qu’il soit animé par de nombreuses<br />
bonnes idées et qu’il le reste à l’avenir ne<br />
va pas de soi. C’est le fruit de la bonne gestion<br />
assurée par les deux présidentes et le<br />
travail engagé de ses membres. Même si la<br />
taille importante du territoire de notre<br />
section rend la tâche parfois plus complexe,<br />
le comité est parvenu à établir le<br />
cercle des représentants des hôpitaux afin<br />
d’assurer un échange régulier avec les<br />
membres des différentes cliniques. Si<br />
nous voulons cependant poursuivre notre<br />
engagement en votre faveur, vous devez<br />
continuer de nous faire part des problèmes<br />
que vous rencontrez au quotidien.<br />
Celles et ceux qui ne souhaitent pas le<br />
faire par le biais d’un contact personnel<br />
peuvent utiliser le nouveau bureau de notification<br />
en ligne sur <strong>asmac</strong>.ch. La notification<br />
est transmise à notre comité qui<br />
procède alors à son analyse. <strong>No</strong>us cherchons<br />
ensuite, dans la mesure du possible,<br />
des solutions.<br />
Vous voyez, la section St-Gall / Appenzell<br />
ne lâche pas le ballon, même si la finale<br />
de la Coupe Suisse ... vous voyez ce<br />
que je veux dire, n’est-ce pas? Contactez-nous<br />
si vous avez un problème, si la<br />
charge de travail vous dépasse ou si vous<br />
voulez simplement collaborer au sein d’un<br />
jeune comité motivé pour façonner l’avenir<br />
hospitalier en Suisse orientale. <strong>No</strong>us<br />
nous réjouissons de vos nouvelles!<br />
Severin Baerlocher, membre du comité de la<br />
section St-Gall / Appenzell<br />
Annonce<br />
Agence matrimoniale<br />
Service Personalisé · Compétent · Sérieux<br />
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich<br />
044 534 19 50<br />
<strong>No</strong>us serions ravis de vous rencontrer.<br />
Kathrin Grüneis<br />
14<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
<strong>asmac</strong><br />
Réélue brillamment: Anna Wang, présidente de la section<br />
Photo: màd<br />
Zurich /<br />
Schaffhouse<br />
Changement au comité<br />
L’assemblée générale annuelle de l’ASMAC<br />
Zurich/Schaffhouse a une nouvelle fois<br />
enregistré une bonne fréquentation. Cette<br />
fois à la Zunfthaus zur Meisen, où elle a<br />
permis de découvrir dans les beaux locaux<br />
le vernissage de l’exposition «Les artistes<br />
de la médecine» de Bettina Reichl et d’assister<br />
à un concert de piano donné par<br />
Anna-Li Hanneforth et Richard Mansky,<br />
membre du comité. Ils ont interprété<br />
quatre morceaux à quatre mains de Mozart<br />
et Grieg.<br />
<strong>No</strong>tre présidente Anna Wang a été réélue<br />
à l’unanimité, moment associé aux<br />
remerciements à elle et l’ensemble du comité<br />
pour leur engagement. La direction<br />
de la section est renforcée par Tabea Cincera<br />
(médecin-assistante en gynécologie<br />
et obstétrique à l’Hôpital de Männedorf)<br />
qui rejoint le ressort compatibilité profession/vie<br />
privée et égalité des chances ainsi<br />
que Philipp Kron (chef de clinique en<br />
chirurgie viscérale et de transplantation à<br />
l’Hôpital universitaire de Zurich) qui rejoint<br />
le ressort chirurgie. <strong>No</strong>us leur souhaitons<br />
la cordiale bienvenue et nous réjouissons<br />
de collaborer avec eux!<br />
<strong>No</strong>s chaleureux remerciements vont<br />
aussi à Reto Thomasin et Laura Münst,<br />
membres du comité de longue date démissionnaires,<br />
et aux nombreux membres qui<br />
ont fait le déplacement – en espérant les<br />
revoir à la prochaine occasion!<br />
Dominique Iseppi, assistante de communication,<br />
ASMAC Zurich<br />
Save the Date:<br />
Time to cut!<br />
Le premier numéro de notre nouveau<br />
format «Time to cut! Karriereseminar<br />
und Hands on Training by VSAO<br />
Zürich» se déroulera le samedi<br />
1 er octobre <strong>2022</strong> à l’Université de Zurich.<br />
Cette manifestation exclusive<br />
s’adresse aux médecins-assistant(e)s<br />
et chef(fe)s de clinique des disciplines<br />
chirurgicales. Elle propose, outre<br />
des entretiens de carrière, aussi la<br />
possibilité de s’entraîner aux<br />
procédures endoscopiques et à la<br />
manipulation microchirurgicale<br />
sur des simulateurs.<br />
Inscrivez-vous sans attendre sur<br />
vsao-zh.ch!<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 15
<strong>asmac</strong><br />
<strong>asmac</strong>-Inside<br />
Severin Baerlocher<br />
Lieu de résidence: St-Gall<br />
Membre de l’<strong>asmac</strong> depuis: 2017<br />
L’<strong>asmac</strong> en trois mots:<br />
essentielle, jeune, dynamique<br />
Severin qui?<br />
Une question qui ne se pose plus<br />
depuis cette année quand il est question<br />
de Severin Baerlocher et de l’<strong>asmac</strong>.<br />
En effet, ce jeune médecin de 34 ans se<br />
transforme en homme à tout faire: fin<br />
novembre, élection au Comité directeur,<br />
au printemps première participation<br />
comme délégué à la Chambre médicale,<br />
nouveau membre du groupe de travail<br />
pour imposer la loi sur le travail et la formation<br />
médicale postgraduée ainsi<br />
que la réduction de la durée de travail.<br />
Point final? Que nenni! Après trois ans<br />
passés au comité de la section St-Gall,<br />
il s’attend à reprendre la présidence.<br />
Celui qui fait preuve d’un tel engagement<br />
doit être très intéressé et motivé.<br />
Sa motivation se remarque rapidement<br />
lorsqu’on entend parler le médecin-assistant<br />
qui travaille à la clinique de médecine<br />
interne générale de l’Hôpital cantonal<br />
de St-Gall. Il l’exprime ainsi: «Les tâches<br />
politiques me motivent, j’aime le dialogue<br />
et je me réjouis de tous les contacts que<br />
je peux avoir avec d’autres personnes.»<br />
Revenons au premier point – pourquoi<br />
justement l’<strong>asmac</strong>? «Il n’y a pas d’alternative<br />
à notre association. Elle est nécessaire,<br />
car elle ne ménage pas ses efforts<br />
pour que les hôpitaux suisses disposent<br />
à l’avenir aussi d’un personnel médical<br />
motivé et excellemment formé.»<br />
Severin Baerlocher souhaite pour<br />
cela que les conditions de travail permettent<br />
de mieux concilier le travail et<br />
la vie de famille ou les loisirs. Pour ses<br />
collègues comme pour lui-même, ses intérêts<br />
dépassent largement le cadre de<br />
l’association. Pour garder l’équilibre à<br />
côté de son travail et de sa formation<br />
postgraduée pour l’obtention du titre de<br />
spécialiste en médecine interne générale,<br />
il pratique l’escalade en été et fait des<br />
randonnées à ski en hiver. Entre deux,<br />
il s’assied au piano ou lit la «Neue Zürcher<br />
Zeitung» (NZZ). Et ce n’est pas tout: «Si<br />
j’ai du temps et de l’argent, je vole sur un<br />
Cessna ou pratique la voile que j’adore.»<br />
Dans le cadre de son engagement<br />
pour l’<strong>asmac</strong>, il maîtrise bien le jeu entre<br />
sérieux et légèreté. Car nombreux sont<br />
ceux qui s’imaginent que le travail dans<br />
un comité est ennuyeux. «Pourtant, nous<br />
rions beaucoup, mangeons une pizza<br />
ensemble et développons ainsi dans une<br />
atmosphère détendue des solutions aux<br />
problèmes soulevés par nos membres.»<br />
C’est avec un clin d’œil, si ce n’est plus,<br />
que Severin Baerlocher s’exprime finalement<br />
sur ses perspectives personnelles:<br />
«Avant-hier, j’étais steward, hier étudiant<br />
en médecine, aujourd’hui médecin-assistant<br />
et demain chef de clinique à Wil.<br />
Après-demain, je siège au Conseil national<br />
et dans deux semaines au Conseil<br />
fédéral. J’ai déjà eu d’innombrables plans<br />
pour l’avenir que j’ai ensuite de nouveau<br />
dû abandonner. Le suspense reste donc<br />
entier!»<br />
Photo: màd<br />
16<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
<strong>No</strong>tre réseau de partenaires pour<br />
la fiduciaire, les assurances et la prévoyance<br />
Près de chez vous, dans toute la Suisse<br />
CENTRES DE CONSEIL en assurances, prévoyance et gestion financière<br />
• Allcons AG 4153 Reinach • Assidu 2800 Delémont, 6903 Lugano • BTAG Versicherungsbroker AG 3084 Wabern<br />
• UFS Insurance Broker AG 8810 Horgen • VM-F Frank insurance brokers GmbH 9300 Wittenbach • Vorsorge<br />
Wirz 4058 Basel<br />
PARTENAIRES FIDUCIAIRES pour comptabilité financière, optimisation fiscale, conseil économique<br />
• Axios Fiduciaire Sàrl 1920 Martigny • B+A Treuhand AG 6330 Cham • Brügger Treuhand AG 3097 Liebefeld/Bern<br />
• contrust finance ag 6004 Luzern • Fiduciaire Leitenberg & Associés SA 2301 La Chaux-de-Fonds<br />
• GMTC Treuhand & Consulting AG 9014 St. Gallen • KONTOMED Ärztetreuhand AG 8808 Pfäffikon • LLK Treuhand<br />
AG 4052 Basel • Mehr-Treuhand AG 8034 Zürich • Quadis Treuhand AG 3952 Susten • Sprunger Partner AG<br />
3006 Bern • W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung 7001 Chur<br />
Vous trouverez tous les partenaires de conseil en ligne ou appelez-nous sans hésiter.<br />
<strong>No</strong>s membres bénéficient d’un premier entretien gratuit d’une heure pour évaluer leurs besoins.<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong><br />
téléphone 031 350 44 22<br />
info@mediservice-<strong>asmac</strong>.ch<br />
www.mediservice-<strong>asmac</strong>.ch
<strong>asmac</strong><br />
Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />
Durée maximale de travail<br />
de neuf heures par jour<br />
en cas de grossesse et rapport<br />
avec une durée réglementaire<br />
de travail plus élevée<br />
Pourquoi ne peut-on pas<br />
faire valoir de travail supplémentaire<br />
pendant la grossesse,<br />
si l’on travaille plus<br />
de 45 heures par semaine?<br />
L’employeur doit occuper les femmes<br />
enceintes de telle sorte que leur santé et<br />
la santé de l’enfant ne soient pas compromises<br />
et aménager leurs conditions de<br />
travail en conséquence (art. 35 al. 1 LTr).<br />
Les femmes enceintes ne peuvent pas<br />
être employées au-delà de la durée<br />
ordinaire convenue de la journée de<br />
travail, cette durée ne doit en aucun cas<br />
excéder neuf heures (art. 60 al. 1 OLT 1).<br />
De mauvaises conditions de travail<br />
se répercutent aussi sur l’enfant et<br />
peuvent compromettre son bien-être et<br />
sa santé. La disposition en matière de<br />
protection de la santé mentionnée ne<br />
sert pas seulement à protéger la femme<br />
enceinte, mais en premier lieu l’enfant<br />
à naître. Tout le monde doit donc la<br />
respecter. Pas seulement l’employeur<br />
et les collègues de travail, mais aussi<br />
et surtout les femmes enceintes ellesmêmes,<br />
qui doivent faire valoir leurs<br />
droits sans condition, dans l’intérêt du<br />
bien-être de l’enfant à naître. Dans ce<br />
cas, le devoir d’assistance du médecin<br />
envers le patient n’est pas un intérêt<br />
supérieur. En particulier dans le contexte<br />
hospitalier, les collègues de travail<br />
peuvent facilement l’assumer. A cela<br />
s’ajoute que la plupart des heures de<br />
travail supplémentaire ne découlent<br />
pas du travail au chevet des patients,<br />
mais du travail administratif qui peut<br />
toujours attendre ou être délégué.<br />
Le législateur a fixé une limite<br />
maximale qui interdit de travailler plus<br />
de neuf heures par jour. D’une manière<br />
générale, il est donc souhaitable et<br />
toujours admis de rester en dessous de<br />
cette limite. Il n’est donc pas non plus<br />
possible de générer un solde d’heures<br />
négatif pendant la grossesse qui serait<br />
imputable à la femme enceinte (pendant<br />
ou après le congé de maternité). Hélas,<br />
il existe de nombreux hôpitaux qui<br />
appliquent encore la durée réglementaire<br />
de travail de 50 heures par semaine<br />
répartie sur cinq jours. Celle-ci correspond<br />
à la durée hebdomadaire maximale<br />
de travail fixée par la loi sur le travail.<br />
Les heures de service des femmes<br />
enceintes doivent donc être adaptées et<br />
réduites à neuf heures par jour. Même<br />
dans des situations exceptionnelles,<br />
on ne peut pas exiger des travaux supplémentaires<br />
dépassant la limite des neuf<br />
heures. Une répartition sur plus de cinq<br />
jours serait aussi illicite.<br />
Comment se présente la situation<br />
lorsque l’employeur n’exige pas de travail<br />
supplémentaire ou seulement de ma-<br />
Photos: Adobe Stock; màd<br />
18<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
<strong>asmac</strong><br />
nière indirecte et/ou que la femme<br />
enceinte exécute malgré tout, parce<br />
qu’elle a mauvaise conscience, les<br />
travaux supplémentaires au-delà de la<br />
limite des neuf heures? Peut-elle<br />
compenser ces heures de travail supplémentaire<br />
dans les jours suivants?<br />
La loi ne lui accorde pas de droit<br />
à une compensation. Le salaire a été<br />
convenu pour une durée de 50 heures<br />
par semaine, et non pas pour 45 heures<br />
que le législateur prescrit pour protéger<br />
les femmes enceintes. Pour un taux<br />
d’activité de 100%, la femme enceinte<br />
ne peut générer ni un solde d’heures<br />
négatif ni des heures de travail supplémentaire.<br />
La situation peut cependant<br />
être différente pour un poste à temps<br />
partiel, p. ex. pour 50% répartis sur cinq<br />
jours, où il faut aussi tenir compte de<br />
la durée maximale de la journée de<br />
travail de neuf heures qui n’est jamais<br />
atteinte. Il n’est donc pas nécessaire<br />
d’adapter l’horaire de service, et les<br />
heures de travail peuvent être documentées<br />
comme d’habitude. Dans cet<br />
exemple, cela s’accompagne d’une<br />
inégalité de traitement entre les femmes<br />
enceintes travaillant à plein temps et<br />
celles travaillant à temps partiel. C’est<br />
pourtant défendable, étant donné que<br />
la disposition légale concernant la durée<br />
maximale de la journée de travail a en<br />
premier lieu été émise pour protéger<br />
l’enfant à naître.<br />
Les employeurs progressistes ont<br />
reconnu la problématique liée à une<br />
planification jusqu’à la limite des<br />
50 heures par semaine. Et les problèmes,<br />
aussi ceux concernant les collaboratrices<br />
enceintes, ont simplement pu être<br />
résolus en réduisant la durée réglementaire<br />
de travail pour tous les collaborateurs.<br />
Certains employeurs qui appliquent<br />
encore la semaine de 50 heures<br />
sont cependant passés à une saisie du<br />
temps de travail séparée pour les femmes<br />
enceintes. Dans le meilleur des cas,<br />
les soldes d’heures sont «gelés» lorsque<br />
la femme se déclare enceinte et réactivés<br />
après le congé maternité. Dans l’intervalle<br />
s’applique une durée maximale<br />
de travail de 45 heures par semaine ou<br />
neuf heures par jour. Les supérieurs<br />
hiérarchiques obligent même les femmes<br />
enceintes à respecter la durée maximale<br />
par jour et, si les conditions d’exploitation<br />
le permettent, de générer plutôt<br />
des heures négatives qui n’ont ensuite<br />
aucun impact et peuvent être supprimées.<br />
Si une urgence liée à l’exploitation<br />
a pour conséquence que la durée maximale<br />
de neuf heures est dépassée, ce qui<br />
ne peut généralement pas être saisi, la<br />
femme enceinte sera autorisée, les jours<br />
suivants, à quitter le travail plus tôt ou à<br />
générer des heures négatives.<br />
Un autre point important est d’adapter<br />
les contenus de travail au taux<br />
d’activité réduit des femmes enceintes,<br />
au même titre que l’on éliminera au<br />
moyen d’une évaluation des risques les<br />
travaux pénibles ou dangereux (art. 35 al.<br />
2 LTr).<br />
Annonce<br />
schweizer mediziner-orchester<br />
orchestre des médecins suisses<br />
o r c h e s t r a d e i m e d i c i s v i z z e r i<br />
Grieg<br />
Klavierkonzert a-Moll<br />
Tschaikowsky<br />
Sinfonie Nr. 5 e-Moll<br />
Dirigent:<br />
Johannes Schlaefli<br />
Klavier:<br />
Teo Gheorghiu<br />
28. August <strong>2022</strong><br />
17 Uhr, Casino Bern<br />
Benefizkonzert für<br />
Patronatskomitee:<br />
Alec von Graffenried, Stadtpräsident Bern<br />
Flavia Wasserfallen, Nationalrätin<br />
Christa Markwalder, Nationalrätin<br />
Prof. Thierry Carrel, Herzchirurgie USZ<br />
Prof. Steffen Eychmüller, Palliativmedizin Inselspital<br />
Tickets:<br />
Susanne Hasse,<br />
avocate et directrice de<br />
l’ASMAC Zurich<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 19
Point de mire<br />
Un véritable «zoo» de planètes: depuis 1995,<br />
les astronomes ont découvert plus de 5000<br />
exoplanètes. Elles se distinguent de leurs étoiles<br />
par leur taille, leur masse et leur distance.<br />
Il s’agit à présent d’étudier leur composition<br />
chimique et leur atmosphère.<br />
A la recherche de la<br />
vie dans l’univers<br />
En 1995, les astronomes genevois Michel Mayor et Didier Queloz<br />
découvrent avec leur équipe la première exoplanète, révolutionnant ainsi<br />
la conception que nous avions jusqu’alors de l’univers. Leurs successeurs<br />
recherchent à présent des traces de vie sur ces planètes.<br />
Willy Benz, professeur d’astrophysique et de planétologie à l’Institut de physique de l’Université de Berne,<br />
ancien doctorant de Michel Mayor<br />
Stockholm Concert Hall, 10 décembre<br />
2019. D’un côté de la<br />
scène, le roi et la reine de Suède,<br />
accompagnés de dignitaires. En<br />
face d’eux, de l’autre côté, un petit groupe<br />
d’éminents scientifiques. La musique résonne,<br />
le moment est important. Le roi<br />
appelle les scientifiques les uns après les<br />
autres afin de leur décerner le prix <strong>No</strong>bel<br />
dans leur domaine respectif. Parmi eux,<br />
Michel Mayor et Didier Queloz, qui partagent<br />
le prix de physique 2019 avec un<br />
collègue américain. Le son des applaudissements<br />
se fond dans la musique.<br />
Perdue dans la foule, une petite délégation<br />
des Universités de Genève et de<br />
Berne retient son souffle. En ces instants<br />
solennels, chacun sent que rien ne sera<br />
plus jamais comme avant. Le Comité <strong>No</strong>bel<br />
écrit: «Leurs découvertes ont changé à<br />
jamais notre vision du monde.» Le prix a<br />
également changé leur vie et, dans une<br />
certaine mesure, la nôtre.<br />
Qu’ont-ils découvert? En 1995, ils découvrent<br />
la première planète située en dehors<br />
de notre système solaire, en orbite<br />
autour d’une étoile comme le Soleil. Pour<br />
la première fois, l’existence de telles<br />
«exoplanètes» est scientifiquement prouvée.<br />
Les exoplanètes, n’existant jusqu’alors<br />
qu’au travers de spéculations théoriques,<br />
d’hypothèses philosophiques ou d’histoires<br />
de science-fiction, deviennent réalité.<br />
Une avancée majeure. Et un nouveau<br />
champ d’investigation pour la science.<br />
Un défi de taille pour l’astronomie<br />
moderne<br />
Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour découvrir<br />
cette première exoplanète? Cela<br />
s’explique par la nature même des planètes.<br />
Elles sont beaucoup plus petites et<br />
Photo: NASA / JPL-Caltech<br />
20<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
moins lumineuses que les étoiles. La taille<br />
de la Terre, par exemple, représente moins<br />
de 1% de celle du Soleil et elle brille un milliard<br />
de fois moins que lui. De plus, vues de<br />
la Terre, ces planètes minuscules et peu<br />
lumineuses sont très proches de leur étoile<br />
brillante. Les voir et analyser leur lumière<br />
représente un défi de taille pour l’astronomie<br />
moderne. Un défi qui ne peut être relevé<br />
que pour les planètes les plus massives<br />
et les plus éloignées.<br />
<strong>No</strong>s collègues suisses ont résolu le<br />
problème en recourant à une méthode indirecte<br />
pour détecter la planète. Ils ont observé<br />
l’étoile et mesuré son mouvement,<br />
déclenché par la présence d’une planète<br />
proche et plus petite. L’étoile et la planète<br />
exercent toutes deux une force d’attraction<br />
l’une sur l’autre, ce qui les fait se déplacer<br />
sur leur orbite. Plus la force d’attraction<br />
est grande, plus la vitesse est élevée.<br />
En mesurant la vitesse de l’étoile, il<br />
est possible de déterminer la masse de la<br />
planète. Le problème est que les planètes<br />
ont une masse beaucoup plus faible que<br />
celle de leurs étoiles, si bien que la vitesse<br />
des étoiles décroît. Pour détecter ces<br />
faibles vitesses, des mesures de très haute<br />
précision sont nécessaires. Ce qui était<br />
tout simplement impossible avant les années<br />
1990.<br />
Une planète impossible<br />
Dans le cas de nos lauréats du prix <strong>No</strong>bel,<br />
ils ont mesuré la vitesse de l’étoile 51 Pégase<br />
en fonction du temps. Ils ont découvert<br />
que la vitesse de l’étoile variait avec<br />
une période de 4,23 jours. Leurs analyses<br />
leur ont permis de déduire que ces variations<br />
étaient dues à la présence d’une planète.<br />
Cette planète doit avoir une masse<br />
équivalente à presque la moitié de celle de<br />
Jupiter et doit tourner autour de l’étoile<br />
une fois tous les 4,23 jours – et non pas<br />
tous les 4,23 ans! Jamais on n’aurait imaginé<br />
pouvoir trouver une planète géante<br />
aussi proche de son étoile. Mais cela ne<br />
faisait aucun doute: elle était bel et bien là.<br />
L’histoire de la formation des planètes est<br />
soudain devenue beaucoup plus complexe.<br />
A l’époque, la machine et la technique<br />
utilisées par les chercheurs permettaient<br />
une précision d’environ 10 m/s. Une dizaine<br />
d’années plus tard, ils ont réussi à<br />
construire un instrument capable de mesurer<br />
des vitesses avec une précision de<br />
1 m/s. La dernière génération, utilisée de<br />
nos jours sur le plus grand télescope, atteint<br />
10 cm/s. Une telle précision permet<br />
de mettre à portée de main une planète<br />
semblable à la Terre. Plus de 30 ans de développement<br />
d’instruments ont été nécessaires<br />
pour atteindre cette précision. Les<br />
astronomes et les fabricants d’instruments<br />
sont très persévérants, et la société<br />
doit faire preuve de patience pour les soutenir.<br />
Plus de 5000 planètes connues<br />
Depuis 1995, les astronomes ont découvert<br />
plus de 5000 exoplanètes. Pas toujours<br />
avec la même technique de découverte indirecte.<br />
Une technique particulièrement<br />
efficace consiste à observer la lumière<br />
incidente des étoiles. Lorsqu’une planète<br />
passe devant une étoile, elle cache une<br />
petite partie de sa surface. Pendant ce<br />
transit, la quantité de lumière que nous<br />
recevons est légèrement réduite. Une petite<br />
diminution périodique de la luminosité<br />
peut être constatée avec une précision<br />
suffisante. Cette variation de luminosité<br />
fournit une mesure non pas de la masse,<br />
mais du rayon de la planète. La masse et<br />
le rayon permettent de calculer la densité<br />
moyenne. Il s’agit d’une première étape<br />
dans la caractérisation physique des<br />
exoplanètes.<br />
Le satellite CHEOPS, sous l’égide de<br />
l’Université de Berne, utilise cette méthode<br />
de transit. Lancé le 18 décembre<br />
2019, juste avant le début de la pandémie,<br />
il a observé les exoplanètes pendant deux<br />
ans et demi. Sa précision inédite a permis<br />
de mesurer des rayons plus exacts et<br />
de nombreuses autres caractéristiques<br />
uniques. Les nouvelles planètes dans les<br />
systèmes et la déformation d’une planète<br />
due aux marées à proximité immédiate de<br />
son étoile en sont deux exemples. CHEOPS<br />
poursuit son infatigable campagne de mesure<br />
et fait le tour de la Terre en 90 minutes<br />
environ.<br />
Prochaine étape: rechercher des<br />
traces de vie<br />
Avec le temps, nous avons découvert qu’il<br />
existe des planètes de tailles, de masses et<br />
de distances différentes par rapport à leurs<br />
étoiles. Un véritable «zoo» de planètes!<br />
Aujourd’hui, le défi n’est plus de les découvrir,<br />
mais de les caractériser. <strong>No</strong>us voulons<br />
connaître leur composition chimique, la<br />
structure de leur atmosphère et leur température<br />
de surface, et découvrir si elles<br />
abritent des lacs ou des océans. Et bien<br />
sûr, de potentielles traces de vie!<br />
Il faut pour cela des instruments plus<br />
grands et plus précis. Ces dernières années,<br />
plusieurs projets de construction de<br />
télescopes géants ont été lancés. Ces télescopes,<br />
au sol ou dans l’espace, seront<br />
équipés d’instruments de la prochaine génération.<br />
Grâce à eux, nous pourrons enfin<br />
«voir» les planètes de type terrestre et<br />
les étudier en détail. La prochaine étape<br />
est imminente. Nul ne sait où elle nous<br />
mènera. C’est la partie passionnante de<br />
la recherche fondamentale: nous allons là<br />
où les observations et la physique nous<br />
poussent.<br />
<strong>No</strong>us sommes la première génération<br />
à disposer d’instruments permettant potentiellement<br />
de trouver de la vie sur<br />
d’autres planètes. <strong>No</strong>tre capacité à la trouver<br />
dépendra de sa fréquence. Le défi sera<br />
de s’assurer que la signature que nous<br />
voyons dans nos mesures est bien due à la<br />
vie et rien d’autre. Il existera de nombreux<br />
différends et controverses, mais c’est ainsi<br />
que la science progresse.<br />
Entre-temps, la cérémonie de remise<br />
des prix <strong>No</strong>bel est terminée et nous<br />
sommes conduits en bus à l’hôtel de ville<br />
de Stockholm, où a lieu le dîner de gala.<br />
<strong>No</strong>us ne sommes pas vraiment sur un pied<br />
d’égalité avec les lauréats, mais nous apprécions<br />
le repas avec les 1200 autres invités.<br />
Le souper est ponctué de discours et<br />
d’intermèdes musicaux. <strong>No</strong>us regagnons<br />
l’hôtel à une heure tardive. Epuisés, mais<br />
avec le sentiment d’avoir participé à un<br />
événement qui a couronné l’une des découvertes<br />
astronomiques majeures de ces<br />
derniers temps.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 21
Point de<br />
mire<br />
Photo: Adobe Stock<br />
22<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 23
Point de mire<br />
Le langage<br />
du sang<br />
Les traces de sang laissées sur une scène d’accident ou de crime<br />
peuvent aider à déterminer les événements. Qu’est-ce que<br />
la morphoanalyse des traces de sang? Et surtout: pourquoi revêt-elle<br />
une grande importance dans le service des urgences<br />
ou le cabinet médical?<br />
D r Silke M.C. Brodbeck, Institut de morphoanalyse des traces de sang, Usingen, Allemagne<br />
«Le sang est un jus très spécial»,<br />
disait Goethe. Et si<br />
les étudiants en médecine<br />
apprennent à observer et à<br />
quantifier les érythrocytes, les leucocytes<br />
et les thrombocytes et à comprendre<br />
l’importance de leur quantité et de leur<br />
forme, le sang est un liquide<br />
auquel nous sommes<br />
confrontés depuis la naissance<br />
et pour lequel il<br />
existe d’autres méthodes<br />
d’analyse.<br />
Dès la première prise<br />
de sang, l’enfant voit le liquide<br />
rouge sortir de son<br />
corps, et ressent une brève<br />
douleur. A l’âge adulte, la<br />
nature veut que les femmes<br />
soient régulièrement con frontées à des<br />
saignements dans le cadre de leurs<br />
menstruations. Même si certaines personnes<br />
associent à tort le sang à un sentiment<br />
de dégoût, on ne peut que rendre<br />
hommage à ce liquide si on l’examine objectivement.<br />
Le sang est un liquide biologique<br />
vital. Dans un monde médical où<br />
nous pouvons implanter des articulations<br />
artificielles à divers endroits et assurer<br />
temporairement les fonctions pulmonaires,<br />
rénales et cardiaques, il n’est pas<br />
possible à ce jour de fabriquer du sang artificiel.<br />
C’est la raison pour laquelle les<br />
banques de sang ont régulièrement besoin<br />
de dons pour approvisionner les patients<br />
sur les tables d’opération et dans les<br />
cliniques.<br />
Science interdisciplinaire<br />
Mais le sang comporte une autre dimension,<br />
en dehors de la médecine, qui intervient<br />
dans les enquêtes sur les blessures<br />
corporelles, les accidents et les homicides,<br />
et qui porte essentiellement sur la physique<br />
du sang.<br />
«Il ne viendrait à l’idée de personne<br />
de vouloir faire disparaître une tache<br />
d’encre avec de l’encre ou une tache<br />
d’huile avec de l’huile. Seul le sang se<br />
lave avec du sang.»<br />
Bertha von Suttner<br />
La morphoanalyse des traces de sang<br />
est une science appliquée et interdisciplinaire<br />
qui comporte des éléments de physique,<br />
de chimie, de médecine, de sciences<br />
des matériaux et de mathématiques et qui<br />
s’intéresse aux mécanismes de formation<br />
des traces de sang.<br />
Comme la médecine, l’observation<br />
des traces de sang trouve son origine dans<br />
l’empirisme et n’a été placée sur une base<br />
moderne et scientifique qu’au fur et à mesure<br />
de son développement. Aujourd’hui,<br />
le chapitre «Über Blutspuren» (A propos<br />
des traces de sang) de l’ouvrage «Handbuch<br />
für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte<br />
u.s.w.» (Manuel pour les juges<br />
d’instruction, les fonctionnaires de police,<br />
etc.) est considéré comme l’origine scientifique.<br />
L’analyse systématique des traces de<br />
sang sur les scènes de crime y est décrite<br />
pour la première fois. Le premier travail<br />
scientifique a été réalisé deux ans plus tard<br />
par un médecin légiste de l’Université de<br />
Cracovie. Le Dr Eduard Piotrowski s’est<br />
mis à étudier l’orientation du sang giclant<br />
de la tête des lapins qu’il<br />
frappait avec un marteau.<br />
Il est toutefois regrettable<br />
que ses expériences n’aient<br />
été que peu standardisées.<br />
La morphoanalyse est réellement<br />
connue depuis l’affaire<br />
Sam Sheppard. Condamné<br />
en première instance en<br />
1954 pour le meurtre de sa<br />
femme, Marilyn Reese-Sheppard,<br />
sur la base de traces<br />
de sang retrouvées sur un oreiller, l’ostéopathe<br />
Sam Sheppard a été acquitté plusieurs<br />
années plus tard faute de preuves.<br />
Gouttes, éclaboussures, traces de<br />
contact<br />
Mais en quoi consiste la morphoanalyse<br />
des traces de sang, également désignée<br />
par l’abréviation anglaise BPA («Bloodstain<br />
Pattern Analysis»)? Elle consiste en l’évaluation<br />
visuelle des traces de sang dans le<br />
but de définir leur mécanisme d’apparition.<br />
Elle appartient au canon des nombreuses<br />
méthodes d’analyse des traces de sang, dont<br />
font également partie la toxicologie et l’analyse<br />
ADN par exemple. La morphoanalyse<br />
des traces de sang sert essentiellement à<br />
reconstituer les faits. Prenons un exemple.<br />
24<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
On sait, et pas seulement depuis Les Experts, que les traces de sang peuvent fournir des indications importantes sur le déroulement d’un accident<br />
ou d’un crime. Ces traces doivent donc être conservées et documentées le mieux possible.<br />
Photo: màd<br />
Les traces de sang sur les scènes de<br />
crime ou sur les vêtements des victimes<br />
révèlent souvent le mécanisme d’origine<br />
sous l’angle de la physique. Dans ce cadre,<br />
les scientifiques font la distinction entre<br />
une tache d’égouttement, une tache de<br />
contact et une tache d’éclaboussure. Ces<br />
dernières résultent toutefois de nombreux<br />
mécanismes et n’indiquent pas toujours<br />
directement le déroulement des événements.<br />
En effet, elles peuvent tout aussi<br />
bien provenir de l’expectoration de sang<br />
par les voies respiratoires.<br />
La morphoanalyse des traces de sang<br />
se penche généralement sur les échantillons<br />
de traces de sang dits complexes. Elle<br />
consiste à observer et à décoder différents<br />
types d’échantillons, puis à se questionner<br />
sur l’origine des traces, ce qui peut potentiellement<br />
fournir une information sur<br />
l’action qui les a générées. Une fois ces<br />
questions soulevées, il faut déterminer<br />
comment ces différents types de traces<br />
s’intègrent dans le déroulement des événements<br />
sur place.<br />
Traitement des traces de sang<br />
Dans la vie de tous les jours, les médecins<br />
sont souvent confrontés à des pièces à<br />
conviction et à des preuves, la plupart du<br />
temps sans s’en rendre compte. Que ce soit<br />
aux urgences, après l’admission d’une personne<br />
blessée en salle de réanimation ou<br />
dans un cabinet de médecine de famille,<br />
par exemple dans le cas de victimes de violences<br />
domestiques.<br />
La priorité est toujours de traiter et<br />
de soigner les blessures. Il faut toutefois<br />
souligner que les équipes médicales sont<br />
souvent en première ligne pour soutenir<br />
les enquêtes peu après un incident. Cela<br />
commence dans la salle de réanimation,<br />
lorsque les vêtements des victimes doivent<br />
être conservés ou documentés. En cas de<br />
blessures physiques ou de violences<br />
sexuelles, on trouve souvent des traces<br />
pertinentes sur les vêtements. Si les vêtements<br />
sont très souillés, il est judicieux<br />
d’intercaler du papier entre les couches<br />
afin d’éviter que le sang ne s’infiltre dans<br />
les parties du textile qui n’ont pas été<br />
touchées. L’utilisation de sacs en plastique<br />
est proscrite, car ils retiennent l’humidité<br />
dans les textiles et peuvent altérer les<br />
traces. Les sacs en papier sont plus appropriés.<br />
Il est également important de documenter<br />
les blessures, un processus aujourd’hui<br />
simplifié grâce aux progrès de la<br />
technique numérique et à la prise de photos<br />
via le téléphone portable.<br />
Dès les années 70, l’importance de la<br />
conservation des traces dans les services<br />
d’urgence et les salles de réanimation a été<br />
abordée dans des séries télévisées comme<br />
Quincy (p. ex. dans l’épisode «Let me light<br />
the way»). Il est primordial que le personnel<br />
médical conserve et documente les traces<br />
avant leur destruction. Cela contribue à<br />
soutenir les enquêtes et donc l’élucidation<br />
des cas, même si l’appréciation revient ensuite<br />
aux juridictions. En effet, plus la documentation<br />
est précoce, plus elle est importante<br />
pour l’appréciation et le jugement.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 25
VIV_CH_VOC_11647240_HCP-AD_210x297_03-22_FR_RZ03_RP.indd 2 05.05.22 17:26<br />
<strong>No</strong>us sommes<br />
partenaires.<br />
Economisez 10% sur les assurances complémentaires hôpital<br />
grâce au partenariat conclu entre mediservice vsao<strong>asmac</strong><br />
et Visana. Demandez une offre ou un entretien de<br />
conseil d’ici au 31.12.<strong>2022</strong> et vous recevrez en remerciement<br />
un bon Coop d’une valeur de CHF 30.–.<br />
Votre cadeau:<br />
bon Coop d’une<br />
valeur de<br />
CHF 30.–<br />
Visana, Weltpoststrasse 19,<br />
3000 Bern 15<br />
tél. 0848 848 899,<br />
visana.ch/hk/ms-<strong>asmac</strong>
Point de mire<br />
En quête de nos<br />
ancêtres<br />
En règle générale, nous connaissons l’histoire de nos grands-parents,<br />
peut-être même celle de nos arrière-grands-parents. Mais avant?<br />
Jusqu’où peut-on remonter dans sa propre famille? Seules ou avec l’aide<br />
de professionnels, les personnes désireuses peuvent se mettre<br />
en quête de leurs origines.<br />
Nicole Weil, historienne<br />
Il n’est pas nécessaire d’avoir une généalogie aussi illustre que celle des Bourbons, ici un arbre généalogique du XVII e siècle (Sylvain Bonnet, 1682),<br />
pour apprendre des choses passionnantes sur ses propres origines.<br />
La généalogie (du grec ancien<br />
«genealogéo») s’intéresse aux<br />
liens de parenté et à leur représentation<br />
(sous forme d’arbres<br />
généalogiques ou de listes d’ancêtres), autour<br />
d’un dénominateur commun biologique<br />
et social. On distingue généralement<br />
la généalogie ascendante (les ancêtres<br />
d’une personne) et la généalogie descendante<br />
(les descendants d’une personne). [1]<br />
Quête autonome de ses racines<br />
Votre curiosité a été éveillée et vous souhaitez<br />
partir sur les traces de vos ancêtres?<br />
Le désir d’en savoir plus est souvent animé<br />
par la découverte de l’acte de mariage des<br />
arrière-grands-parents, du journal intime<br />
de la grand-tante ou les souvenirs des<br />
grands-parents racontés à l’occasion des<br />
réunions de famille.<br />
Photo: Photo: généalogie des Bourbons [Sylvain Bonnet, 1682], Wikimédia<br />
28<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
Une bonne façon de commencer une<br />
recherche généalogique est d’interroger<br />
les membres de la famille et d’autres parents.<br />
Chaque personne a des souvenirs<br />
qui lui sont propres, qu’elle ne se souvienne<br />
que de peu de choses du passé et ne<br />
puisse donc fournir que des informations<br />
isolées, ou qu’elle ait beaucoup de choses<br />
à raconter.<br />
Pour le novice, la recherche des ancêtres<br />
en ligne ou par un autre biais est<br />
toutefois fastidieuse, car les informations<br />
ne sont généralement pas servies sur un<br />
plateau. Suivre un cours dans ce domaine<br />
ou échanger avec des personnes partageant<br />
la même passion au sein d’associations<br />
de généalogie peut être utile pour se<br />
lancer.<br />
Le travail systématique dans ce domaine<br />
s’apprend. Pour des investigations<br />
plus approfondies, avec des éclaircissements<br />
et des recherches plus difficiles<br />
pour des questions de temps, de géographie,<br />
de nombre ou autre, il est recommandé<br />
de confier le travail à un généalogiste<br />
professionnel.<br />
La personne en quête de ses origines<br />
doit réfléchir au préalable au temps et à<br />
l’argent qu’elle souhaite investir dans son<br />
«projet». Moins il y a de données ou de documents<br />
disponibles au départ et plus la<br />
recherche doit être détaillée par la suite,<br />
plus l’investissement en temps et en<br />
argent sera important.<br />
Définir la recherche<br />
1) <strong>No</strong>rmalement, une recherche d’ancêtres<br />
commence par les membres les plus<br />
jeunes de la famille ou la dernière génération.<br />
La personne qui effectue les recherches<br />
peut également se prendre<br />
elle-même comme point de départ, bien<br />
qu’elle ne soit pas la plus jeune dans cette<br />
hiérarchie familiale, mais qu’elle ait aussi<br />
des descendants.<br />
2) Les recherches doivent-elles se baser<br />
uniquement sur la lignée masculine?<br />
3) Les recherches doivent-elles se baser<br />
également sur la lignée féminine? Si<br />
c’est le cas, cela implique un investissement<br />
nettement plus important, tant en<br />
termes de temps que d’argent.<br />
4) Faut-il rechercher uniquement les ascendants<br />
directs (enfants – parents –<br />
grands-parents – etc.)?<br />
5) Les «lignées latérales» respectives, à savoir<br />
les frères et sœurs et leurs descendants<br />
de chaque génération, entrentelles<br />
également en ligne de compte?<br />
6) Les conjoints sont-ils impliqués?<br />
7) Faut-il remonter le plus de générations<br />
possible ou seulement un certain<br />
nombre (il arrive que certaines personnes<br />
expriment ce souhait)?<br />
8) Si, au cours de la recherche, on constate<br />
que des ancêtres se sont établis non seulement<br />
en Suisse, mais aussi à l’étranger:<br />
faut-il élargir la recherche aux familles<br />
émigrées?<br />
Trouver les sources<br />
Il est recommandé de se procurer les données<br />
des dernières générations auprès des<br />
services d’état civil compétents et, à partir<br />
de là, de demander également les données<br />
des autres générations dans la mesure du<br />
possible. (Une procédure uniforme a été<br />
définie avec l’introduction/l’entrée en vigueur<br />
de la loi fédérale sur l’état civil de<br />
1876.) [2]<br />
Avant 1876, les données personnelles<br />
enregistrées par les paroisses, telles que<br />
les naissances, les baptêmes, les mariages<br />
et les décès, se trouvent dans ce que l’on<br />
appelle les «registres paroissiaux». De nos<br />
jours, ces registres sont normalement<br />
conservés dans les Archives nationales et<br />
généralement saisis en ligne.<br />
Pour les non-initiés, il est difficile<br />
d’interpréter de tels documents. Des<br />
connaissances de base sont nécessaires<br />
pour déchiffrer l’allemand ancien («écriture<br />
cursive allemande» ou «écriture de<br />
chancellerie allemande»), une écriture difficile<br />
en soi utilisée dans les pays de culture<br />
germanique. De plus, les rédacteurs de documents<br />
n’étaient pas tous des génies de la<br />
calligraphie!<br />
Lire entre les lignes<br />
Une fois que les données des ancêtres ont<br />
été recherchées et consignées, que ce soit<br />
sous la forme d’un arbre généalogique<br />
illustré ou d’une liste d’ascendance, il est<br />
possible d’examiner de plus près les documents<br />
originaux (cela vaut également pour<br />
les documents saisis en ligne). Les données<br />
relatives à une personne contiennent des<br />
termes qui correspondent à la fois aux exigences<br />
actuelles au sens des offices d’état<br />
civil et à celles des «registres paroissiaux».<br />
Il s’agit par exemple du nom de famille<br />
(pour les femmes, également du nom de<br />
jeune fille), des prénoms, des surnoms, de<br />
la date et du lieu de naissance, de la date de<br />
baptême, de la date de mariage, de la date<br />
du décès, des titres professionnels, du lieu<br />
de résidence ou du nombre d’enfants. En<br />
«lisant entre les lignes», on découvre que<br />
les données racontent leur propre histoire.<br />
Par exemple:<br />
Une mention à côté d’une date de décès<br />
donne des informations sur la cause<br />
du décès, par exemple «noyé». Les registres<br />
fédéraux de l’état civil, comme les<br />
registres des décès, indiquent les professions<br />
qu’exerçaient nos ancêtres.<br />
Lorsque l’on se consacre à la généalogie,<br />
il faut toutefois faire preuve d’esprit<br />
critique face aux résultats et les vérifier<br />
scrupuleusement.<br />
(Pour ne pas alourdir le texte, le masculin est<br />
employé seul, mais il inclut à la fois les hommes et<br />
les femmes).<br />
Bibliographie<br />
[1] Wikipedia allemand, définition<br />
de la généalogie, consulté le 2.5.<strong>2022</strong>.<br />
[2] Perrenoud, Alfred: «Etat civil»,<br />
dans: Dictionnaire historique de la Suisse<br />
(DHS), version du 21.1.2021. En ligne:<br />
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/<br />
007986/2021-01-21/, consulté le 4.5.<strong>2022</strong>.<br />
Le bureau des projets historiques<br />
Cet article est basé sur l’expérience de longue date de l’auteure en tant qu’historienne<br />
et généalogiste. Informations complémentaires sur:<br />
www.geschichtsagentur.ch / geschichtsagentur@bluewin.ch<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 29
Perspectives<br />
Actualités en oncologie: Les tumeurs germinales chez l’homme<br />
Stratégies thérapeutiques<br />
actuelles<br />
Même si elles sont rares, elles représentent le cancer le plus fréquent chez<br />
les jeunes hommes. Suivant la localisation et le stade des tumeurs germinales,<br />
on dispose de bonnes options et directives thérapeutiques.<br />
Anja Lorch, médecin adjointe à la Clinique d’oncologie médicale et hématologie, Hôpital universitaire de Zurich<br />
Les tumeurs germinales chez<br />
l’homme sont rares, mais le<br />
cancer le plus fréquent chez les<br />
jeunes. Le traitement adéquat<br />
et adapté au stade de la maladie revêt<br />
donc une importance particulière et peut,<br />
notamment pour les tumeurs avancées,<br />
parfois représenter un défi. Les directives<br />
nationales et internationales émettent<br />
des recommandations thérapeutiques<br />
bien étayées par les données. Celles-ci incluent,<br />
outre l’utilisation adaptée de la<br />
chimiothérapie, de la chirurgie et de la radiothérapie,<br />
également le choix des médicaments<br />
nécessaires et la durée de leur<br />
utilisation. Il s’agit d’éviter un surtraitement<br />
du patient, mais aussi un traitement<br />
insuffisant. Même lorsque la maladie présente<br />
un stade avancé, le traitement vise<br />
un objectif curatif et les chances de guérison<br />
sont globalement élevées [1].<br />
Diagnostic et traitement<br />
Du point de vue histologique, on distingue<br />
les tumeurs séminomateuses des tumeurs<br />
non séminomateuses. Alors que 95 % des<br />
tumeurs du testicule chez les hommes surviennent<br />
dans le testicule, environ 5 % sont<br />
localisées en dehors des gonades.<br />
Un symptôme fréquent est un grossissement<br />
ou gonflement indolore du testicule.<br />
Parfois, les patients remarquent aussi<br />
des signes d’une maladie avancée,<br />
comme p. ex. des douleurs dorsales, une<br />
dyspnée, une perte de poids ou des symptômes<br />
neurologiques.<br />
Le diagnostic comprend, outre l’examen<br />
clinique avec palpation des testicules,<br />
la sonographie des deux testicules<br />
ainsi que la détermination des marqueurs<br />
tumoraux HCG, AFP et LDH. Ceux-ci<br />
prouvent souvent la néoplasie, servent à<br />
surveiller l’évolution en cours de traitement<br />
et dans le cadre du suivi. Les bilans<br />
d’extension avec tomodensitométrie du<br />
thorax, de l’abdomen et du bassin sont<br />
obligatoires. Une imagerie de la tête ou<br />
des os est par contre facultative (seulement<br />
en cas de dissémination métastatique<br />
étendue, en particulier dans les<br />
poumons, de marqueurs tumoraux très<br />
élevés, de symptômes cliniques ou en cas<br />
de récidive). Si le patient souhaite avoir<br />
des enfants, l’analyse des spermatozoïdes<br />
et leur cryoconservation complètent le<br />
bilan d’extension. Une tomographie par<br />
émission de positons au 18 F-fluorodésoxyglucose<br />
(FDG PET-CT) n’est pas nécessaire<br />
[2].<br />
L’orchidectomie est généralement la<br />
première mesure thérapeutique qui a souvent<br />
déjà un effet curatif. Pour les tumeurs<br />
germinales avec une charge tumorale très<br />
élevée, des marqueurs très élevés ou en cas<br />
de dissémination métastatique symptomatique<br />
marquée, l’orchidectomie n’est réalisée<br />
qu’au terme du traitement systémique.<br />
Tous les patients devraient ensuite<br />
être présentés dans le cadre d’un tumor<br />
board interdisciplinaire. En particulier<br />
lorsqu’il s’agit de scénarios rares et de patients<br />
dont la maladie est à un stade avancé,<br />
il est vivement recommandé de prendre<br />
contact à temps avec un centre d’experts.<br />
Traitement du stade localisé (stade I)<br />
Au stade I, la maladie est limitée au testicule<br />
et les marqueurs tumoraux affichent<br />
des valeurs normales après l’orchidectomie.<br />
Si les marqueurs ne se normalisent<br />
pas ou augmentent même par la suite, il<br />
s’agit d’un stade métastatique, également<br />
sans détection de métastases lors de l’examen<br />
par imagerie.<br />
Au stade I, la seule surveillance («Active<br />
Surveillance») est généralement suffisante.<br />
En présence de certains facteurs de<br />
risque, une chimiothérapie ou radiothérapie<br />
adjuvante peut être nécessaire au stade<br />
localisé, dans de rares cas, aussi une résection<br />
chirurgicale des ganglions lymphatiques<br />
rétropéritonéaux (RPLND).<br />
Pour le séminome, suivant les facteurs<br />
de risque, le risque de récidive sous<br />
surveillance active est de 9 à 26 %. Le<br />
risque de récidive peut aussi être réduit à<br />
environ 5 % par un cycle de chimiothérapie<br />
adjuvante au carboplatine AUC 7. Les<br />
facteurs de risque pour le séminome sont<br />
l’envahissement du rete testis et la taille de<br />
la tumeur [3].<br />
Pour les tumeurs non séminomateuses,<br />
le risque de récidive dépend des<br />
facteurs de risque lymphogènes et/ou de<br />
l’invasion vasculaire. En présence de ces<br />
facteurs, il atteint environ 50 %, en leur absence<br />
15 %. L’administration d’un cycle de<br />
chimiothérapie adjuvante au PEB (cisplatine,<br />
étoposide et bléomycine) permet de<br />
réduire le risque de récidive à environ 1 %.<br />
Une part élevée de carcinome embryonnaire<br />
contribue aussi à accroître le risque<br />
de récidive [4].<br />
Facteurs pronostiques du stade<br />
métastatique<br />
A partir d’un stade II, on parle d’une maladie<br />
métastatique. Tous les patients avec un<br />
stade >IIB et III ont besoin d’une chimiothérapie<br />
primaire et sont attribués à un<br />
30<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Tableau 1. Classification selon «IGCCCG» dans les stades métastatiques<br />
Profil de risque favorable (env. 56 % des patients) Survie env. 90 %<br />
Tumeurs non<br />
séminomateuses<br />
Tumeurs<br />
séminomateuses<br />
Clinique<br />
Tumeur primaire gonadique<br />
ou rétropéritonéale et marqueurs<br />
«bas» et absence de métastases<br />
extrapulmonaires<br />
Toute localisation primaire et absence<br />
de métastases extrapulmonaires<br />
Marqueurs bas<br />
AFP 1000 ng/mL<br />
HCG 5000 U/L<br />
LDH 1,5 la norme<br />
Profil de risque intermédiaire (env. 28 % des patients) Survie env. 78 %<br />
Tumeurs non<br />
séminomateuses<br />
Tumeurs<br />
séminomateuses<br />
Clinique<br />
Tumeur primaire gonadique ou<br />
rétropéritonéale et marqueurs<br />
«intermédiaires» et absence de<br />
métastases extrapulmonaires<br />
Toute localisation primaire et<br />
métastases extrapulmonaires<br />
Marqueurs intermédiaires<br />
AFP 1000 –10 000 ng/mL<br />
HCG 5000–50 000 U/L<br />
LDH 1,5 –10 la norme<br />
Pronostic défavorable (env. 16 % des patients) Survie env. 45 %<br />
Tumeurs non<br />
séminomateuses<br />
Clinique<br />
Tumeur médiastinale primaire ou<br />
marqueurs «élevés» ou métastases<br />
extrapulmonaires<br />
Extrait de: Deutsches Ärzteblatt Jg. 102, Heft 47, 25. <strong>No</strong>vember 2005 (A3273)<br />
Marqueurs élevés<br />
AFP 10 000 ng/mL<br />
HCG 50 000 U/L<br />
LDH 10 la norme<br />
Tableau 2. Traitement de première intention Source: adapté selon la directive Onkopedia<br />
Traitement du stade métastatique<br />
Stade IIA/B<br />
Pour le stade IIA d’un séminome, qui est<br />
très rare, la radiothérapie (Involved field<br />
Radiatio) reste la première option thérapeutique,<br />
en dehors des études cliniques.<br />
Tous les stades de séminomes à partir de<br />
IIB sont en premier lieu traités avec trois<br />
cycles d’une chimiothérapie combinée au<br />
PEB tous les 21 jours ou alternativement<br />
avec quatre cycles de cisplatine et étoposide<br />
(PE). Une radiothérapie peut être discutée<br />
à titre d’alternative [8].<br />
A l’heure actuelle, les patients en Suisse<br />
peuvent aussi être inclus dans une étude<br />
clinique de phase II (SAKK 01/18). Ils reçoivent<br />
une chimioradiothérapie combinée<br />
(1 cycle de carboplatine AUC 7 suivi d’une<br />
irradiation involved node avec 24 Gy pour<br />
IIA ou 1 cycle PE et ensuite une irradiation<br />
involved node avec 30 Gy pour IIB).<br />
Une thérapie, en particulier pour le<br />
stade IIA, ne devrait être entamée que<br />
lorsque le diagnostic a été définitivement<br />
confirmé.<br />
Une RPLND peut aussi être envisagée<br />
chez des patients atteints d’une tumeur<br />
non séminomateuse dont les ganglions<br />
lymphatiques restent inchangés dans le<br />
contexte de marqueurs tumoraux normaux,<br />
cela pour exclure un tératome.<br />
PEB Cisplatine 20 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
Etoposide<br />
Bléomycine<br />
100 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
30 mg absolu<br />
jour 1, 8, 15<br />
PE Cisplatine 20 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
Etoposide<br />
100 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
PEI Cisplatine 20 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
Etoposide<br />
Ifosfamide<br />
75 à 100 mg/m²<br />
jour 1 à 5<br />
1,2 g/m²<br />
jour 1 à 5<br />
groupe de risque selon la classification des<br />
risques IGCCCG (International Germ Cell<br />
Cancer Colaborative Group) [5] (voir tableau<br />
1). Cette classification s’appuie sur<br />
des données collectées avant 1990. Une initiative<br />
du IGCCCG Update Consortium a<br />
tous les 21 jours<br />
tous les 21 jours<br />
tous les 21 jours<br />
3 à 4 cycles<br />
4 cycles<br />
3 à 4 cycles<br />
analysé un grand nombre de données actuelles<br />
pour vérifier la classification initiale<br />
avec les méthodes de diagnostic et de<br />
traitement modernes [6, 7]. Les trois<br />
groupes pronostiques ont pu être confirmés<br />
dans l’analyse actuelle.<br />
Stade IIC/III<br />
Le traitement standard conformément à la<br />
stratification des risques selon la classification<br />
des risques IGCCCG est, indépendamment<br />
de l’histologie, une chimiothérapie<br />
avec trois (pour un groupe pronostique<br />
favorable) ou quatre cycles (pour un groupe<br />
pronostique intermédiaire ou défavorable)<br />
PEB espacés de 21 jours (alternativement<br />
4 cycles PE ou 3 à 4 cycles cisplatine, étoposide,<br />
ifosfamide [PEI]). Un retard de l’administration<br />
ou une réduction de la dose<br />
doivent absolument être évités [2] (cf. tableau<br />
2).<br />
Au cours des dernières années, on a<br />
cherché des stratégies thérapeutiques intensifiées,<br />
en particulier pour les patients<br />
présentant un groupe pronostique défavorable.<br />
Cela a permis pour la première fois<br />
de mettre en évidence, dans le cadre d’une<br />
étude prospective randomisée (GETUG<br />
13), chez des patients affichant une baisse<br />
inadéquate des marqueurs dans le premier<br />
cycle, un avantage en termes de survie<br />
par une intensification consécutive du<br />
traitement, cependant sans mettre en évidence<br />
un avantage significatif en termes<br />
de survie [9]. Des données américaines<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 31
Perspectives<br />
pour le régime TIP avec paclitaxel, ifosfamide<br />
et cisplatine, utilisé jusqu’ici uniquement<br />
pour la thérapie de sauvetage, ont<br />
montré, dans une étude de phase II, de très<br />
bons résultats à long terme dans cette population<br />
de patients, cependant avec un<br />
profil d’effets secondaires plus élevé, sans<br />
avantage significatif par rapport au traitement<br />
standard [10].<br />
Les études ont aussi porté sur l’importance<br />
de la chimiothérapie à haute dose<br />
(HDCT) avec un support autologue de cellules<br />
souches dans le traitement primaire.<br />
Toutes les études réalisées n’ont pas permis<br />
de démontrer pour l’ensemble des patients<br />
un avantage statistiquement significatif<br />
en faveur de la HDCT [11, 12].<br />
L’utilisation d’une HDCT dans le traitement<br />
primaire chez des patients avec<br />
des facteurs pronostiques défavorables ne<br />
constitue donc actuellement pas la norme,<br />
mais peut être judicieuse dans le cas particulier.<br />
Dans ce contexte, la décision devrait<br />
toujours être prise en concertation<br />
avec un centre d’experts.<br />
Résection de la tumeur résiduelle<br />
après le traitement de première<br />
intention<br />
Chez les patients atteints d’un séminome<br />
qui présentent des résidus tumoraux, une<br />
résection de la tumeur résiduelle n’est<br />
pas obligatoire. Pour les résidus >3 cm, un<br />
PET-CT peut être discuté au plus tôt huit<br />
semaines après la conclusion de la chimiothérapie.<br />
Ce n’est que dans cette configuration<br />
que le PET constitue une indication<br />
judicieuse. Chez les patients présentant un<br />
PET positif, l’examen doit tout d’abord être<br />
répété avec des examens par imagerie<br />
conventionnels ou, le cas échéant, en procédant<br />
à une biopsie pour exclure des résultats<br />
faux positifs [13].<br />
Pour tous les patients atteints d’une<br />
tumeur non séminomateuse avec des résidus<br />
tumoraux >1 cm, une résection est réalisée<br />
après quatre, voire au maximum huit<br />
semaines après la conclusion de la chimiothérapie<br />
dans le but d’éliminer entièrement<br />
les résidus tumoraux. Cette intervention<br />
souvent complexe ne devrait être<br />
réalisée que dans un centre disposant de<br />
l’expertise correspondante [14].<br />
Thérapie de sauvetage<br />
Environ 5 à 10 % de tous les patients et 30 %<br />
des patients atteints de tumeurs métastatiques<br />
à un stade primaire ont une récidive.<br />
Le traitement de patients avec une récidive<br />
d’un stade I s’effectue conformément<br />
aux algorithmes thérapeutiques<br />
pour les patients atteints d’une maladie<br />
métastatique primaire.<br />
Les patients qui ont une récidive après<br />
une chimiothérapie primaire reçoivent à<br />
nouveau une chimiothérapie intense suivie<br />
d’une résection de la tumeur résiduelle<br />
(pour les tumeurs non séminomateuses).<br />
En principe, on procède à une thérapie de<br />
sauvetage conventionnelle au cisplatine<br />
(CDCT) ou à une chimiothérapie séquentielle<br />
à haute dose avec transplantation<br />
autologue de cellules souches (HDCT).<br />
Dans certaines situations, une thérapie de<br />
sauvetage unique peut aussi être indiquée<br />
(p. ex. Growing Teratoma).<br />
Annonce<br />
«Lors du choix du média,<br />
nous veillons à la qualité, au taux<br />
de pénétration et à l’impact.<br />
La certification Q nous aide<br />
dans cette démarche.»<br />
ANJA HÄNNI<br />
Head of Print, Radio, OOH, dentsu Switzerland<br />
Vos annonces avec un impact maximal<br />
32<br />
vsao_haenni_1_2_quer_fr.indd 1 24.03.<strong>2022</strong> 09:48:26<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Le choix du traitement pour chaque<br />
patient dépend du moment où survient la<br />
récidive et de certains facteurs de risque.<br />
Suivant ces facteurs de risque, on distingue<br />
cinq catégories pronostiques avec<br />
une survie sans progression sur deux ans<br />
qui varie en fonction du cas [15].<br />
Thérapie de sauvetage conventionnelle<br />
au cisplatine<br />
Les schémas combinent la cisplatine et<br />
l’ifosfamide soit avec l’étoposide (PEI), la<br />
vinblastine (VeIP) ou le paclitaxel (TIP),<br />
sans supériorité établie pour une combinaison<br />
thérapeutique. La chimiothérapie<br />
combinée standard prévoit l’administration<br />
de quatre cycles, espacés de 21 jours<br />
(voir tableau 3).<br />
Chimiothérapie séquentielle à haute<br />
dose avec transplantation autologue<br />
de cellules souches (HDCT)<br />
La combinaison du carboplatine et de l’étoposide<br />
(CE) forme la base de la combinaison<br />
HDCT. Presque tous les centres dans le<br />
Tableau 3. Chimiothérapie conventionnelle dans la thérapie de sauvetage<br />
monde l’utilisent aujourd’hui sous forme<br />
de thérapie séquentielle avec deux à trois<br />
cycles à haute dose de CE (voir tableau 4).<br />
L’importance de la HDCT lors de la<br />
première récidive reste controversée et<br />
fait actuellement l’objet de discussions.<br />
Une analyse d’un sous-groupe dans une<br />
étude rétrospective de près de 1600 jeux de<br />
données de patients sous thérapie de sauvetage<br />
primaire a permis de démontrer un<br />
avantage en faveur de la HDCT par rapport<br />
à la CDCT. Ces résultats sont contraires<br />
aux données d’une étude prospective et<br />
randomisée qui n’a pas permis de mettre<br />
en évidence un avantage clair pour la<br />
HDCT lors de la première récidive [16, 17].<br />
Dans le cadre d’une étude mondiale<br />
randomisée de phase III, qui compare le<br />
traitement conventionnel au TIP versus<br />
une chimiothérapie séquentielle à haute<br />
dose (CE) (TIGER), le bénéfice de la HDCT<br />
lors de la première récidive est actuellement<br />
validé de manière prospective. Les<br />
patients en Suisse peuvent aussi être inclus<br />
dans cette étude.<br />
PEI (répétition jour 22) 4 cycles<br />
Cisplatine 20 mg/m² jour 1 à 5<br />
Ifosfamide 1,2 g/m² jour 1 à 5<br />
Etoposide 75 mg/m² jour 1 à 5<br />
TIP (répétition jour 22) 4 cycles<br />
Cisplatine 20 mg/m² jour 1 à 5<br />
Ifosfamide 1,2 g/m² jour 1 à 5<br />
Paclitaxel 250 mg jour 1<br />
VeIP (répétition jour 22) 4 cycles<br />
Cisplatine 20 mg/m² jour 1 à 5<br />
Ifosfamide 1,2 g/m² jour 1 à 5<br />
Vinblastine 0,11 mg/kg jour 1 et 2<br />
Tableau 4. Chimiothérapie à haute dose avec transplantation autologue de cellules souches<br />
et stratégie de traitement<br />
Type Profil de risque Régime HD Médicaments<br />
Première<br />
intention –<br />
maladie<br />
métastatique<br />
Maladie<br />
métastatique<br />
récidivante<br />
A évaluer en cas de<br />
– baisse inadéquate des<br />
marqueurs<br />
– tumeur non séminomateuse<br />
primaire médiastinale<br />
– métastases disséminées dans<br />
le SNC/foie/osseuses<br />
– première récidive après<br />
chimiothérapie combinée<br />
– deuxième récidive ou<br />
récidive consécutive<br />
HD-PEI<br />
HD-CE<br />
Cisplatine<br />
Etoposide<br />
Ifosfamide<br />
Carboplatine<br />
Etoposide<br />
Lors d’une deuxième récidive ou récidive<br />
consécutive, la HDCT permet encore<br />
d’obtenir une rémission à long terme. La<br />
taille et l’hétérogénéité des groupes de patients<br />
étudiés rendent cependant difficile<br />
l’interprétation des résultats d’étude disponibles.<br />
Globalement, il semble que<br />
seule une petite minorité des patients<br />
peut profiter à long terme de l’utilisation<br />
d’une HDCT [18].<br />
Traitement palliatif<br />
Les patients avec de multiples récidives ou<br />
les patients avec récidives après une<br />
chimiothérapie à haute dose ne guérissent<br />
que rarement. Grâce à l’utilisation adaptée<br />
de la chimiothérapie palliative, éventuellement<br />
avec une résection tumorale palliative<br />
ou aussi une radiothérapie palliative, il est<br />
souvent possible d’atténuer les symptômes<br />
et d’améliorer la qualité de vie des patients.<br />
Outre le paclitaxel, les substances oxaliplatine<br />
et gemcitabine sont efficaces et<br />
utilisées soit à titre individuel ou dans différentes<br />
combinaisons. Ces substances<br />
permettent à certains patients, même en<br />
cas de récidive après une HDCT, de bénéficier<br />
d’une rémission à plus long terme. Une<br />
efficacité palliative a également été démontrée<br />
pour l’utilisation d’étoposide orale.<br />
On ne dispose jusqu’ici hélas d’aucune<br />
alternative efficace à la chimiothérapie, en<br />
particulier les inhibiteurs de la tyrosinkinase<br />
et les inhibiteurs de points de contrôle<br />
immunitaire n’ont pas montré d’efficacité<br />
dans des études cliniques [2, 20, 21].<br />
Message à retenir<br />
––<br />
La tumeur germinale est la tumeur la<br />
plus fréquente du jeune homme.<br />
––<br />
A un stade métastatique, la classification<br />
se fait dans trois groupes pronostiques,<br />
favorable, intermédiaire et défavorable,<br />
suivant l’élévation des taux de marqueurs<br />
et l’implication viscérale.<br />
––<br />
La chimiothérapie au PEB reste le traitement<br />
standard pour les tumeurs métastatiques.<br />
A titre alternatif, on peut utiliser<br />
un PE ou PEI.<br />
––<br />
Le nombre de cycles dans le traitement<br />
primaire est déterminé en fonction du<br />
groupe pronostique.<br />
––<br />
Pour les tumeurs non séminomateuses,<br />
la résection de la tumeur résiduelle est<br />
obligatoire pour les résidus >1 cm.<br />
––<br />
Dans la situation de sauvetage, on effectuera<br />
soit la chimiothérapie conventionnelle<br />
soit la chimiothérapie à haute dose<br />
avec support autologue de cellules<br />
souches.<br />
›<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 33
Perspectives<br />
Bibliographie<br />
[1] Beyer J, Berthold D,<br />
Bode KP, et al. Swiss germ-cell<br />
cancer consensus recommendations.<br />
Swiss Med Wkly 2021; 151:<br />
w30023.<br />
[2] ESMO Consensus<br />
Conference on testicular germ cell<br />
cancer: diagnosis, treatment and<br />
follow-up. Honecker F, Aparicio J,<br />
Berney D, Beyer J, Bokemeyer C,<br />
Cathomas R, Clarke N, Cohn-Cedermark<br />
G, Daugaard G, Dieckmann<br />
KP, Fizazi K, Fosså S,<br />
Germa-Lluch JR, Giannatempo P,<br />
Gietema JA, Gillessen S, Haugnes<br />
HS, Heidenreich A, Hemminki K,<br />
Huddart R, Jewett MAS, Joly F,<br />
Lauritsen J, Lorch A, Necchi A,<br />
Nicolai N, Oing C, Oldenburg J,<br />
Ondruš D, Papachristofilou A,<br />
Powles T, Sohaib A, Ståhl O,<br />
Tandstad T, Toner G, Horwich A.<br />
Ann Oncol. 2018 Aug 1; 29(8):<br />
1658–1686.<br />
[3] Chung P, Daugaard G,<br />
Tyldesley S, et al. Evaluation of a<br />
prognostic model for risk of relapse<br />
in stage I seminoma surveillance.<br />
Cancer Med 2015; 1: 155–160.<br />
[4] Daugaard G, Gundgaard<br />
MG, Mortensen MS, et al.<br />
Surveillance for stage I <strong>No</strong>nseminoma<br />
testicular cancer: outcomes<br />
and long-term follow-up in a<br />
population-based cohort. J Clin<br />
Oncol 2014; 32: 3817–3823.<br />
[5] International Germ Cell<br />
Consensus Classification: a<br />
prognostic factor-based staging<br />
system for metastatic germ cell<br />
cancers. International Germ Cell<br />
Cancer Collaborative Group. J Clin<br />
Oncol 15: 594–603, 1997.<br />
[6] Gillessen S, Sauve N,<br />
Collette L, et al. Predicting<br />
outcomes in men with metastatic<br />
nonseminomatous germ cell<br />
tumors (NSGCT): results from the<br />
IGCCCG Update Consortium. J Clin<br />
Oncol 2021; 39: 1563–1574.<br />
[7] Beyer J, Collette L,<br />
Sauvé N, et al. Survival and new<br />
prognosticators in metastatic seminoma:<br />
results from the IGCC-<br />
CG-Update Consortium. J Clin<br />
Oncol 2021; 39: 1553–1562.<br />
[8] Onkopedia Leitlinien<br />
Keimzelltumoren des Mannes:<br />
www.onkopedia.com<br />
[9] Fizazi K, Pagliaro L,<br />
Laplanche A, et al.: Personalised<br />
chemotherapy based on tumour<br />
marker decline in poor prognosis<br />
germ-cell tumours (GETUG 13): a<br />
phase 3, multicentre, randomised<br />
trial. Lancet Oncol 15: 1442–1450,<br />
2014.<br />
[10] Paclitaxel, Ifosfamide,<br />
and Cisplatin Efficacy for<br />
First-Line Treatment of Patients<br />
With Intermediate- or Poor-Risk<br />
Germ Cell Tumors. Feldman DR,<br />
Hu J, Dorff TB, Lim K, Patil S, Woo<br />
KM, Carousso M, Hughes A,<br />
Sheinfeld J, Bains M, Daneshmand<br />
S, Ketchens C, Bajorin DF, Bosl GJ,<br />
Quinn DI, Motzer RJ.J Clin Oncol.<br />
2016 Jul 20; 34(21): 2478–83. doi:<br />
10.1200/JCO.2016.66.7899. Epub<br />
2016 May 16. PMID: 27185842.<br />
[11] Motzer RJ, Nichols CJ,<br />
Margolin KA, et al.: Phase III<br />
randomized trial of conventionaldose<br />
chemotherapy with or<br />
without high-dose chemotherapy<br />
and autologous hematopoietic<br />
stem-cell rescue as first-line<br />
treatment for patients with<br />
poor-prognosis metastatic germ<br />
cell tumors. J Clin Oncol 25:<br />
247–256, 2007.<br />
[12] Daugaard G, Skoneczna<br />
I, Aass N, et al.: A randomized<br />
phase III study comparing<br />
standard dose BEP with sequential<br />
high-dose cisplatin, etoposide, and<br />
ifosfamide (VIP) plus stem-cell<br />
support in males with poor-prognosis<br />
germ-cell cancer. An<br />
intergroup study of EORTC,<br />
GTCSG, and Grupo Germinal<br />
(EORTC 30974). Ann Oncol 22:<br />
1054–1061, 2011.<br />
[13] Questioning the Value<br />
of Fluorodeoxyglucose Positron<br />
Emission Tomography for Residual<br />
Lesions After Chemotherapy for<br />
Metastatic Seminoma: Results of<br />
an International Global Germ Cell<br />
Cancer Group Registry. Cathomas<br />
R, Klingbiel D, Bernard B, Lorch A,<br />
Garcia Del Muro X, Morelli F, De<br />
Giorgi U, Fedyanin M, Oing C,<br />
Haugnes HS, Hentrich M,<br />
Fankhauser C, Gillessen S, Beyer J.<br />
J Clin Oncol. 2018 Oct 4:<br />
JCO1800210. doi: 10.1200/<br />
JCO.18.00210.<br />
[14] Heidenreich A: Residual<br />
tumour resection following<br />
inductive chemotherapy in<br />
advanced testicular cancer. Eur<br />
Urol 51: 299–301, 2007.<br />
[15] Prognostic Factors in<br />
Patients With Metastatic Germ Cell<br />
Tumors Who Experienced<br />
Treatment Failure With Cisplatin-Based<br />
First-Line Chemotherapy.<br />
J Clin Oncol 28: 4906–4911,<br />
2010.<br />
[16] Lorch A, Bascoul-<br />
Mollevi C, Kramar A, et al.:<br />
Conventional-dose versus<br />
high-dose chemotherapy as first<br />
salvage treatment in male patients<br />
with metastatic germ cell tumors:<br />
evidence from a large international<br />
database. J Clin Oncol 29:<br />
2178–2184, 2011.<br />
[17] Pico JL, Rosti G, Kramar<br />
A, et al.: A randomised trial of<br />
high-dose chemotherapy in the<br />
salvage treatment of patients<br />
failing first-line platinum<br />
chemotherapy for advanced germ<br />
cell tumours. Ann Oncol 16:<br />
1152–1159, 2005.<br />
[18] High-Dose Chemotherapy<br />
and Autologous Peripheral-Blood<br />
Stem-Cell Transplantation<br />
for Relapsed Metastatic Germ<br />
Cell Tumors: The Indiana<br />
University Experience. Adra N,<br />
Abonour R, Althouse SK, Albany C,<br />
Hanna NH, Einhorn LH. J Clin<br />
Oncol. 2017 Apr 1; 35(10):<br />
1096–1102. doi: 10.1200/<br />
JCO.2016.69.5395. Epub 2016 <strong>No</strong>v<br />
21. PMID: 27870561.<br />
[19] Guidelines on Testicular<br />
Cancer: 2015 Update. Albers P,<br />
Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer<br />
C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K,<br />
Horwich A, Laguna MP, Nicolai N,<br />
Oldenburg J. European Association<br />
of Urology.Eur Urol. 2015 Dec;<br />
68(6): 1054–68. doi: 10.1016/j.<br />
eururo.2015.07.044. Epub 2015 Aug<br />
18. PMID: 2629760.<br />
[20] Bokemeyer C, Oechsle<br />
K, Honecker F, et al. Combination<br />
chemotherapy with gemcitabine,<br />
oxaliplatin, and paclitaxel in<br />
patients with cisplatin-refractory<br />
or multiply relapsed germ-cell<br />
tumors: a study of the German<br />
Testicular Cancer Study Group.<br />
Ann Oncol 19: 448–453, 2008.<br />
[21] Oing C, Giannatempo P,<br />
Honecker F, et al. Palliative<br />
treatment of germ cell cancer.<br />
Cancer Treat Rev 2018; 71: 102–107<br />
Contact:<br />
anja.lorch@usz.ch<br />
Il n’y a pas de conflits d’intérêts pour cet article.<br />
34<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Aus der «Therapeutischen Umschau»* – Übersichtsarbeit<br />
Pathologie<br />
von Infektionskrankheiten<br />
Daniel Turek, Anne Graber, Ronny Nienhold und Gieri Cathomas<br />
Institut für Pathologie des Kantonsspitals Baselland, Liestal, Schweiz<br />
* Der Artikel erschien ursprünglich in der<br />
«Therapeutischen Umschau» (2019), 76(7),<br />
391–396. mediservice vsao-Mitglieder können<br />
die «Therapeutische Umschau» zu äusserst<br />
günstigen Konditionen abonnieren. Details<br />
s. unter www.hogrefe.ch/downloads/vsao.<br />
Die Diagnose von Infektionen<br />
ist ein integraler Bestandteil<br />
der Pathologie und Pathologinnen<br />
und Pathologen sind<br />
in ihrer diagnostischen Tätigkeit täglich<br />
mit der Frage nach einem möglichen<br />
Infekt konfrontiert. Die Dominanz der<br />
wichtigen und zunehmend komplexer<br />
werdenden Diagnostik von Tumorerkrankungen<br />
auf der einen Seite und<br />
die Organorientierung der Pathologie auf<br />
der anderen Seite führt dazu, dass die<br />
Möglichkeiten der Infektionsdiagnostik<br />
in der Pathologie weniger wahrgenommen<br />
und manchmal unterschätzt werden.<br />
Dazu kommt, dass im Alltag der<br />
Erregernachweis natürlich primär durch<br />
die Mikrobiologie erbracht wird, welche<br />
zusätzlich auch die wichtige Resistenzprüfung<br />
für die verschiedenen antiinfektiösen<br />
Medi kamente durchführt. Die<br />
häufigsten Untersuchungsma terialien<br />
sind Körperflüssigkeiten wie Urin oder<br />
Stuhl, Abstriche, Spülungen oder Blut,<br />
dies häufig auch ohne einen offensichtlichen<br />
Herdbefund bei infektionsverdächtigen<br />
Allgemeinsymptomen. Die Pathologie<br />
kommt im Allgemeinen erst ins Spiel,<br />
wenn Gewebsproben entnommen werden,<br />
meistens nachdem sich eine erkennbare<br />
Läsion ausgebildet hat. Dazu kommen<br />
aber auch zytologische Proben wie<br />
Punktionen oder Lavagen, welche als<br />
Untersuchungsmaterial sowohl von der<br />
Pathologie wie auch von der Mikrobiologie<br />
verwendet werden können.<br />
Historisch gesehen haben beide, Pathologie<br />
und Mikrobiologie, einen gemeinsamen<br />
Ursprung; erinnert sei hier<br />
nur kurz an Edwin Klebs (1834 – 1913) der<br />
also Ordinarius für Pathologie in Zürich<br />
und Bern als erster den Hypophysentumor<br />
bei einem Patienten mit Akromegalie<br />
beschrieb, aber besser bekannt ist als<br />
Beschreiber und Namensgeber des Bakteriums<br />
Klebsiella. Aber auch nach der Auftrennung<br />
der beiden Fächer hat die Pathologie<br />
von Infektionskrankheiten immer<br />
wieder wegweisende Erkenntnisse bei der<br />
Entdeckung von Erkrankungen erbracht,<br />
erinnert sei dabei z. B. an die Entdeckung<br />
und Beschreibung von AIDS, bei der die<br />
Befunde aus der Pathologie, nicht zuletzt<br />
gewonnen an Autopsien, wesentlich zum<br />
Verständnis dieser komplexen Erkrankung<br />
beigetragen haben [1].<br />
Die Besonderheit der Diagnostik von<br />
Infektionskrankheiten in der Pathologie<br />
beruht auf der gleichzeitigen Beurteilung<br />
der entzündlichen Reaktion mit einem<br />
allfälligen Erregernachweis [2]. Dies ist<br />
die grosse Stärke der Pathologie, weil erst<br />
durch die Kombination von Erregernachweis<br />
und Entzündungsreaktion die krankmachende<br />
Wirkung des Erregers untermauert<br />
wird. Dies ist heute nicht zuletzt<br />
deshalb besonders wichtig, weil durch<br />
hochempfindliche Nachweismethoden<br />
von Erregern oder auch Erregerbestandteilen<br />
der kausale Zusammenhang dieses<br />
Nachweises mit einer gegebenen Erkrankung<br />
schwierig sein kann. Dies lässt sich<br />
eindrücklich an einem aktuellen Beispiel,<br />
nämlich der Erkrankung durch Zika-Viren<br />
veranschaulichen, bei welcher die Epidemiologie<br />
zwar den dringenden Verdacht<br />
eines Zusammenhanges zwischen dem<br />
Virus und dem Auftreten von Hirnmissbildungen<br />
ergab, aber erst der direkte Erregernachweis<br />
in dem erkrankten Hirngewebe<br />
den abschliessenden Beweis erbringen<br />
konnte [3].<br />
Ausgangspunkt Entzündung<br />
Eine Entzündung im Gewebe ist ein wichtiges<br />
Verdachtsmoment für einen Infekt.<br />
Natürlich können eine Reihe von anderen<br />
schädigenden Einwirkungen auf das Gewebe<br />
zu entzündlichen Veränderungen<br />
führen, namentlich ischämische Gewebsschädigungen,<br />
physikalischen Einwirkungen<br />
wie Verletzungen oder Verätzungen<br />
und auch endogene Entzündungsreaktionen,<br />
z. B. im Rahmen einer Autoimmunerkrankung.<br />
Ausserdem muss v. a. im Bereich<br />
der Schleimhäute wie im Magen-<br />
Darm-Trakt oder in der Lunge das physiologische<br />
Infiltrat von Entzündungszellen,<br />
welche das Gleichgewicht zwischen unserem<br />
Mikrobiom auf der einen Seite und<br />
unserem Körper auf der anderen Seite, aufrechterhält,<br />
von pathologischen, krankmachenden<br />
Entzündungsinfiltraten abgegrenzt<br />
werden.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 35
Perspectives<br />
Die Art des Entzündungsinfiltrates<br />
gibt erste und wichtige Hinweise, welche<br />
Rückschlüsse auf einen möglichen Erreger<br />
erlauben (Tabelle 1). Am häufigsten<br />
findet sich eine granulozytär-eitrige Entzündung,<br />
sei es in Form eines einschmelzenden<br />
Abszesses, sei es in einer mehr infiltrativen,<br />
phlegmonösen Form. Ursächlich<br />
liegen hier meistens Bakterien vor,<br />
häufig die typischen Eitererregen Staphylokokken<br />
oder Streptokokken, aber auch,<br />
abhängig von der Körperregion, gramnegative<br />
Keime, v. a. der Darmflora wie E. coli<br />
oder Klebsiellen. Eine granulozytäre Entzündung<br />
weckt immer den Verdacht auf<br />
einen Infekt, dies namentlich in primär<br />
sterilen Geweben wie parenchymatösen<br />
Organen. In gewissen Situationen können<br />
sogar schon kleinste Mengen von neutrophilen<br />
Granulozyten Hinweise auf einen<br />
bakteriellen Infekt sein, dies ist typischerweise<br />
bei periprothetischen Membranen<br />
nach Gelenksprothesen der Fall, wo bereits<br />
eine limitierte Zahl von Granulozyten<br />
ein guter Indikator für einen chronischen<br />
bakteriellen Protheseninfekt ist.<br />
Granulozyten sind die Entzündungszellen<br />
des akuten Infekts. Demgegenüber<br />
sind eosinophile Leukozyten Ausdruck einer<br />
chronischen Entzündung und bei gewissen<br />
Parasiten vermehrt wie z. B. Schistosomen<br />
oder Coccidioides (Abbildung 1).<br />
Natürlich zeigen entzündliche Infiltrate<br />
immer einen gewissen gemischten Charakter,<br />
aber meistens findet sich ein prädominanter<br />
Zelltyp wie z. B. die eosinophilen<br />
Granulozyten. Herdförmige Ansammlungen<br />
von eosinophilen Leukozyten sollten<br />
den Pathologen dazu veranlassen, weitere<br />
Stufenschnitte durchzuführen (weiteres<br />
Gewebe zu untersuchen), um keine Parasitenlarven<br />
zu verpassen. Die wichtigste Differentialdiagnose<br />
ist eine allergische Reaktion;<br />
diese kann ihre Ursache aber auch<br />
in einem persistierenden Infekt haben, wie<br />
z. B. bei der allergischen Aspergillose der<br />
Nasennebenhöhle.<br />
Ein Entzündungsinfiltrat, welches<br />
von Lymphozyten mit mehr oder weniger<br />
Plasmazellen dominiert wird, eine s. g.<br />
lymphoplasmozelluläre Entzündung, ist<br />
charakteristisch für einen chronischen Infekt.<br />
Eine spezielle Form ist die chronisch-aktive<br />
Entzündung, bei welcher sowohl<br />
das lymphoplasmozelluläre Entzündungsinfiltrat<br />
wie auch eine granulozytäre<br />
Komponente vorliegt. Dieses Muster findet<br />
sich z. B. bei einer Helicobacter-Gastritis<br />
mit der typischen Verteilung und einer<br />
chronisch-aktiven Entzündung mit oder<br />
ohne Lymphfollikel. Finden sich bei diesem<br />
histologischen Bild keine Bakterien,<br />
lohnt sich eine Zusatzuntersuchung mit<br />
z. B. einer Polymerasen Ketten Reaktion<br />
(PCR). In eigenen Untersuchungen konnten<br />
wir in diesen Fällen in 20 bis 50 % die<br />
Abbildung 1. Nachweis von Entzündung und Erregern: A: Schistosomen-Ei mit ausgeprägter<br />
eosinophiler Begleitentzündung (H&E-färbung). B: Cladophialophora bantiana, ein pigmentierter Pilz,<br />
welcher zu einem Hirnabszess mit granulomatöser Reaktion führte (PAS-Färbung).<br />
Tabelle 1. Typische Entzündungsmuster im Gewebe bei verschiedenen Infektionen.<br />
Vorherrschendes Entzündungsinfiltrat Häufiges Vorkommen Selteneres Vorkommen<br />
Neutrophile Granulozyten<br />
• Bakterielle Infektionen<br />
• Pilzinfekte<br />
• Mykobakteriosen<br />
(v.a. schnell wachsende Mykobakterien,<br />
z.B. Mycobaterium fortuitum)<br />
Eosinophile Granulozyten • Parasitosen (v. a. Würmer) • Pilzinfektion (z.B. Aspergillom)<br />
Lymphozyten / Plasmazellen<br />
Granulomatöse Entzündung<br />
• Virusinfekte<br />
• Treponematosen (Syphilis, Borreliose)<br />
• Chronische bakterielle Infektionen<br />
(z.B. Helicobactergastritis)<br />
• Mykobakteriosen (Tuberkulose, Lepra)<br />
• Bartonellose (Katzenkratz-Krankheit)<br />
• Tularämie (Hasenpest)<br />
• Brucellose<br />
• Lymphogranuloma venereum<br />
• Pilzinfektion (z.B. Histoplasmose,<br />
Blastomykose)<br />
• Schistostomiasis<br />
• Nicht-infektiöse Ursachen<br />
(Morbus Crohn, Fremdkörper,<br />
Sarkoidose)<br />
36<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
ser negativen Biopsien mittels PCR Helicobacter-DNA<br />
als Ausdruck einer bakteriellen<br />
okkulten Gastritis nachweisen [4, 5].<br />
Granulomatöse Entzündung<br />
Die granulomatöse Entzündung verdient<br />
eine eigene Betrachtung, da sie einerseits<br />
nur histologisch verifiziert werden kann,<br />
andererseits gewisse klinische Schlussfolgerungen<br />
nach sich zieht. In der Radiologie<br />
wird traditionell der Begriff Granulome<br />
auch verwendet, allerdings können<br />
sich dahinter, neben eigentlichen Granulomen,<br />
verschiedene andere Veränderungen<br />
verbergen, nicht zuletzt auch Tumoren<br />
und Metastasen. Granulome sind<br />
definiert als knötchenförmige Ansammlungen<br />
von Histiozyten, Epitheloidzellen<br />
mit den charakteristischen «schuhsohlenförmigen»<br />
Kernen, mit oder ohne Riesenzellen<br />
sowie mit oder ohne Nekrosen. Dazu<br />
kann ein lymphozytärer Randsaum das<br />
Knötchen abgrenzen. Die Differenzialdiagnose<br />
einer granulomatösen Entzündung<br />
ist breit, sie umfasst neben Infekten andere<br />
Ursachen wie die Sarkoidose oder den<br />
Morbus Crohn im Darm. Bei der Beurteilung<br />
der Granulome spielen die Nekrosen<br />
in der Differentialdia gnose eine wichtige<br />
Rolle. Granulome mit Nekrosen sind<br />
v erdächtig auf einen Infekt, bei der azellulären<br />
Nekrose (makroskopisch käsige<br />
Nekrose) natürlich besonders auf eine<br />
Tuberkulose. Ist die Nekrose granulozytär<br />
(suppurativ) oder mit einer starken Beteiligung<br />
von eosinophilen Leukozyten charakterisiert,<br />
besteht ein erhöhter Verdacht<br />
auf einen Infekt, welcher sowohl bakteriell<br />
als auch z. B. durch Pilze bedingt sein<br />
kann. Ein solches Bild mit einer suppurativen,<br />
zentralen Nekrose zeigt typischerweise<br />
die Tularämie. Vor einigen Jahren<br />
haben wir an unserem Institut einen ersten<br />
Fall von Tularämie, den wir dank der<br />
Zusatzuntersuchungen (vgl. rechts) als<br />
solche beweisen konnten, diagnostiziert<br />
und im Laufe der letzten Jahre haben wir<br />
über 30 Fälle mit Tularämie aus der ganzen<br />
Schweiz an unserem Institut in der<br />
Histologie mit dem entsprechenden Erregernachweis<br />
diagnostizieren können (Abbildungen<br />
2, 3).<br />
Abbildung 2. Granulomatöse Lymphadenitis bei Tularämie: A: Übersicht des Lymphknotens mit<br />
ausgedehnter Nekrose mit Detritus und Granulozyten. B: Detail mit Nekrose und granulomatöser<br />
Reaktion (Färbung H&E). In der PCR-Untersuchung wurde Francisella tularensis holarctica<br />
nachgewiesen.<br />
140<br />
120<br />
120<br />
100<br />
100<br />
80<br />
80<br />
60<br />
40 60<br />
20<br />
40<br />
0<br />
20<br />
0<br />
14 14<br />
3 1 3 1<br />
28<br />
Abbildung 3. Nachweis der Tularämie-Fälle von 2010 – 2019 (Stand 30.9.) in der Schweiz und am<br />
Institut für Pathologie des Kantonsspital Basel-Land.<br />
41<br />
41<br />
28<br />
38<br />
38<br />
5<br />
50<br />
1 2<br />
57<br />
131 131<br />
9<br />
121<br />
121<br />
3 5<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
14 14<br />
9<br />
hausintern diagnostizierte und gemeldete Fälle<br />
3<br />
1<br />
3<br />
5<br />
1<br />
1 2<br />
3<br />
5<br />
gemeldete Fälle gesamte Schweiz<br />
2010 2011 2012 hausintern 2013 diagnostizierte 2014 und 2015gemeldete 2016 Fälle 2017 2018 2019<br />
hausintern diagnostizierte gemeldete und Fälle gemeldete gesamte Fälle Schweizgemeldete Fälle gesamte Schweiz<br />
50<br />
57<br />
95<br />
Der morphologische Erregernachweis<br />
im Gewebe<br />
Wie aufgeführt basiert die Diagnose einer<br />
Infektionskrankheit in der Histologie auf<br />
dem gleichzeitigen Nachweis einer Entzündungsreaktion<br />
und dem Erreger. Der<br />
Erregernachweis ist einerseits abhängig<br />
von der Grösse des Erregers und der Anfärbbarkeit,<br />
ausserdem führt eine heftige<br />
Entzündungsreaktion schnell zu einer<br />
Zerstörung des Erregers, was unter Umständen<br />
den Nachweis schwierig macht.<br />
Die häufigsten Erreger, die Bakterien, sind<br />
auch von ihrer Grösse her in der konventionellen<br />
Histologie (und speziell auch für<br />
den / die Pathologen / in, der / die meistens<br />
mit Trockenobjektiven, maximal 400fache<br />
Vergrösserung arbeitet) an der Grenze<br />
der Nachweisbarkeit. Allerdings gibt es<br />
auch sehr charakterische Morphologien,<br />
95<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 37
Perspectives<br />
namentlich die bereits erwähnten Helicobacter-Bakterien,<br />
die morphologisch eindeutig<br />
nachgewiesen werden können.<br />
Andere Beispiele sind die intestinale<br />
Spirochätose oder Aktinomyzes-Drusen.<br />
Grundsätzlich sind auch Spezialfärbungen<br />
möglich, namentlich eine Gramfärbung,<br />
welche eine Unterscheidung zwischen<br />
grampositiven und gramnegativen<br />
Bakterien erlaubt, die Unterscheidung<br />
allerdings und die Spezifi zierung v. a. der<br />
gramnegativen Bakterien, ist schwierig.<br />
Selbstverständlich kommen auch Spezialfärbungen<br />
zum Einsatz, namentlich die<br />
modifizierte Ziehl-Neelson Färbung für<br />
Mykobakterien. Bei der Tuberkulose sind<br />
allerdings meistens nur wenige Keime<br />
vorhanden und der Nachweis ist wenig zuverlässig,<br />
hier haben Spezialuntersuchungen<br />
wie die PCR heute eine wichtige Funktion.<br />
Dem gegenüber sind Pilze häufig gut<br />
erkennbar, v. a. die Fadenpilze wie Aspergillus<br />
oder Mucorales, allerdings sollten<br />
hier Zusatzfärbungen wie die PAS-Färbungen<br />
oder Versilberungen (z. B. Groccott)<br />
zur Anwendung kommen (Abbildung<br />
1). Die Morphologie, unterteilt nach<br />
Hefen oder Fadenpilzen, erlaubt durchaus<br />
eine Einteilung, die Subspezies ist allerdings<br />
morphologisch häufig nicht mit Sicherheit<br />
diagnos tizierbar. Dazu kommen<br />
v. a. bei Nekrosen degenerative Veränderungen,<br />
welche die morphologische Beurteilung<br />
zusätzlich erschweren. Parasiten<br />
wie Protozoen oder Helminthen sind in<br />
der Histologie meistens gut und erkennbar<br />
und zu diagnostizieren. Die Form erlaubt<br />
häufig eine Diagnose, allerdings ist<br />
hier der fokale Befall zu berücksichtigen<br />
und Stufenschnitte sind notwendig, die<br />
Erreger nachzuweisen. Die kleinsten Erreger<br />
schliesslich, die Viren, entziehen sich<br />
grundsätzlich der Visualisierung durch<br />
das Lichtmikroskop, da sie aber obligat intrazelluläre<br />
Keime sind, welche häufig zu<br />
sekundären Zellveränderungen führen<br />
(zytopathogener Effekt) lassen sich Viruserkrankungen<br />
zum Teil sehr gut und genau<br />
diagnostizieren. Dazu gehören die<br />
Herpesviren, namentlich Herpes simplex<br />
oder zoster, die Infektion mit dem humanen<br />
Papilloma-Virus (HPV), aber auch andere<br />
wie z. B. Parvoviren. Die wichtigste<br />
und die am besten etablierte Technik zum<br />
Nachweis von Erregern am Gewebe, welche<br />
gleichzeitig erlaubt, die Morphologie<br />
zu beurteilen, ist die Immunhistochemie.<br />
Es gibt eine, allerdings begrenzte, Reihe<br />
von kommerziell erhält lichen Antikörpern,<br />
welche am formalinfixierten und in<br />
Paraffin eingebetteten Material verwendet<br />
38<br />
Abbildung 4. Ausschnitt aus der Histologie eines Condyloma lata: A. Hyperkeratose und chronisch-aktive<br />
Entzündung (H&E Färbung). B: Immunhistochemische Darstellung von Treponema<br />
pallidum, typischerweise entlang den Desmosomen der Plattenepithelien (rot).<br />
werden können. Bewährt haben sich Antikörper<br />
gegen die gängigen Viren wie Herpes<br />
simplex, Hepatitis B oder Varizellen,<br />
für andere Erreger gibt es nach wie vor<br />
keine zuverlässigen Antikörper (z. B. Hepatitis<br />
C), nicht zuletzt, weil ein Markt für<br />
diese Reagenzien relativ klein ist. Auch<br />
für gewisse Bakterien gibt es gut funktionierende<br />
Antikörper, namentlich für<br />
Treponemen (erfasst Spirochäten und<br />
T. pallidum) oder für Helicobacter (Abbildung<br />
4). Weniger zuverlässig und auch<br />
weniger gebräuchlich ist die Immunhistochemie<br />
für Pilze, weil diese meistens eine<br />
ungenügende Spezifität aufweisen. Kaum<br />
erhältlich, da die Morphologie häufig ausreicht,<br />
ist die Immunhistochemie für Protozoen<br />
oder andere Parasiten.<br />
Molekulare Diagnostik<br />
und integrierte Diagnose<br />
Wie überall in der Pathologie hat sich auch<br />
in der Diagnostik von Infektionskrankheiten<br />
in den letzten Jahrzehnten die molekulare<br />
Diagnostik als wichtige Zusatzuntersuchung<br />
etabliert. Wegen der hohen<br />
Empfindlichkeit haben sich v. a. PCR-Untersuchungen<br />
zum Nachweis von Erreger<br />
Nukleinsäure, v. a. von DNA und in geringem<br />
Ausmass auch von RNA, durchgesetzt.<br />
Das Institut für Pathologie des Kantonsspital<br />
Baselland hat in den letzten 20 Jahren<br />
mehrere tausend PCR-Untersuchungen<br />
für Erreger durchgeführt, z. B. mit der<br />
Frage nach Mykobakterien, aber auch einer<br />
Reihe andere Erreger welche zum Teil<br />
schwierig oder nicht züchtbar sind wie<br />
Tropheryma whipplei, Treponema pallidum<br />
oder M. leprae. Ebenfalls mit der<br />
PCR wurde die oben aufgeführte Tularämie<br />
bestätigt. Dabei kommt ein weiterer<br />
Vorteil der Pathologie zum Tragen, dass<br />
nämlich für die Diagnose keine Anzüchtung<br />
der Bakterien notwendig ist, was bei<br />
Francisella tularensis erhöhte Sicherheitsvorkehrung<br />
erfordert. Ausserdem erlaubt<br />
die PCR nicht nur den Nachweis von<br />
Erreger-DNA, sondern es ist auch möglich,<br />
Untersuchungen auf Resistenz-Gene<br />
durchzuführen, z. B. bei Helicobacter-Bakterien.<br />
Die Untersuchung am formalinfixierten<br />
und in Paraffin eingebetteten<br />
Material unterscheidet sich von Analysen<br />
anderer Untersuchungsmaterialien. DNA<br />
aus paraffineingebettetem Material ist<br />
stark fragmentiert (< 250 – 300 Basen paare)<br />
und entsprechend müssen alle Essays so<br />
ausgerichtet sein, dass diese kurzen Fragmente<br />
auch erfasst werden können. Kurze<br />
Fragmente haben zusätzlich den Nachteil,<br />
dass Sequenzierungen beschränkt möglich<br />
sind und entsprechend auch die Subtypisierungen<br />
nicht immer abschliessend<br />
möglich sind. Gleichzeitig ist es sehr wichtig,<br />
dass strengste Vorsichtsmassnahmen<br />
getroffen werden, um Kontamination von<br />
vorgehenden Untersuchungen und damit<br />
falsch positive Resultate zu vermeiden.<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Schliesslich ist das molekulare Resultat<br />
immer auch mit dem morphologischen<br />
Befund zu korrelieren und abweichende<br />
oder nicht erklärbare Resultate sind zu<br />
re-evaluieren.<br />
Als weiteres Beispiel der molekularen<br />
Untersuchungen sei die PCR mit anschliessender<br />
Sequenzierung für humanpathogene<br />
Pilze erwähnt. Pilze lassen sich<br />
zwar morphologisch einordnen, die genaue<br />
Diagnose ist allerdings häufig<br />
schwierig. Je nach klinischer Situation,<br />
z. B. bei Mucor, ist es bedeutsam, eine<br />
schnelle und eindeutige Diagnose zu<br />
stellen; kann doch eine Infektion mit<br />
Mucor bei immunsupprimierten Patienten<br />
schnell fortschreiten oder sogar tödlich<br />
enden. Ausserdem kann die Anzucht<br />
der Pilze aus nativem Material mehrere<br />
Wochen dauern, bis ein abschliessendes<br />
Resultat vorliegt. Ein schnelleres Ergebnis<br />
kann die Molekularpathologie mittels<br />
der PCR und anschliessender Sanger-Sequenzierung<br />
bieten, zusätzlich erlaubt<br />
diese Technik auch die Erkennung von<br />
Mehrfachinfekten [6].<br />
Bereits 2011 wurde die ITS (internal<br />
transcribed Spacer) Region in der ribosomalen<br />
DNA als universeller Barcode für die<br />
Identifizierung von Pilzen angesehen. Diese<br />
enthält neben konservierten Regionen<br />
viele variable Bereiche, die es ermöglicht<br />
Pilze inter- und intraspezifisch zu identifizieren<br />
[7]. Im Gegensatz zur Array-Methode,<br />
die nur definierte Pilzspezies identifiziert,<br />
ist das System der PCR mit degenerierten<br />
Primern ergebnisoffen. Dadurch<br />
können neben bekannten Arten wie Aspergillus<br />
sp., Trichophyton sp. und Candida<br />
sp. auch seltenere humanpathogene Spezies<br />
wie Exophiala jeanselmei, Coccoidioides<br />
immitis oder Cladophialophora bantiana<br />
nachgewiesen werden (Abbildung 1B) [8].<br />
Die Identifizierung der Pilze mittels<br />
PCR am Institut für Pathologie des KSBL<br />
ist für Paraffinmaterial (FFPE) etabliert,<br />
das heisst, eine Diagnose ist auch noch<br />
möglich, wenn kein natives Material mehr<br />
zur Verfügung steht.<br />
Zukünftige Entwicklungen<br />
In Zukunft muss mit einer Zunahme von<br />
komplexen Infektionen gerechnet werden.<br />
Ursache dafür sind vermehrt Patienten<br />
mit Immunsuppression, sei es iatrogen<br />
medikamentös, aber auch durch die<br />
nach wie vor bestehende HIV-Infektion<br />
und die zunehmend älter werdende Bevölkerung.<br />
Dazu muss durch Migration und<br />
Flüchtlingsbewegungen, aber auch durch<br />
die klimatischen Veränderungen oder die<br />
rasante Entwicklung von Antibiotikaresistenzen<br />
vermehrt mit ungewöhnlichen<br />
und «exotischen» Infektionen gerechnet<br />
werden.<br />
Bei der Fixation mit Formalin und der<br />
anschliessenden Einbettung in Paraffin,<br />
werden sowohl die Gewebezellen als auch<br />
die Erreger in der Probe abgetötet. Ausserdem<br />
führt die Behandlung mit Formalin<br />
zur erwähnten Fragmentierung der Chromosomen<br />
und zur Bildung von Querverbindungen<br />
zwischen einzelnen DNA<br />
Fragmenten. Wegen dieser Vorbehandlung<br />
können in der Pathologie gewisse Untersuchungen<br />
wie z. B. die Massenspektrometrie-basierte<br />
Identifikation der Krankheitserreger<br />
(MALDI-TOF) nicht durchgeführt<br />
werden. Andererseits erlaubt das fixierte<br />
Material auch retrospektive Untersuchungen<br />
an archiviertem Material durchzuführen.<br />
Die PCR erlaubt relativ gut, einzelne<br />
Erreger in den Gewebsproben nachzuweisen.<br />
Der Nachteil dieser PCR-Tests ist,<br />
dass jeder Test für sich nur eine bestimmte<br />
Erregerspezies nachweisen kann. Bei histologischem<br />
Verdacht aber fehlendem Erregernachweis<br />
wäre ein breiterer, ergebnisoffener<br />
Ansatz von Vorteil. Eine Lösung<br />
für dieses Problem sind PCR-Tests, die auf<br />
Zusammenfassung<br />
ein Gen abzielen, das in allen Bakterien<br />
gleichermassen vorhanden ist das 16S rRNA<br />
Gen. Als Teil der Genkassette, die die Ribosomen<br />
codiert, ist es in jedem Bakterium<br />
vertreten. Ausserdem kann anhand der<br />
genauen DNA Sequenz des Gens die Spezies<br />
des Bakteriums ermittelt werden. Allerdings<br />
gilt hier: Je länger die analysierte<br />
DNA Sequenz ist, desto verlässlicher die<br />
Speziesbestimmung. Erneut macht in der<br />
Infektionspathologie hier die Probenverarbeitung<br />
einen Strich durch die Rechnung:<br />
DNA aus FFPE Proben ist selten lang<br />
genug um diese PCR-Tests erfolgreich einsetzen<br />
zu können.<br />
Diese Lücke kann durch Next Generation<br />
Sequencing (NGS) Technologie, auch<br />
Tiefensequenzierung genannt, geschlossen<br />
werden: In sogenannten Metagenomics<br />
NGS Tests wird die DNA Sequenz<br />
vieler kurzer Fragmente gelesen und zusammengesetzt<br />
um für eine verlässliche<br />
Speziesidentifikation zu sorgen. Weil diese<br />
Tests so entworfen sind, dass sie alle der<br />
bekannten Bakterienspezies detektieren<br />
können (aktuell über 400 000), ist die Validierung<br />
der Tests für die klinische Anwendung<br />
äusserst aufwändig. Aber die<br />
NGS Technologie kann mehr: So lassen<br />
Die gewebebasierte histopathologische und molekularpathologische Diagnostik von<br />
Infektionskrankheiten ist ein sehr spannendes interdisziplinäres Feld, das in der<br />
Wahrnehmung nicht nur der fachfremden Kolleginnen und Kollegen manchmal etwas<br />
im Schatten der Tumordiagnostik steht. Die Stärke der Pathologie im Bereich der<br />
Infektionsdia gnostik liegt jedoch in der Korrelation von Entzündungsmustern und dem<br />
direkten Erregernachweis. Zudem erlauben entsprechende Untersuchungen am Gewebe<br />
häufig eine rasche Diagnose, und Zusatzuntersuchungen, wie Immunhistochemie oder<br />
molekulare Pathologie, ermöglichen einen schnellen Erregernachweis mit einer hohen<br />
Sensitivität und Spezifität. Des Weiteren erlaubt die molekulare Untersuchung den<br />
Nachweis von Erregern, welche schwierig, gefährlich oder überhaupt nicht zu züchten<br />
sind. Es ist davon auszugehen, dass komplexe Infektionskrankheiten durch iatrogene<br />
Interventionen, Migration, Antibiotikaresistenz und Klimaveränderungen zunehmen<br />
werden und die Pathologie in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Kolleginnen<br />
und Kollegen hier weiterhin und zunehmend eine wichtige Aufgabe in der Betreuung<br />
der Patientinnen und Patienten wahrnehmen wird.<br />
Abstract: Pathology of infectious diseases<br />
The pathology of infectious diseases is an exciting interdisciplinary field, despite<br />
its niche existence that is somewhat overshadowed by tumor diagnostics. However,<br />
the strength of pathology lies in the correlation of the inflammatory patterns and<br />
pathogen detection. Moreover, corresponding tissue investigations often allow a rapid<br />
diagnosis of the disease, and additional investigations, such as immunohistochemistry<br />
or molecular pathology, enable a rapid pathogen characterization with a high sensitivity<br />
and specificity. In addition, the molecular analysis allows the detection of pathogens<br />
that are difficult, dangerous or not at all to breed. It can be assumed that complex infectious<br />
diseases will increase due to iatrogenic interventions, migration, antibiotic resistance<br />
and climate change, and that pathology, in close cooperation with its treating<br />
colleagues, will increasingly play an important role in the care of patients.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 39
Perspectives<br />
sich aus der Erreger-DNA nicht nur Spezies<br />
diagnostizieren, sondern auch Antibiotikaresistenzen<br />
beurteilen.<br />
Die Diagnose von Infektionskrankheiten<br />
ist ein sehr spezielles, aber äusserst<br />
wichtiges Teilgebiet der Pathologie und<br />
kann wesentlich zur richtigen Behandlung<br />
und Betreuung von Patientinnen und Patienten<br />
beitragen. Die gezielte Verwendung<br />
von Spezialtechniken sollte in der Zukunft<br />
ermöglichen, neben dem Erregernachweis<br />
analog zur Tumordiagnostik auch Aussagen<br />
über Prognose und Therapieansprechen<br />
(Prädiktion) zu machen. Innerhalb<br />
der Pathologie muss dafür aber auch die<br />
Weiter- und Fortbildung in diesem Bereich<br />
verstärkt werden und gegenüber den behandelnden<br />
Kolleginnen und Kollegen ein<br />
vermehrter Austausch zum Beispiel in<br />
Form von klinisch-pathologischen Besprechungen<br />
angestrebt werden.<br />
Prof. Dr. med. Gieri Cathomas<br />
Chefarzt<br />
Institut für Pathologie<br />
Kantonsspital Baselland<br />
Mühlemattstrasse 11<br />
4410 Liestal<br />
gieri.cathomas@ksbl.ch<br />
Literatur<br />
[1] Schwartz DA, Bryan RT, Hughes<br />
JM. Pathology and emerging infections – quo<br />
vadimus? Am J Pathol. 1995; 147: 1525 – 33.<br />
[2] Hofman P, Lucas S, Jouvion G,<br />
Tauziede-Espariat A, Chretien F, Cathomas G.<br />
Pathology of infectious diseases: what does<br />
the future hold? Virchows Arch.<br />
2017; 470: 483 – 92.<br />
[3] Martines RB, Bhatnagar J, de<br />
Oliveira Ramos AM, Davi HP, Iglezias SD,<br />
Kanamura CT, et al. Pathology of congenital<br />
Zika syndrome in Brazil: a case series. Lancet.<br />
2016; 388: 898 – 904.<br />
[4] Kiss S, Zsikla V, Frank A, Willi N,<br />
Cathomas G. Helico bacter-negative gastritis:<br />
polymerase chain reaction for Helicobacter<br />
DNA is a valuable tool to elucidate the<br />
diagnosis. Aliment Pharmacol Ther.<br />
2016; 43: 924 – 32.<br />
[5] Zsikla V, Hailemariam S, Baumann<br />
M, Mund MT, Schaub N, Meier R, et al.<br />
Increased rate of Helicobacter pylori infection<br />
detected by PCR in biopsies with chronic<br />
gastritis. Am J Surg Pathol. 2006; 30: 242 – 8.<br />
[6] Hofman V, Dhouibi A, Butori C,<br />
Padovani B, Gari-Toussaint M, Garcia-<br />
Hermoso D, et al. Usefulness of molecular<br />
biology performed with formaldehyde fixed<br />
paraffin embedded tissue for the diagnosis of<br />
combined pulmonary invasive mucormycosis<br />
and aspergillosis in an immunocompromised<br />
patient. Diagn Pathol. 2010; 5: 1.<br />
[7] Schoch CL, Seifert KA, Huhndorf S,<br />
Robert V, Spouge JL, Levesque CA, et al.<br />
Nuclear ribosomal internal transcribed spacer<br />
(ITS) region as a universal DNA barcode<br />
marker for Fungi. Proc Natl Acad Sci U S A.<br />
2012; 109: 6241 – 6.<br />
[8] Schweizer LA, Barlocher L, Graber<br />
A, Boggian K. Brain abscess caused by<br />
Clado phialophora bantiana: Total remission<br />
after full resection and short-course<br />
Voriconazole treatment. Med Mycol Case Rep.<br />
2019; 23: 43 – 5.<br />
Annonce<br />
Dans l’urgence,<br />
Donner les<br />
premiers soins<br />
© Ron Haviv / VII<br />
www.msf.ch ccP 12-100-2<br />
40<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Mission en Haïti<br />
Improvisation en salle<br />
d’opération<br />
Andrej M. <strong>No</strong>wakowski, médecin-chef de la clinique d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil locomoteur,<br />
Hôpital cantonal de Bâle-Campagne<br />
Photos: màd<br />
Quatre ans après le tremblement<br />
de terre dévastateur,<br />
le hasard m’a conduit pour la<br />
première fois en Haïti en<br />
2014. J’avais pour objectif de<br />
mener un travail clinique dans le cadre<br />
d’un séjour de six mois à l’étranger,<br />
condition à l’obtention de l’habilitation.<br />
L’appel de l’Hôpital Albert Schweitzer<br />
Haïti aux traumatologues/orthopédistes<br />
a immédiatement éveillé mon intérêt.<br />
Après une rencontre avec Rolf Maibach,<br />
directeur médical de l’Hôpital Albert<br />
Schweitzer et fondateur du partenariat<br />
suisse HAS, j’ai pris un congé non payé<br />
et suis parti. Ma plus grande crainte au<br />
début était de ne pas être à la hauteur des<br />
exigences et des conditions sur place.<br />
Haïti n’est pas sans danger. Bien que<br />
l’hôpital bénéficie d’une surveillance,<br />
il n’est pas forcément recommandé<br />
de se déplacer seul dans le pays.<br />
Les salles d’opération de l’Hôpital<br />
Albert Schweitzer sont plutôt bien<br />
équipées, mais les ressources en personnel<br />
sont limitées. La plupart du temps,<br />
j’étais seul à la table d’opération, sans<br />
assistants. Il est donc indispensable<br />
d’avoir l’expérience nécessaire pour faire<br />
face aux aléas. Les procédures locales<br />
n’étant pas toujours fiables et prévisibles,<br />
il est préférable de rassembler la veille<br />
tous les instruments nécessaires ainsi que<br />
les plaques, clous, vis, etc. Avec le temps,<br />
on sait par expérience comment les<br />
choses fonctionnent et ce à quoi il faut<br />
prêter attention. Il est par conséquent<br />
important de prendre son temps, de ne<br />
pas vouloir opérer le plus de patients<br />
possible à la va-vite. En outre, les examens<br />
de contrôle ne peuvent être garantis<br />
que pendant un séjour prolongé. Lors de<br />
mon troisième séjour en 2016, je me suis<br />
rendu dans différents villages de montagne<br />
pour aller rendre visite à mes<br />
anciens patients, qui comptaient parmi<br />
les cas les plus complexes.<br />
Beaucoup sont des enfants qui ont<br />
été victimes d’un accident ou qui souffrent<br />
de malformations congénitales.<br />
Même si une fracture ouverte n’est pas<br />
nécessairement considérée comme une<br />
urgence. Chaque jour, la salle d’attente<br />
ne désemplissait pas.<br />
Rolf Maibach a coutume de dire:<br />
«Ces moments marquent les esprits.»<br />
Avant mon premier séjour, j’avais une<br />
idée assez précise de la situation sur<br />
le terrain. Et pourtant, jamais je ne<br />
m’habituerai à entendre, chaque matin,<br />
le nombre de patients décédés pendant la<br />
nuit. Ni à la vision de ces petits cercueils,<br />
devant lesquels je passais régulièrement<br />
pour me rendre d’un bâtiment à l’autre.<br />
Un tel séjour est toutefois bénéfique<br />
pour toutes les parties. Je ne suis pas<br />
uniquement là pour traiter les patients,<br />
j’essaie aussi de construire quelque chose<br />
sur le long terme. J’ai réalisé ce qu’il<br />
était possible de faire avec peu de moyens<br />
et de l’improvisation. Par exemple,<br />
je réfléchis désormais à deux fois avant<br />
d’utiliser l’appareil de radiographie,<br />
car j’ai appris qu’il n’est pas toujours<br />
indispensable.<br />
Pour partir en mission en Haïti, il faut<br />
déjà disposer de connaissances<br />
techniques suffisantes et pouvoir s’engager<br />
pour une certaine durée.<br />
Informations complémentaires sur<br />
www.hopitalalbertschweitzer.org.<br />
<strong>No</strong>mbreuses impressions des interventions<br />
ici: ortho-haiti.blogspot.com.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 41
mediservice<br />
Boîtes aux lettres<br />
L’intérêt d’une protection<br />
pour faute grave<br />
Un accident de voiture est<br />
vite arrivé: une seconde<br />
d’inattention et une ligne<br />
de sécurité est franchie.<br />
Ou vous grillez un feu rouge et c’est<br />
l’accident. La loi sur la circulation<br />
routière considère qu’il s’agit en principe<br />
d’une négligence grave. Et dans<br />
ces cas-là, l’assurance prendra-t-elle<br />
en charge la totalité des dommages?<br />
Griller un feu rouge. Mal engager le<br />
frein à main. Percuter une cycliste dans<br />
un virage parce que l’on jetait un œil à<br />
son téléphone. La loi sur la circulation<br />
routière considère que le responsable<br />
d’un dommage a commis une faute grave<br />
lorsqu’il a gravement enfreint les règles<br />
de la circulation, causant un réel danger<br />
pour la sécurité d’autrui. La faute grave<br />
peut découler de la violation d’une ou de<br />
plusieurs de ces règles essentielles de la<br />
circulation comme du non-respect de<br />
principes élémentaires de sécurité que<br />
toute personne sensée, placée dans la<br />
même situation, aurait observés.<br />
Heureusement que la collision avec<br />
l’autre véhicule n’a provoqué que des<br />
dommages matériels. L’assureur paye ...<br />
mais finalement vous demande de mettre<br />
la main à la poche. Est-ce justifié? Oui.<br />
Le droit de recours autorise l’assureur<br />
à vous réclamer jusqu’à 60% du coût d’un<br />
sinistre que vous avez causé par négligence<br />
grave. Une faute de ce type peut<br />
donc avoir de lourdes conséquences<br />
financières.<br />
Vous pouvez facilement éviter de<br />
payer autant pour une seconde d’inattention.<br />
Comme la plupart des assureurs,<br />
Allianz Suisse propose une couverture<br />
complémentaire avec une renonciation<br />
au recours en cas de négligence grave.<br />
La prime supplémentaire est très faible et<br />
particulièrement avantageuse. En effet,<br />
moyennant cette prime réduite, l’assurance<br />
prendra en charge la totalité des<br />
dommages, même dans les accidents<br />
dus à une faute grave de votre part.<br />
Cependant les dommages provoqués<br />
par un conducteur ivre ou dans l’incapacité<br />
de conduire (du fait de l’abus de<br />
drogues ou de médicaments ou d’un état<br />
de surmenage) sont exclus. Dans les<br />
cas d’excès de vitesse, il va de soi que<br />
l’assurance ne couvre que partiellement<br />
les dommages, même en cas de protection<br />
pour négligence grave.<br />
Allianz Suisse<br />
Allianz Suisse offre à ses clients privés<br />
et professionnels une protection<br />
complète et personnalisée.<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong> et Allianz<br />
Suisse entretiennent une collaboration<br />
fructueuse depuis de nombreuses<br />
années. En tant que membre de mediservice,<br />
vous bénéficiez d’avantages<br />
lors de la conclusion d’une assurance<br />
auprès d’Allianz Suisse:<br />
– conditions préférentielles sur toutes<br />
les assurances d’Allianz<br />
– offres individuelles adaptées à vos<br />
besoins<br />
Vous trouverez de plus amples<br />
informations sur:<br />
https://partner.allianz.ch/fr/<br />
mediservice/<br />
Patrick Süsstrunk<br />
Digital Specialist<br />
Photo: màd<br />
42<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Du rire et du rêve pour nos<br />
enfants hospitalisés<br />
Photo: Pierre-Yves Massot. Espace publicitaire offert.<br />
Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent<br />
chaque semaine la visite des docteurs Rêves.<br />
Merci pour votre soutien.<br />
CCP 10-61645-5<br />
theodora.org
mediservice<br />
Sept étapes pour accéder à<br />
la propriété du logement<br />
Toute personne qui peut réaliser son rêve d’acheter un logement<br />
peut s’estimer heureuse. En effet, il faut prendre en compte de nombreux<br />
éléments, au plan financier notamment ... des frais mensuels<br />
à l’assurance et à la prévoyance.<br />
Giovanni Campanile, Head of ImmoWorld, Helvetia Assurances<br />
<strong>No</strong>us avons résumé ci-après les<br />
sept points essentiels relatifs<br />
au financement de la propriété<br />
du logement.<br />
1. Calculer les frais mensuels<br />
<strong>No</strong>mbre d’établissements financiers proposent<br />
sur leur site Internet des calculateurs<br />
d’hypothèques et de capacité financière.<br />
Ces outils aident à se faire une première<br />
idée de l’impact d’une habitation à<br />
usage propre sur le budget du ménage et<br />
de combien cela peut coûter. En plus des<br />
frais liés aux intérêts hypothécaires, il faut<br />
tenir compte de l’entretien, des charges<br />
annexes et, le cas échéant, d’une hausse<br />
des impôts liée à la valeur locative. La<br />
règle d’or: les frais de logement ne devraient<br />
pas dépasser un tiers du revenu du<br />
ménage. Les établissements financiers vérifient<br />
ce point avant d’octroyer un crédit.<br />
Ce faisant, ils ne tiennent pas compte des<br />
taux d’intérêt en vigueur, mais d’une<br />
moyenne à long terme – en règle générale<br />
4,5 à 5%. Et ce, pour éviter que les personnes<br />
contractant un crédit rencontrent<br />
des difficultés dans le cas d’une hausse des<br />
taux. Les frais annuels d’entretien et les<br />
charges annexes représentent environ 1%<br />
de la valeur du bien immobilier, en fonction<br />
de son âge. Pour ce qui est de la propriété<br />
par étages, il faut en plus compter<br />
les dépenses comme les frais de gestion ou<br />
les travaux de conciergerie ou de jardinage.<br />
Il faut également prévoir dans le<br />
budget l’amortissement, c’est-à-dire le<br />
remboursement de l’hypothèque jusqu’à<br />
65% de la valeur de l’immeuble jusqu’à la<br />
retraite ordinaire.<br />
Photos: Adobe Stock; màd<br />
44<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
2. Déterminer les fonds propres<br />
disponibles<br />
A l’achat d’un logement, les établissements<br />
financiers apportent leur soutien<br />
en accordant des hypothèques, c’est-àdire<br />
des crédits avec le bien immobilier<br />
servant de garantie. En principe, 80% du<br />
montant de l’achat ou de la construction<br />
sont garantis comme hypothèque. La partie<br />
acheteuse doit donc apporter au moins<br />
20% de fonds propres. Au maximum, la<br />
moitié peut provenir de la prévoyance<br />
professionnelle (caisse de pension). Les<br />
avoirs du pilier 3a peuvent également<br />
contribuer à l’achat d’un logement. Les<br />
personnes qui souhaitent devenir propriétaires<br />
n’ont donc pas d’autre choix<br />
que de se constituer des fonds propres.<br />
Souvent, des dons ou une avance d’hoirie<br />
viennent compléter les fonds épargnés.<br />
Les prêts privés, par exemple auprès de<br />
membres de la famille, sont également acceptés<br />
par les banques, mais à certaines<br />
conditions.<br />
3. Vérifier le retrait de la prévoyance<br />
professionnelle<br />
Les personnes qui perçoivent des fonds<br />
de la caisse de pension pour financer<br />
l’achat d’une maison ou d’un appartement<br />
doivent respecter différentes dispositions.<br />
En l’occurrence, les retraits sont possibles<br />
uniquement tous les cinq ans et, à partir<br />
de l’âge de 50 ans, ils sont limités. Le montant<br />
minimal est de 20 000 francs. De plus,<br />
chaque retrait anticipé est taxé, bien qu’à<br />
un taux réduit. Par ailleurs, il a un impact<br />
sur la rente de vieillesse. Il convient donc<br />
de discuter les détails avec une personne<br />
spécialiste, surtout en ce qui concerne les<br />
prestations à la retraite. En alternative à<br />
un retrait anticipé, une mise en gage est<br />
envisageable. Les prestations restent inchangées,<br />
mais les charges d’intérêts sont<br />
globalement plus élevées.<br />
5. Trouver l’hypothèque adaptée<br />
La meilleure solution dépend des besoins<br />
individuels et des conditions financières.<br />
Les jeunes familles recherchent souvent la<br />
stabilité financière et choisissent un taux<br />
d’intérêt constant sur une longue période.<br />
En revanche, une personne qui prévoit de<br />
déménager après son départ à la retraite<br />
porte plutôt son choix sur un produit<br />
flexible à court terme. Certaines caisses de<br />
pension et assurances proposent des hypothèques<br />
offrant plus de flexibilité en<br />
termes de résiliation anticipée, d’amortissement<br />
ou de prolongation anticipée. Il<br />
faut impérativement comparer les conditions!<br />
Bon à savoir: souvent, une attestation<br />
de financement du prêteur est demandée<br />
pour la remise d’une offre d’achat<br />
ferme. Il est donc d’autant plus important<br />
de chercher suffisamment tôt le partenaire<br />
financier qui convient.<br />
6. Intégrer d’autres frais dans<br />
les calculs<br />
Des impôts et des droits sont imputés à<br />
l’achat et à la vente de biens immobiliers.<br />
Ceux-ci varient d’un canton à l’autre, mais<br />
doivent absolument être pris en compte. Il<br />
s’agit notamment des frais de notaire, des<br />
frais de registre foncier, des droits de mutation,<br />
de la taxe sur les gains immobiliers<br />
et des frais de courtage.<br />
7. Et pour conclure: ne pas oublier<br />
la sécurité de vos biens et de vos<br />
proches<br />
Une assurance inventaire du ménage, une<br />
assurance bâtiment, voire une assurance<br />
décès pour couvrir ses proches? A l’achat<br />
d’un logement à usage propre, de nombreuses<br />
questions se posent concernant<br />
l’assurance et la prévoyance. Des spécialistes<br />
sont là pour y répondre. Cela vaut la<br />
peine de tenir compte de l’intégralité de<br />
ces thèmes.<br />
www.helvetia.ch/immoworld<br />
Helvetia<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong> et Helvetia<br />
mènent depuis des années une collaboration<br />
prospère. Les membres de<br />
mediservice bénéficient de conditions<br />
avantageuses.<br />
Adressez-vous à votre personne de<br />
contact chez mediservice: par voie<br />
téléphonique au 031 350 44 22 ou par<br />
courriel à info@mediservice-<strong>asmac</strong>.ch<br />
4. Evaluer le bien immobilier<br />
convoité<br />
Vous avez trouvé un bien qui vous plaît? Il<br />
faut dans tous les cas convenir d’une visite<br />
du bien, dans l’idéal en compagnie d’un<br />
professionnel. En effet, le prix demandé<br />
ne correspond pas toujours à la valeur<br />
réelle du bien immobilier de vos rêves.<br />
Une estimation protège des mauvaises<br />
surprises. Dans tous les cas, il est important<br />
de se faire une idée complète et d’exiger<br />
tous les documents relatifs au bien:<br />
notamment les plans, un extrait du registre<br />
foncier récent ou une liste des rénovations<br />
effectuées.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 45
mediservice<br />
Que proposent<br />
les portails en ligne<br />
et applications?<br />
Certains assureurs-maladie proposent déjà depuis plus de dix ans<br />
l’option de gérer sa police d’assurance en ligne et de télécharger des factures<br />
dans le portail client. Il a cependant fallu la pandémie de coronavirus<br />
pour que les assurées et assurés sollicitent plus intensément cette offre<br />
Auteur: Stephan Fischer, rédacteur en chef des magazines pour la clientèle Visana<br />
La vision du bureau sans papier<br />
est propagée depuis plusieurs<br />
décennies, pourtant elle n’est<br />
toujours pas devenue réalité et<br />
ne le sera probablement encore longtemps<br />
pas. Mais nous sommes sur la<br />
bonne voie pour réduire fortement la<br />
consommation de papier à la maison et au<br />
bureau grâce à la numérisation. A ce propos,<br />
il ne faut cependant pas oublier que<br />
la numérisation n’est pas une fin en soi.<br />
Elle doit être encouragée activement. Elle<br />
n’est appropriée que dans les situations<br />
où elle apporte une valeur ajoutée pour<br />
les assurées et assurés et que celle-ci devient<br />
tangible.<br />
Economiser du temps et de l’argent,<br />
mais pas seulement<br />
Nul doute que la réduction de la consommation<br />
de papier est bénéfique à l’environnement.<br />
Les portails clients combinés<br />
à une application le proposent. Ne plus<br />
envoyer de lettres permet d’économiser<br />
du temps et des frais de port. Pendant la<br />
pandémie de coronavirus, il s’agissait cependant<br />
d’un objectif qui était encore plus<br />
important pour certains: protéger sa<br />
propre santé et celle des autres.<br />
La pandémie accélère la<br />
numérisation<br />
Pourquoi se rendre dans une agence et<br />
s’exposer à un risque sanitaire s’il est possible<br />
de scanner les justificatifs avec son<br />
smartphone et de les transmettre à la<br />
Photos: màd<br />
46<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
caisse-maladie en quelques clics? La pandémie<br />
a fortement accéléré la numérisation<br />
des caisses-maladie. La plupart ont<br />
perfectionné leurs portails en ligne et applications<br />
au cours des deux dernières années<br />
et y ont ajouté de nouvelles fonctions.<br />
Et le renforcement des services va se poursuivre,<br />
car après la pandémie, personne ne<br />
veut renoncer aux fonctions utiles qui font<br />
désormais partie de notre quotidien.<br />
Ce que les portails en ligne* et<br />
applications* proposent<br />
––<br />
Consulter à tout moment les décomptes<br />
de prestations, les factures de primes ou<br />
les polices de toute la famille.<br />
––<br />
Scanner et transmettre les factures par<br />
l’application<br />
––<br />
Consigner les cartes d’assuré(e)s et les<br />
avoir à disposition lors de la consultation<br />
chez le médecin<br />
––<br />
Vérifier l’état de la franchise et de la<br />
quote- part<br />
––<br />
Modifier la franchise<br />
––<br />
Contacter le service à la clientèle via des<br />
canaux cryptés (courriel, chat)<br />
––<br />
Conseil de santé, listes de contrôle<br />
––<br />
Contrôler les factures et les faire traduire<br />
avec le calculateur Tarmed<br />
––<br />
Chat avec des spécialistes<br />
––<br />
Vérificateur de symptômes en cas de problèmes<br />
de santé<br />
––<br />
Contrôler avec le vérificateur de la couverture<br />
quelles prestations sont prises<br />
en charge<br />
––<br />
Consigner des certificats de vaccination<br />
––<br />
Participer aux programmes de bonus et<br />
gagner de l’argent, etc.<br />
*Pas toutes les caisses-maladie ne proposent<br />
toutes les fonctions.<br />
Application Visana –<br />
médaille d’argent au<br />
ISTQ-App-Award 2021<br />
En 2021, l’Institut<br />
Suisse des Tests<br />
Qualité (ISTQ) a<br />
interrogé les<br />
clientes et clients<br />
de différentes<br />
branches sur leur<br />
satisfaction avec<br />
les applications<br />
pour smartphone. Plus de 63 000<br />
clientes et clients ont répondu. Principaux<br />
critères: outre une fonctionnalité<br />
et fiabilité élevées, l’application pour<br />
smartphone parfaite doit aussi être<br />
conviviale et d’aspect attrayant.<br />
Dans la branche de l’assurance-maladie,<br />
l’application Visana a participé au<br />
comparatif de 17 applications dans cette<br />
catégorie. Elle a réalisé un bon score<br />
de 7,24 sur 10 points et s’est ainsi assuré<br />
la médaille d’argent.<br />
www.visana.ch/myvisana<br />
www.visana.ch/app<br />
Rabais de primes exclusifs<br />
sur les assurances<br />
complémentaires<br />
Grâce au partenariat entre mediservice<br />
vsao-<strong>asmac</strong> et Visana, vous et tous les<br />
membres de votre famille bénéficient<br />
de 15 % de rabais collectif sur l’assurance<br />
complémentaire d’hospitalisation<br />
de Visana.<br />
<strong>No</strong>tre cadeau:<br />
un bon Coop d’une valeur<br />
de 30 francs<br />
Convenez d’un entretien de conseil et<br />
recevez en guise de remerciement un<br />
bon Coop d’une valeur de 30 francs.<br />
<strong>No</strong>us vous conseillons volontiers dans<br />
une agence Visana ou chez vous. Vous<br />
pouvez nous atteindre comme suit:<br />
Visana Services AG<br />
Weltpoststrasse 19<br />
3000 Berne 16<br />
Téléphone 0848 848 899<br />
www.visana.ch/hk/ms-<strong>asmac</strong><br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 47
mediservice<br />
La cuisine saine et savoureuse<br />
Recettes rafraîchissantes<br />
pour les beaux jours<br />
Martina <strong>No</strong>vak, spécialiste SWICA Communication d’entreprise<br />
Bilder: zvg; Adobe Stock<br />
48<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
Soupe froide de laitue<br />
Recette pour 4 personnes<br />
Ingrédients<br />
Pain croustillant<br />
125 g de farine de seigle<br />
125 g de farine blanche<br />
2,5 g de sel<br />
125 ml d’eau<br />
10 g de graines de lin<br />
Soupe de laitue<br />
400 g de laitue<br />
50 g d’épinards<br />
150 g de concombre<br />
1 petite gousse d’ail<br />
1 échalote<br />
200 ml de bouillon de légumes<br />
120 ml d’huile de tournesol<br />
10 g de crème fraîche<br />
Sel et poivre pour l’assaisonnement<br />
Sauce tomate<br />
300 g de tomates<br />
5 g d’ail<br />
10 g d’oignons<br />
50 ml d’huile d’olive<br />
Basilic<br />
Sel et poivre pour l’assaisonnement<br />
Mayonnaise<br />
50 g de persil<br />
1 jaune d’œuf<br />
80 ml d’huile de colza<br />
1 cc de vinaigre Kressi<br />
(vinaigre aux herbes)<br />
1 cc de moutarde<br />
Sel et poivre pour l’assaisonnement<br />
Préparation<br />
Pour le pain croustillant<br />
Mélanger la farine de seigle, la farine<br />
blanche, le sel, les graines de lin et l’eau<br />
dans un saladier pour obtenir une pâte<br />
lisse et laisser reposer 30 minutes.<br />
Abaisser très finement, découper dans<br />
une forme quelconque et poser sur une<br />
plaque de cuisson. Enfourner à 180 °C<br />
sans chaleur tournante pendant environ<br />
45 minutes.<br />
Pour la soupe de laitue<br />
Blanchir la laitue. Couper le concombre,<br />
l’échalote et l’ail en dés, puis les réduire<br />
en purée au mixeur avec le bouillon de<br />
légumes, les épinards et la laitue. Ajouter<br />
l’huile et la crème fraîche, mixer à nouveau,<br />
rectifier l’assaisonnement et mettre<br />
au frais.<br />
Pour la sauce tomate<br />
Couper les tomates en quatre, les épépiner<br />
et les couper en petits dés. Hacher<br />
finement l’ail et les oignons. Mélanger<br />
les ingrédients avec l’huile et assaisonner.<br />
A la fin, ajouter le basilic préalablement<br />
coupé en lamelles.<br />
Pour la mayonnaise<br />
Mettre le jaune d’œuf dans un récipient<br />
cylindrique avec la moutarde et le<br />
vinaigre. Ajouter progressivement l’huile<br />
tout en mixant jusqu’à obtention d’une<br />
masse homogène. Hacher finement<br />
le persil et l’ajouter à la mayonnaise<br />
assaisonnée.<br />
Rabais de primes<br />
multiples<br />
En tant que membre de mediservice<br />
vsao-<strong>asmac</strong>, vous bénéficiez chez<br />
SWICA de rabais de primes intéressants<br />
sur les assurances d’hospitalisation<br />
et complémentaires grâce au<br />
contrat collectif et au programme de<br />
bonus BENEVITA. En outre, SWICA<br />
soutient vos activités dans les domaines<br />
de l’activité physique, de<br />
l’alimentation et de la détente avec<br />
jusqu’à 800 francs par année.<br />
www.swica.ch/fr/mediservice<br />
Conseil<br />
Il est préférable de passer une nouvelle<br />
fois la soupe au mixeur avant de la servir.<br />
L’organisation de santé SWICA sponsorise l’équipe nationale suisse de cuisine, qui est l’auteur<br />
de cette recette<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 4/22 49
Impressum<br />
Adresses de contact des sections<br />
N o 4 • 41 e année • Août <strong>2022</strong><br />
Editeur<br />
AG<br />
VSAO Sektion Aargau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong><br />
Bollwerk 10, case postale, 3001 Berne<br />
Téléphone 031 350 44 88<br />
journal@<strong>asmac</strong>.ch, journal@vsao.ch<br />
www.<strong>asmac</strong>.ch, www.vsao.ch<br />
Sur mandat de l’<strong>asmac</strong><br />
Rédaction<br />
Catherine Aeschbacher (rédactrice en chef),<br />
Kerstin Jost, Fabian Kraxner, Bianca Molnar,<br />
Patricia Palten, Léo Pavlopoulos, Lukas Staub,<br />
Anna Wang<br />
Comité directeur <strong>asmac</strong><br />
Angelo Barrile ( président), <strong>No</strong>ra Bienz<br />
(vice- présidente), Severin Baerlocher,<br />
Christoph Bosshard (invité permanent),<br />
Marius Grädel, Patrizia Kündig, Richard<br />
Mansky, Gert Printzen, Svenja Ravioli,<br />
Patrizia Rölli, Martin Sailer, Jana Siroka,<br />
Clara Ehrenzeller (swimsa)<br />
Impression et expédition<br />
Stämpfli SA, entreprise de communication,<br />
Wölflistrasse 1, 3001 Berne, tél. 031 300 66 66,<br />
info@staempfli.com, www.staempfli.com<br />
Maquette<br />
Oliver Graf<br />
Illustration de la page de couverture<br />
Stephan Schmitz<br />
Annonces<br />
Zürichsee Werbe AG, Fachmedien,<br />
Markus Haas, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa<br />
Téléphone 044 928 56 53<br />
E-mail vsao@fachmedien.ch<br />
Tirage<br />
Exemplaires imprimés: 21 800<br />
Certification des tirages par la REMP/FRP<br />
2021: 21 778 exemplaires<br />
Fréquence de parution: 6 numéros par année<br />
L’abonnement est inclus dans la contribution<br />
annuelle pour les membres de l’<strong>asmac</strong><br />
ISSN 1422-2086<br />
L’édition n o 5/<strong>2022</strong> paraîtra en<br />
octobre <strong>2022</strong>. Sujet: Forme.<br />
© <strong>2022</strong> by <strong>asmac</strong>, 3001 Berne<br />
Printed in Switzerland<br />
BL/BS<br />
VSAO Sektion beider Basel, Geschäftsleiterin und Sekretariat:<br />
lic. iur. Claudia von Wartburg, Advokatin, Hauptstrasse 104,<br />
4102 Binningen, tél. 061 421 05 95, fax 061 421 25 60,<br />
sekretariat@vsao-basel.ch, www.vsao-basel.ch<br />
BE VSAO Sektion Bern, Schwarztorstrasse 7, 3007 Berne, tél. 031 381 39 39,<br />
info@vsao-bern.ch, www.vsao-bern.ch<br />
FR<br />
ASMAC section fribourgeoise, Gabriela Kaufmann-Hostettler,<br />
Wattenwylweg 21, 3006 Berne, tél. 031 332 41 10, fax 031 332 41 12,<br />
info@gkaufmann.ch<br />
GE Associations des Médecins d’Institutions de Genève, case postale 23,<br />
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, amig@amig.ch, www.amig.ch<br />
GR<br />
JU<br />
NE<br />
VSAO Sektion Graubünden, 7000 Coire, Samuel B. Nadig, lic. iur. HSG,<br />
RA Geschäftsführer/Sektionsjurist, tél. 081 256 55 55, info@vsao-gr.ch,<br />
www.vsao-gr.ch<br />
ASMAC Jura, 6, Chemin des Fontaines, 2800 Delémont,<br />
marie.maulini@h-ju.ch<br />
ASMAC section neuchâteloise, Joël Vuilleumier, avocat,<br />
Rue du Musée 6, case postale 2247, 2001 Neuchâtel,<br />
tél. 032 725 10 11, vuilleumier@valegal.ch<br />
SG/AI/AR VSAO Sektion St. Gallen-Appenzell, Bettina Surber, Oberer Graben 44,<br />
9000 St-Gall, tél. 071 228 41 11, fax 071 228 41 12,<br />
Surber@anwaelte44.ch<br />
SO<br />
TI<br />
TG<br />
VD<br />
VS<br />
VSAO Sektion Solothurn, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ASMAC Ticino, Via Cantonale 8-Stabile Qi, 6805 Mezzovico-Vira,<br />
segretariato@<strong>asmac</strong>t.ch<br />
VSAO Sektion Thurgau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ASMAV, case postale 9, 1011 Lausanne-CHUV,<br />
asmav@asmav.ch, www.asmav.ch<br />
ASMAVal, p.a. Maître Valentine Gétaz Kunz,<br />
Ruelle du Temple 4, CP 20, 1096 Cully, contact@asmaval.ch<br />
Suisse centrale (LU, ZG, SZ, GL, OW, NW, UR)<br />
VSAO Sektion Zentralschweiz, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ZH/SH<br />
VSAO ZH/SH, RA lic. iur. Susanne Hasse,<br />
Geschäftsführerin, <strong>No</strong>rdstrasse 15, 8006 Zurich, tél. 044 941 46 78,<br />
susanne.hasse@vsao-zh.ch, www.vsao-zh.ch<br />
Publication<strong>2022</strong><br />
CIBLÉ<br />
COMPÉTENT<br />
TRANSPARENT<br />
Label de qualité Q-publication<br />
de l’association médias suisses<br />
50<br />
4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Privé<br />
Assurance ménage<br />
Responsabilité civile privée<br />
Protection juridique<br />
Bâtiment<br />
Objets de valeur / œuvres d’art<br />
Véhicules à moteur<br />
Voyage / assistance<br />
Caisse-maladie<br />
Indemnité journalière<br />
Accident<br />
Vie<br />
Interruption de l’activité professionnelle<br />
Profession<br />
Cabinet médical<br />
Bâtiment<br />
Responsabilité civile professionnelle<br />
Protection juridique<br />
Cyber<br />
Indemnité journalière<br />
Accident<br />
Profitez des avantages et rabais de nos<br />
partenaires:<br />
– Allianz Suisse<br />
– AXA-ARAG<br />
– Caisse-Maladie des Médecins Suisses<br />
– Concordia<br />
– Helvetia<br />
– Innova<br />
– ÖKK<br />
– Swica<br />
– VA Assurance des Médecins Suisse<br />
société coopérative<br />
– Visana<br />
– ZURICH<br />
Si vous avez déjà conclu une assurance<br />
auprès d’une des compagnies susmentionnées,<br />
examinez un passage dans nos<br />
contrats collectifs. <strong>No</strong>us vous assistons<br />
volontiers.<br />
Solutions exclusives pour les membres mediservice vsao-<strong>asmac</strong><br />
031 350 44 22 – nous sommes là pour vous.<br />
info@mediservice-<strong>asmac</strong>.ch, www.mediservice-<strong>asmac</strong>.ch
Protection complète<br />
pour les médecins au volant<br />
Visites à domicile, transports d’urgence, trajets domicile-travail: la diversité de vos<br />
déplacements impose une protection particulière. C’est pourquoi Allianz a créé<br />
MediDRIVE, une assurance véhicules à moteur spécialement conçue pour répondre<br />
aux besoins des membres de mediservice vsao-<strong>asmac</strong> dans le cadre de leur activité<br />
professionnelle.<br />
MediDRIVE: protection tout-en-un sur mesure<br />
Avec MediDRIVE, vous misez sur la sécurité pour vos déplacements professionnels. Un sinistre lors d’une intervention? Votre bonus n’en pâtit pas,<br />
et vous n’avez pas non plus besoin de payer de franchise. Même en cas de faute grave ou de retrait de permis, votre assurance automobile vous<br />
protège. Le petit plus: un nettoyage auto au cas où vous en auriez besoin après une intervention.<br />
Quand la prudence est récompensée<br />
Vous connaissez les conséquences des accidents de la circulation. Et vous avez tout à gagner si vous conduisez prudemment: en l’absence de<br />
sinistre, votre prime diminue au fil des ans. Résultat: votre bonus peut aisément grimper à 70 %, en responsabilité civile, comme en casco complète.<br />
Votre couverture en un coup d’œil<br />
• Responsabilité civile et casco: accidents lors des trajets domicile-travail, des visites<br />
à domicile ou des transports d’urgence<br />
• Protection du bonus en cas de déplacement professionnel<br />
• Pas de franchise en cas de déplacement professionnel<br />
• Assurance vol de la mallette médicale de secours<br />
• Dépannage 24 heures sur 24<br />
Vous aimeriez en savoir plus sur vos avantages personnels?<br />
<strong>No</strong>us vous fournirons un conseil gratuit et vous établirons une offre concrète.<br />
Contacteznous<br />
maintenant<br />
pour en<br />
profiter!<br />
Allianz Suisse<br />
Contrats de faveur pour entreprises/associations<br />
Case postale | 8010 Zurich<br />
T +41 58 358 50 50 | contrats.faveur@allianz.ch<br />
ou l’agence générale près de chez vous<br />
allianz.ch<br />
allianzsuisse