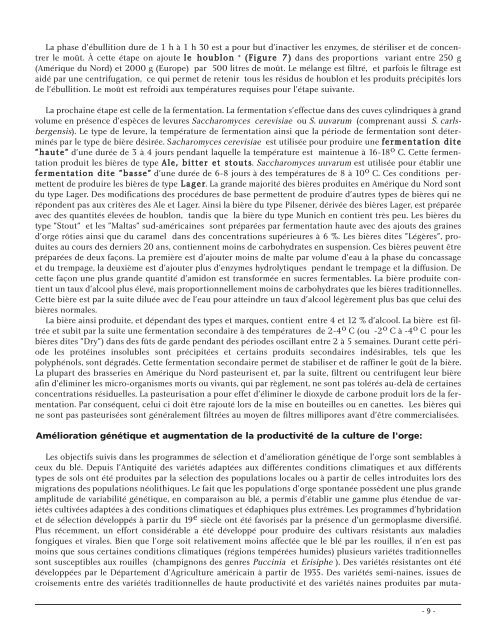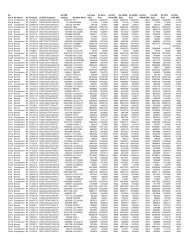Sommaire du CHAPITRE 8 Orge, avoine, sorgho, millets
Sommaire du CHAPITRE 8 Orge, avoine, sorgho, millets
Sommaire du CHAPITRE 8 Orge, avoine, sorgho, millets
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La phase d'ébullition <strong>du</strong>re de 1 h à 1 h 30 est a pour but d'inactiver les enzymes, de stériliser et de concentrer<br />
le moût. À cette étape on ajoute le houblon * (Figure 7) dans des proportions variant entre 250 g<br />
(Amérique <strong>du</strong> Nord) et 2000 g (Europe) par 500 litres de moût. Le mélange est filtré, et parfois le filtrage est<br />
aidé par une centrifugation, ce qui permet de retenir tous les rési<strong>du</strong>s de houblon et les pro<strong>du</strong>its précipités lors<br />
de l'ébullition. Le moût est refroidi aux températures requises pour l'étape suivante.<br />
La prochaine étape est celle de la fermentation. La fermentation s'effectue dans des cuves cylindriques à grand<br />
volume en présence d'espèces de levures Saccharomyces cerevisiae ou S. uuvarum (comprenant aussi S. carlsbergensis).<br />
Le type de levure, la température de fermentation ainsi que la période de fermentation sont déterminés<br />
par le type de bière désirée. Sacharomyces cerevisiae est utilisée pour pro<strong>du</strong>ire une fermentation dite<br />
"haute" d'une <strong>du</strong>rée de 3 à 4 jours pendant laquelle la température est maintenue à 16-18 o C. Cette fermentation<br />
pro<strong>du</strong>it les bières de type Ale, bitter et stouts. Saccharomyces uuvarum est utilisée pour établir une<br />
fermentation dite "basse" d'une <strong>du</strong>rée de 6-8 jours à des températures de 8 à 10 o C. Ces conditions permettent<br />
de pro<strong>du</strong>ire les bières de type Lager. La grande majorité des bières pro<strong>du</strong>ites en Amérique <strong>du</strong> Nord sont<br />
<strong>du</strong> type Lager. Des modifications des procé<strong>du</strong>res de base permettent de pro<strong>du</strong>ire d'autres types de bières qui ne<br />
répondent pas aux critères des Ale et Lager. Ainsi la bière <strong>du</strong> type Pilsener, dérivée des bières Lager, est préparée<br />
avec des quantités élevées de houblon, tandis que la bière <strong>du</strong> type Munich en contient très peu. Les bières <strong>du</strong><br />
type "Stout" et les "Maltas" sud-américaines sont préparées par fermentation haute avec des ajouts des graines<br />
d'orge rôties ainsi que <strong>du</strong> caramel dans des concentrations supérieures à 6 %. Les bières dites "Légères", pro<strong>du</strong>ites<br />
au cours des derniers 20 ans, contiennent moins de carbohydrates en suspension. Ces bières peuvent être<br />
préparées de deux façons. La première est d'ajouter moins de malte par volume d'eau à la phase <strong>du</strong> concassage<br />
et <strong>du</strong> trempage, la deuxième est d'ajouter plus d'enzymes hydrolytiques pendant le trempage et la diffusion. De<br />
cette façon une plus grande quantité d'amidon est transformée en sucres fermentables. La bière pro<strong>du</strong>ite contient<br />
un taux d'alcool plus élevé, mais proportionnellement moins de carbohydrates que les bières traditionnelles.<br />
Cette bière est par la suite diluée avec de l'eau pour atteindre un taux d'alcool légèrement plus bas que celui des<br />
bières normales.<br />
La bière ainsi pro<strong>du</strong>ite, et dépendant des types et marques, contient entre 4 et 12 % d'alcool. La bière est filtrée<br />
et subit par la suite une fermentation secondaire à des températures de 2-4 o C (ou -2 o C à -4 o C pour les<br />
bières dites "Dry") dans des fûts de garde pendant des périodes oscillant entre 2 à 5 semaines. Durant cette période<br />
les protéines insolubles sont précipitées et certains pro<strong>du</strong>its secondaires indésirables, tels que les<br />
polyphénols, sont dégradés. Cette fermentation secondaire permet de stabiliser et de raffiner le goût de la bière.<br />
La plupart des brasseries en Amérique <strong>du</strong> Nord pasteurisent et, par la suite, filtrent ou centrifugent leur bière<br />
afin d'éliminer les micro-organismes morts ou vivants, qui par règlement, ne sont pas tolérés au-delà de certaines<br />
concentrations rési<strong>du</strong>elles. La pasteurisation a pour effet d'éliminer le dioxyde de carbone pro<strong>du</strong>it lors de la fermentation.<br />
Par conséquent, celui ci doit être rajouté lors de la mise en bouteilles ou en canettes. Les bières qui<br />
ne sont pas pasteurisées sont généralement filtrées au moyen de filtres millipores avant d'être commercialisées.<br />
Amélioration génétique et augmentation de la pro<strong>du</strong>ctivité de la culture de l'orge:<br />
Les objectifs suivis dans les programmes de sélection et d'amélioration génétique de l'orge sont semblables à<br />
ceux <strong>du</strong> blé. Depuis l'Antiquité des variétés adaptées aux différentes conditions climatiques et aux différents<br />
types de sols ont été pro<strong>du</strong>ites par la sélection des populations locales ou à partir de celles intro<strong>du</strong>ites lors des<br />
migrations des populations néolithiques. Le fait que les populations d'orge spontanée possèdent une plus grande<br />
amplitude de variabilité génétique, en comparaison au blé, a permis d'établir une gamme plus éten<strong>du</strong>e de variétés<br />
cultivées adaptées à des conditions climatiques et édaphiques plus extrêmes. Les programmes d'hybridation<br />
et de sélection développés à partir <strong>du</strong> 19 e siècle ont été favorisés par la présence d'un germoplasme diversifié.<br />
Plus récemment, un effort considérable a été développé pour pro<strong>du</strong>ire des cultivars résistants aux maladies<br />
fongiques et virales. Bien que l'orge soit relativement moins affectée que le blé par les rouilles, il n'en est pas<br />
moins que sous certaines conditions climatiques (régions tempérées humides) plusieurs variétés traditionnelles<br />
sont susceptibles aux rouilles (champignons des genres Puccinia et Erisiphe ). Des variétés résistantes ont été<br />
développées par le Département d'Agriculture américain à partir de 1935. Des variétés semi-naines, issues de<br />
croisements entre des variétés traditionnelles de haute pro<strong>du</strong>ctivité et des variétés naines pro<strong>du</strong>ites par muta-<br />
- 9 -