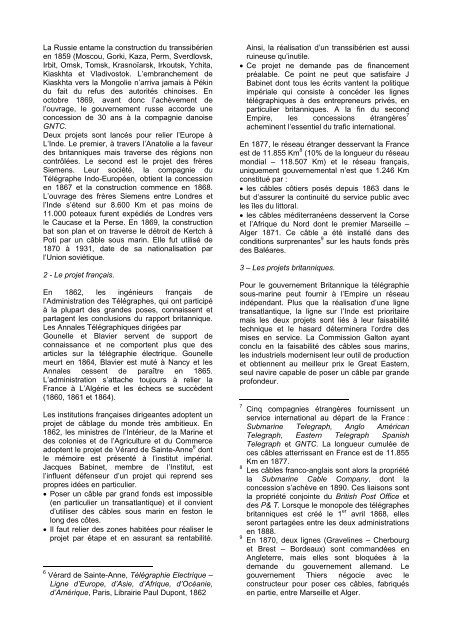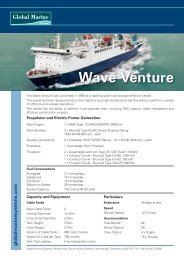ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins
ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins
ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La Russie entame la construction du transsibérien<br />
en 1859 (Moscou, Gorki, Kaza, Perm, Sverdlovsk,<br />
Irbit, Omsk, Tomsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Ychita,<br />
Kiaskhta et Vladivostok. L’embranchement de<br />
Kiaskhta vers la Mongolie n’arriva jamais à Pékin<br />
du fait du refus <strong>des</strong> autorités chinoises. En<br />
octobre 1869, avant donc l’achèvement de<br />
l’ouvrage, le gouvernement russe accorde une<br />
concession de 30 ans à la compagnie danoise<br />
GNTC.<br />
Deux projets sont lancés pour relier l’Europe à<br />
L’Inde. Le premier, à travers l’Anatolie a la faveur<br />
<strong>des</strong> britanniques mais traverse <strong>des</strong> régions non<br />
contrôlées. Le second est le projet <strong>des</strong> frères<br />
Siemens. Leur société, la compagnie du<br />
Télégraphe Indo-Européen, obtient la concession<br />
en 1867 et la construction commence en 1868.<br />
L’ouvrage <strong>des</strong> frères Siemens entre Londres et<br />
l’Inde s’étend sur 8.600 Km et pas moins de<br />
11.000 poteaux furent expédiés de Londres vers<br />
le Caucase et la Perse. En 1869, la construction<br />
bat son plan et on traverse le détroit de Kertch à<br />
Poti par un câble sous marin. Elle fut utilisé de<br />
1870 à 1931, date de sa nationalisation par<br />
l’Union soviétique.<br />
2 - Le projet français.<br />
En 1862, les ingénieurs français de<br />
l’Administration <strong>des</strong> Télégraphes, qui ont participé<br />
à la plupart <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> poses, connaissent et<br />
partagent les conclusions du rapport britannique.<br />
Les Annales Télégraphiques dirigées par<br />
Gounelle et Blavier servent de support de<br />
connaissance et ne comportent plus que <strong>des</strong><br />
articles sur la télégraphie électrique. Gounelle<br />
meurt en 1864, Blavier est muté à Nancy et les<br />
Annales cessent de paraître en 1865.<br />
L’administration s’attache toujours à relier la<br />
France à L’Algérie et les échecs se succèdent<br />
(1860, 1861 et 1864).<br />
Les institutions françaises dirigeantes adoptent un<br />
projet de câblage du monde très ambitieux. En<br />
1862, les ministres de l’Intérieur, de la Marine et<br />
<strong>des</strong> colonies et de l’Agriculture et du Commerce<br />
adoptent le projet de Vérard de Sainte-Anne 6 dont<br />
le mémoire est présenté à l’institut impérial.<br />
Jacques Babinet, membre de l’Institut, est<br />
l’influent défenseur d’un projet qui reprend ses<br />
propres idées en particulier.<br />
• Poser un câble par grand fonds est impossible<br />
(en particulier un transatlantique) et il convient<br />
d’utiliser <strong>des</strong> câbles sous marin en feston le<br />
long <strong>des</strong> côtes.<br />
• Il faut relier <strong>des</strong> zones habitées pour réaliser le<br />
projet par étape et en assurant sa rentabilité.<br />
6 Vérard de Sainte-Anne, Télégraphie Electrique –<br />
Ligne d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Océanie,<br />
d’Amérique, Paris, Librairie Paul Dupont, 1862<br />
Ainsi, la réalisation d’un transsibérien est aussi<br />
ruineuse qu’inutile.<br />
• Ce projet ne demande pas de financement<br />
préalable. Ce point ne peut que satisfaire J<br />
Babinet dont tous les écrits vantent la politique<br />
impériale qui consiste à concéder les lignes<br />
télégraphiques à <strong>des</strong> entrepreneurs privés, en<br />
particulier britanniques. A la fin du second<br />
Empire, les concessions étrangères 7<br />
acheminent l’essentiel du trafic international.<br />
En 1877, le réseau étranger <strong>des</strong>servant la France<br />
est de 11.855 Km 8 (10% de la longueur du réseau<br />
mondial – 118.507 Km) et le réseau français,<br />
uniquement gouvernemental n’est que 1.246 Km<br />
constitué par :<br />
• les câbles côtiers posés depuis 1863 dans le<br />
but d’assurer la continuité du service public avec<br />
les îles du littoral.<br />
• les câbles méditerranéens <strong>des</strong>servent la Corse<br />
et l’Afrique du Nord dont le premier Marseille –<br />
Alger 1871. Ce câble a été installé dans <strong>des</strong><br />
conditions surprenantes 9 sur les hauts fonds près<br />
<strong>des</strong> Baléares.<br />
3 – Les projets britanniques.<br />
Pour le gouvernement Britannique la télégraphie<br />
sous-marine peut fournir à l’Empire un réseau<br />
indépendant. Plus que la réalisation d’une ligne<br />
transatlantique, la ligne sur l’Inde est prioritaire<br />
mais les deux projets sont liés à leur faisabilité<br />
technique et le hasard déterminera l’ordre <strong>des</strong><br />
mises en service. La Commission Galton ayant<br />
conclu en la faisabilité <strong>des</strong> câbles sous marins,<br />
les industriels modernisent leur outil de production<br />
et obtiennent au meilleur prix le Great Eastern,<br />
seul navire capable de poser un câble par grande<br />
profondeur.<br />
7 Cinq compagnies étrangères fournissent un<br />
service international au départ de la France :<br />
Submarine Telegraph, Anglo Américan<br />
Telegraph, Eastern Telegraph Spanish<br />
Telegraph et GNTC. La longueur cumulée de<br />
ces câbles atterrissant en France est de 11.855<br />
Km en 1877.<br />
8 Les câbles franco-anglais sont alors la propriété<br />
la Submarine Cable Company, dont la<br />
concession s’achève en 1890. Ces liaisons sont<br />
la propriété conjointe du British Post Office et<br />
<strong>des</strong> P& T. Lorsque le monopole <strong>des</strong> télégraphes<br />
britanniques est créé le 1 er avril 1868, elles<br />
seront partagées entre les deux administrations<br />
en 1888.<br />
9 En 1870, deux lignes (Gravelines – Cherbourg<br />
et Brest – Bordeaux) sont commandées en<br />
Angleterre, mais elles sont bloquées à la<br />
demande du gouvernement allemand. Le<br />
gouvernement Thiers négocie avec le<br />
constructeur pour poser ces câbles, fabriqués<br />
en partie, entre Marseille et Alger.