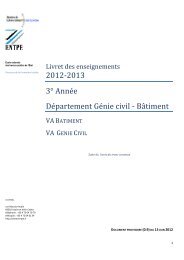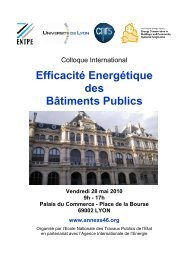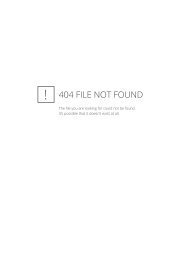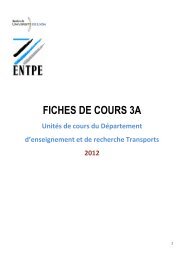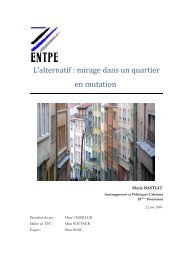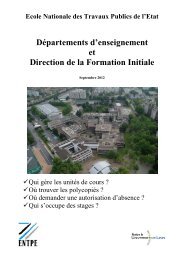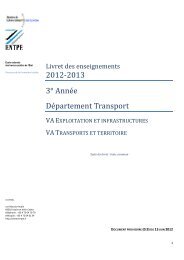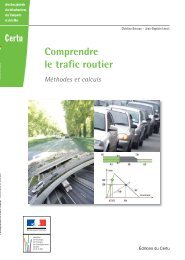Transformation urbaine et appropriation des espaces ... - entpe
Transformation urbaine et appropriation des espaces ... - entpe
Transformation urbaine et appropriation des espaces ... - entpe
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Transformation</strong> <strong>urbaine</strong> <strong>et</strong> <strong>appropriation</strong> <strong>des</strong> <strong>espaces</strong> extérieurs : Les limites du modèle de la résidentialisation.<br />
ville, orientés autour de deux types d’interventions : les Grands Proj<strong>et</strong>s de Ville (G.P.V.) <strong>et</strong> les<br />
Opérations de Renouvellement Urbain (O.R.U.). Au début <strong>des</strong> années 1990, la préparation de la<br />
Loi d’Orientation pour la Ville (1991) donne lieu à <strong>des</strong> réflexions sur la « banalisation » <strong>des</strong> grands<br />
ensembles. Notamment, dans son rapport 76, Olivier Piron pointe les dysfonctionnements <strong>des</strong><br />
grands ensembles, troubles liés au flou <strong>des</strong> statuts <strong>des</strong> sols. Il propose donc <strong>des</strong> solutions pour<br />
faire évoluer les grands ensembles, pour « en faire <strong>des</strong> quartiers comme les autres ». Parmi ces<br />
solutions, les dispositions de la résidentialisation (qui, bien sûr, n’apparaît pas encore sous ce<br />
nom) : « un découpage parcellaire recréé, un réseau viaire au statut clarifié, un document<br />
d’urbanisme à jour ».<br />
Mais c’est en 1995 qu’est formellement prise en compte la question de la sécurité dans les<br />
politiques <strong>urbaine</strong>s, par le biais notamment de la loi d’orientation <strong>et</strong> de programmation sur la<br />
sécurité intérieure (LOPSI). C<strong>et</strong>te loi, dite « Loi Pasqua », modifie le code de l’urbanisme <strong>et</strong> prévoit<br />
que :<br />
« Les étu<strong>des</strong> préalables à la réalisation <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s d’aménagement, <strong>des</strong> équipements<br />
collectifs <strong>et</strong> <strong>des</strong> programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou<br />
nécessitant une autorisation administrative <strong>et</strong> qui, par leur importance, leur<br />
localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir <strong>des</strong> incidences sur la<br />
protection <strong>des</strong> personnes <strong>et</strong> <strong>des</strong> biens contre les menaces <strong>et</strong> les agressions, doivent<br />
comporter une étude de sécurité publique perm<strong>et</strong>tant d’apprécier les conséquences.<br />
Sans préjudice de circonstances particulières, l’importance du proj<strong>et</strong> est appréciée<br />
notamment par référence à la catégorie de locaux dont la construction est envisagée,<br />
à la densité <strong>des</strong> constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance <strong>et</strong><br />
aux besoins en équipements publics qu’il génère » 77 .<br />
Ici, les caractéristiques à prendre en compte dans les étu<strong>des</strong> de sécurité publique sont<br />
explicites : types de construction <strong>et</strong> surtout environnement proche. Tout porte à penser que les<br />
programmes « à risques » sont les quartiers d’habitat social. A l’époque, c<strong>et</strong> article a déconcerté<br />
plus d’une personne en France : c’est la première fois qu’un article de loi aborde la question de la<br />
sécurité par l’aménagement urbain <strong>et</strong> surtout qu’il exprime clairement l’idée de l’existence d’un<br />
urbanisme criminogène. Puis peu à peu, malgré les débats, c<strong>et</strong>te idée d’un déterminisme spatial<br />
a intégré tous les programmes de réhabilitation : confrontés à <strong>des</strong> problèmes d’incivilité de plus<br />
en plus difficiles à réprimer, les bailleurs ont cherché la solution dans de nouveaux outils<br />
<strong>des</strong>tinés à favoriser le sentiment de sécurité <strong>et</strong> l’<strong>appropriation</strong> positive <strong>des</strong> lieux par les<br />
habitants.<br />
C’est donc dans ce nouveau contexte que la résidentialisation est apparue en France.<br />
Expérimentée dès le début <strong>des</strong> années 1990 par certains aménageurs comme stratégie de<br />
76 PIRON O., Les grands ensembles : bientôt <strong>des</strong> quartiers… comme les autres, rapport pour le Ministre délégué au<br />
Logement, Paris, DHC, Mars 1990, 50 pages.<br />
77 LOI no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation <strong>et</strong> de programmation relative à la sécurité, Article L111-3-1.<br />
ARANTES Laëtitia 36