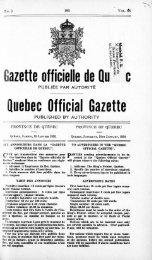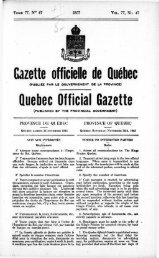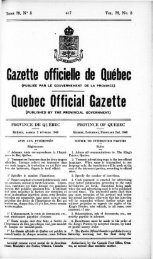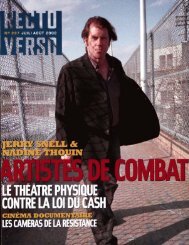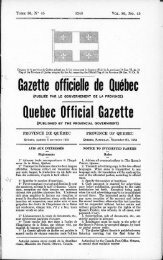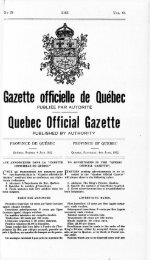Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
i8<br />
HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS<br />
Le duc de Montmorency disait que sa charge de vice-roi du Canada lui rompait la tête<br />
plus que les affaires importantes du royaume. En écoutant le rapport de Champlain, il perdit<br />
le reste de son enthousiasme, et, le 15 février 1625, passa le titre à son neveu, Henri de<br />
Lévis 1<br />
, duc de Ventadour, lequel confirma Champlain dans le poste de lieutenant, par lettres<br />
en date du même jour. Il paraîtrait que le nouveau vice-roi appuya vivement le projet déjà<br />
formé d'envoyer des jésuites au Canada seconder les récollets, et que ceux-ci, loin d'y mettre<br />
des entraves, insistèrent pour que la chose se fit. Ce n'était ni le sentiment de Champlain ni,<br />
celui des habitants de Québec ; toutefois, le printemps (1625) arrivé, Guillaume de Caen reçut<br />
ordre de prendre à son bord les pères Jean de Brébeuf et Charles Lalemant, jésuites, et le<br />
père Jean-Joseph de la Roche-Daillon, récollet.<br />
Champlain était resté en France, sur la demande du vice-roi, et tout nous indique que<br />
ce n'était pas sans à propos; car non-seulement Guillaume de Caen était en procès avec une<br />
partie de ses associés, mais les habitants du Canada et les religieux lui reprochaient de traiter<br />
comme lettre morte l'article de ses obligations envers la colonie. Deux arpents de terre à<br />
peine étaient défrichés à Québec par son ordre. La traite lui rapportait annuellement quinze<br />
à vingt milliers de castors. Il eût pu au moins donner des vivres aux hivernants, qui, chaque<br />
printemps, pensaient mourir de faim et finissaient par n'avoir plus d'autres ressources que de<br />
serrer leur ceinturon au dernier cran.<br />
Les premières tentatives de culture dans la Nouvelle-France eurent lieu à l'île Sainte-<br />
Croix (1604) et à Québec (1608) ; mais ces travaux ne dépassaient guère ceux d'un jardi<br />
nage; et leur objet n'était point de nourrir les habitants, mais de procurer à de Monts et à<br />
Champlain des échantillons de ce que le sol pouvait produire. Nous avons vu que, en 1613<br />
et en 1615, Champlain agrandit sa petite exploitation. Louis Hébert devait s'être attaqué à<br />
la terre dès 1618 ; il possédait un "labourage" en 1620, mais c'était un labourage à la bêche,<br />
puisque Champlain nous dit positivement que la veuve Hébert fit usage de la charrue, pour<br />
la première fois, le 26 avril 1628.<br />
En 1622, sur l'invitation de Champlain, quelques sauvages s'étaient mis à défricher et à<br />
semer du blé-d'Inde à la Canardière, joli endroit englobé, quatre ans plus tard, dans les<br />
limites de la seigneurie de Notre-Dame-des- Anges.<br />
Voyant que le vice-roi était changé, Hébert avait fait la demande d'un titre nouvel pour<br />
la terre à lui accordée par le duc de Montmorency en 1623. Le 28 février 1626, le duc de<br />
Ventadour lui en donna le titre, dans lequel il est dit que Hébert " aurait par son travail et<br />
industrie, assisté de ses serviteurs domestiques, défriché certaine portion de terre comprise<br />
dans l'enceinte d'un clos, et fait bâtir et construire un logement pour lui, sa famille et son<br />
bétail." La possession lui en est confirmée " pour en jouir en fief noble par lui, ses héritiers<br />
et ayant cause, à l'avenir comme de son propre et loyal acquest, et en disposer pleinement<br />
et paisiblement comme il verra bon être ; le tout relevant du fort et château de Québec, aux<br />
* En 1629, Champlain mentionne le » cap de Levis," le même qui est à présent connu sous le nom de « pointe Lévis," en face de<br />
Québec.