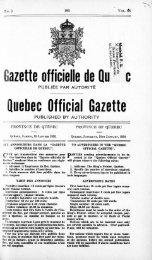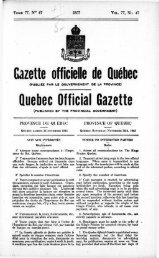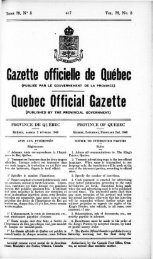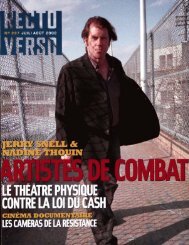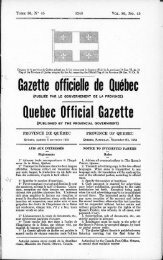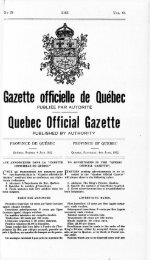Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
22<br />
HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS<br />
25 de janvier, Hébert fit une chute qui lui occasionna la mort. C'a été le premier chef de<br />
famille résidant au pays qui vivait de ce qu'il cultivait \ Les exhortations que le pauvre<br />
blessé adressa à sa famille sont rapportées par le frère Sagard en termes touchants l On voit<br />
du reste, j>ar les écrits du temps et même par ceux des personnes venues au Canada un<br />
demi-siècle après sa mort, que Louis Hébert avait laissé parmi les Canadiens un riche<br />
souvenir. " Ce premier habitant de la colonie tomba malade, épuisé des fatigues qu'il avait<br />
souffertes, et, après avoir traîné quelques jours, il rendit le tribut à la nature. Il laissa un<br />
regret universel de sa mort. On l'enterra solennellement dans notre cimetière ; mais, comme<br />
ce lieu fut renversé depuis notre rétablissement (1670) en Canada, on trouva encore ses<br />
ossements renfermés dans un cercueil de cèdre en 1678. Le révérend père Valentin Le Roux,<br />
alors commissaire et supérieur de toutes nos missions, le fit tirer de cet endroit et transporter<br />
solennellement dans la cave de la chapelle de l'église de notre couvent qu'il y avait fait<br />
bâtir; et le corps de celui qui avait été la tige des habitants du pays est le premier dont les<br />
ossements reposent dans cette cave, avec ceux du frère Pacifique Duplessis. Madame (Guil-<br />
lemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard) Couillard, fille du sieur Hébert, qui vivait<br />
encore alors, s'y fit transporter et voulut être présente à cette translation... On peut appeler<br />
Hébert l'Abraham de la colonie, le père des vivants et des croyants, puisque sa postérité a<br />
été si nombreuse qu'elle a produit quantité d'officiers de robe et d'épée, de marchands<br />
habiles pour le négoce, de très-dignes ecclésiastiques, enfin grand nombre de bons chrétiens<br />
dont plusieurs même ont beaucoup souffert et d'autres ont été tués des sauvages 3<br />
pour les<br />
intérêts communs 4<br />
."<br />
Le deuil du premier colon canadien et l'indifférence de la compagnie à l'égard des<br />
habitants de Québec n'étaient pas les seuls sujets que la petite colonie eût à méditer. Il y<br />
avait un autre nuage à l'horizon : la guerre des sauvages. On se rappelle que le complot des<br />
Algonquins et des Montagnais, au printemps de 1618, avait déjà beaucoup inquiété les<br />
Français. La bonne entente, une fois rétablie, ne devait plus être brisée, il est vrai, mais ce<br />
n'était pas chose facile que d'empêcher les nations, alliées, répandues sur un territoire de<br />
deux cents lieues de longueur, d'entrer en conflit avec les Iroquois ! L'ancienne coutume des<br />
embuscades et des coups de main se continuait comme avant l'arrivée des traiteurs sur le<br />
Saint-Laurent, avec cette différence, néanmoins, que les Iroquois se gardaient d'aller<br />
rencontrer leurs ennemis près de Québec. Après quelques années, voyant que les Français<br />
n'augmentaient guère en nombre, ils reprirent de l'audace. Dans l'été de 1622, trente pirogues 5<br />
de leurs guerriers allèrent attaquer la maison des récollets à la rivière Saint-Charles. Ils<br />
furent repoussés et placèrent des patrouilles sur le fleuve pour gêner les communications. Le<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Œuvres de Champlain, p. m6.<br />
Histoire du Canada, pp. 590-91.<br />
Voir Relation, 1661, p. 35.<br />
Le Clercq : Premier Etablissement, I, 112, 210, 374, 375.<br />
" Les Canadiens emploient le mot canot partout où les Français disent pirogues. Néanmoins, ce dernier mot n'est pas dispara de parmi<br />
nous ; car 011 dit une vieille pirogue pour désigner une embarcation délabrée.