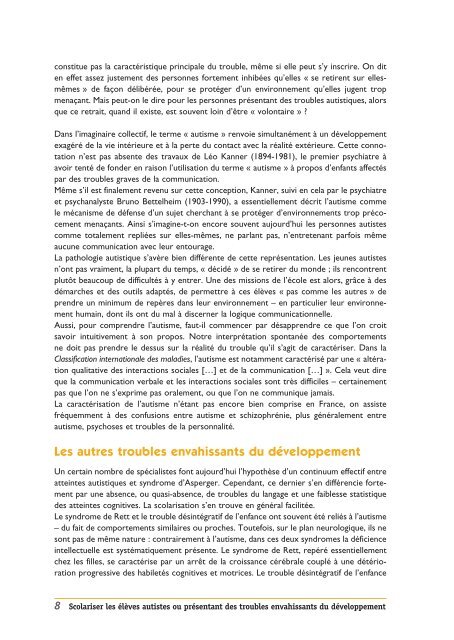Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles - CRDRAL
Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles - CRDRAL
Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles - CRDRAL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
constitue pas la caractéristique principale du tr<strong>ou</strong>ble, même si elle peut s’y inscrire. On dit<br />
en effet assez justement <strong>des</strong> personnes fortement inhibées qu’el<strong>les</strong> « se retirent sur el<strong>les</strong>mêmes<br />
» de façon délibérée, p<strong>ou</strong>r se protéger d’un environnement qu’el<strong>les</strong> jugent trop<br />
menaçant. Mais peut-on le dire p<strong>ou</strong>r <strong>les</strong> personnes <strong>présentant</strong> <strong>des</strong> tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> autistiques, alors<br />
que ce retrait, quand il existe, est s<strong>ou</strong>vent loin d’être « volontaire » ?<br />
Dans l’imaginaire collectif, le terme « autisme » renvoie simultanément à un développement<br />
exagéré de la vie intérieure et à la perte du contact avec la réalité extérieure. Cette connotation<br />
n’est pas absente <strong>des</strong> travaux de Léo Kanner (1894-1981), le premier psychiatre à<br />
avoir tenté de fonder en raison l’utilisation du terme « autisme » à propos d’enfants affectés<br />
par <strong>des</strong> tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> graves de la communication.<br />
Même s’il est finalement revenu sur cette conception, Kanner, suivi en cela par le psychiatre<br />
et psychanalyste Bruno Bettelheim (1903-1990), a essentiellement décrit l’autisme comme<br />
le mécanisme de défense d’un sujet cherchant à se protéger d’environnements trop précocement<br />
menaçants. Ainsi s’imagine-t-on encore s<strong>ou</strong>vent auj<strong>ou</strong>rd’hui <strong>les</strong> personnes <strong>autistes</strong><br />
comme totalement repliées sur el<strong>les</strong>-mêmes, ne parlant pas, n’entretenant parfois même<br />
aucune communication avec leur ent<strong>ou</strong>rage.<br />
La pathologie autistique s’avère bien différente de cette représentation. Les jeunes <strong>autistes</strong><br />
n’ont pas vraiment, la plupart du temps, « décidé » de se retirer du monde ; ils rencontrent<br />
plutôt beauc<strong>ou</strong>p de difficultés à y entrer. Une <strong>des</strong> missions de l’école est alors, grâce à <strong>des</strong><br />
démarches et <strong>des</strong> <strong>ou</strong>tils adaptés, de permettre à ces <strong>élèves</strong> « pas comme <strong>les</strong> autres » de<br />
prendre un minimum de repères dans leur environnement – en particulier leur environnement<br />
humain, dont ils ont du mal à discerner la logique communicationnelle.<br />
Aussi, p<strong>ou</strong>r comprendre l’autisme, faut-il commencer par désapprendre ce que l’on croit<br />
savoir intuitivement à son propos. Notre interprétation spontanée <strong>des</strong> comportements<br />
ne doit pas prendre le <strong>des</strong>sus sur la réalité du tr<strong>ou</strong>ble qu’il s’agit de caractériser. Dans la<br />
Classification internationale <strong>des</strong> maladies, l’autisme est notamment caractérisé par une « altération<br />
qualitative <strong>des</strong> interactions socia<strong>les</strong> […] et de la communication […] ». Cela veut dire<br />
que la communication verbale et <strong>les</strong> interactions socia<strong>les</strong> sont très diffici<strong>les</strong> – certainement<br />
pas que l’on ne s’exprime pas oralement, <strong>ou</strong> que l’on ne communique jamais.<br />
La caractérisation de l’autisme n’étant pas encore bien comprise en France, on assiste<br />
fréquemment à <strong>des</strong> confusions entre autisme et schizophrénie, plus généralement entre<br />
autisme, psychoses et tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> de la personnalité.<br />
Les autres tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> envahissants du développement<br />
Un certain nombre de spécialistes font auj<strong>ou</strong>rd’hui l’hypothèse d’un continuum effectif entre<br />
atteintes autistiques et syndrome d’Asperger. Cependant, ce dernier s’en différencie fortement<br />
par une absence, <strong>ou</strong> quasi-absence, de tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> du langage et une faib<strong>les</strong>se statistique<br />
<strong>des</strong> atteintes cognitives. La scolarisation s’en tr<strong>ou</strong>ve en général facilitée.<br />
Le syndrome de Rett et le tr<strong>ou</strong>ble désintégratif de l’enfance ont s<strong>ou</strong>vent été reliés à l’autisme<br />
– du fait de comportements similaires <strong>ou</strong> proches. T<strong>ou</strong>tefois, sur le plan neurologique, ils ne<br />
sont pas de même nature : contrairement à l’autisme, dans ces deux syndromes la déficience<br />
intellectuelle est systématiquement présente. Le syndrome de Rett, repéré essentiellement<br />
chez <strong>les</strong> fil<strong>les</strong>, se caractérise par un arrêt de la croissance cérébrale c<strong>ou</strong>plé à une détérioration<br />
progressive <strong>des</strong> habiletés cognitives et motrices. Le tr<strong>ou</strong>ble désintégratif de l’enfance<br />
8 <strong>Scolariser</strong> <strong>les</strong> <strong>élèves</strong> <strong>autistes</strong> <strong>ou</strong> <strong>présentant</strong> <strong>des</strong> tr<strong>ou</strong>b<strong>les</strong> envahissants du développement