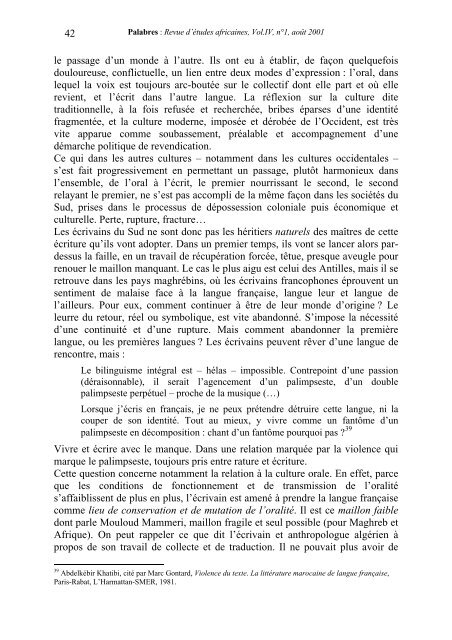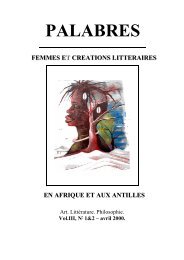Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
42<br />
<strong>Palabres</strong> : <strong>Revue</strong> d’études africaines, Vol.IV, n°1, août 2001<br />
le passage d’un monde à l’autre. Ils ont eu à établir, de façon quelquefois<br />
douloureuse, conflictuelle, un lien entre deux modes d’expression : l’oral, dans<br />
lequel la voix est toujours arc-boutée sur le collectif dont elle part et où elle<br />
revient, et l’écrit dans l’autre langue. La réflexion sur la culture dite<br />
traditionnelle, à la fois refusée et recherchée, bribes éparses d’une identité<br />
fragmentée, et la culture moderne, imposée et dérobée de l’Occident, est très<br />
vite apparue comme soubassement, préalable et accompagnement d’une<br />
démarche politique de revendication.<br />
Ce qui dans les autres cultures – notamment dans les cultures occidentales –<br />
s’est fait progressivement en permettant un passage, plutôt harmonieux dans<br />
l’ensemble, de l’oral à l’écrit, le premier nourrissant le second, le second<br />
relayant le premier, ne s’est pas accompli de la même façon dans les sociétés du<br />
Sud, prises dans le processus de dépossession coloniale puis économique et<br />
culturelle. Perte, rupture, fracture…<br />
Les écrivains du Sud ne sont donc pas les héritiers naturels des maîtres de cette<br />
écriture qu’ils vont adopter. Dans un premier temps, ils vont se lancer alors pardessus<br />
la faille, en un travail de récupération forcée, têtue, presque aveugle pour<br />
renouer le maillon manquant. Le cas le plus aigu est celui des Antilles, mais il se<br />
retrouve dans les pays maghrébins, où les écrivains francophones éprouvent un<br />
sentiment de malaise face à la langue française, langue leur et langue de<br />
l’ailleurs. Pour eux, comment continuer à être de leur monde d’origine ? Le<br />
leurre du retour, réel ou symbolique, est vite abandonné. S’impose la nécessité<br />
d’une continuité et d’une rupture. Mais comment abandonner la première<br />
langue, ou les premières langues ? Les écrivains peuvent rêver d’une langue de<br />
rencontre, mais :<br />
Le bilinguisme intégral est – hélas – impossible. Contrepoint d’une passion<br />
(déraisonnable), il serait l’agencement d’un palimpseste, d’un double<br />
palimpseste perpétuel – proche de la musique (…)<br />
Lorsque j’écris en français, je ne peux prétendre détruire cette langue, ni la<br />
couper de son identité. Tout au mieux, y vivre comme un fantôme d’un<br />
palimpseste en décomposition : chant d’un fantôme pourquoi pas ? 39<br />
Vivre et écrire avec le manque. Dans une relation marquée par la violence qui<br />
marque le palimpseste, toujours pris entre rature et écriture.<br />
Cette question concerne notamment la relation à la culture orale. En effet, parce<br />
que les conditions de fonctionnement et de transmission de l’oralité<br />
s’affaiblissent de plus en plus, l’écrivain est amené à prendre la langue française<br />
comme lieu de conservation et de mutation de l’oralité. Il est ce maillon faible<br />
dont parle Mouloud Mammeri, maillon fragile et seul possible (pour Maghreb et<br />
Afrique). On peut rappeler ce que dit l’écrivain et anthropologue algérien à<br />
propos de son travail de collecte et de traduction. Il ne pouvait plus avoir de<br />
39<br />
Abdelkébir Khatibi, cité par Marc Gontard, Violence du texte. La littérature marocaine de langue française,<br />
Paris-Rabat, L’Harmattan-SMER, 1981.