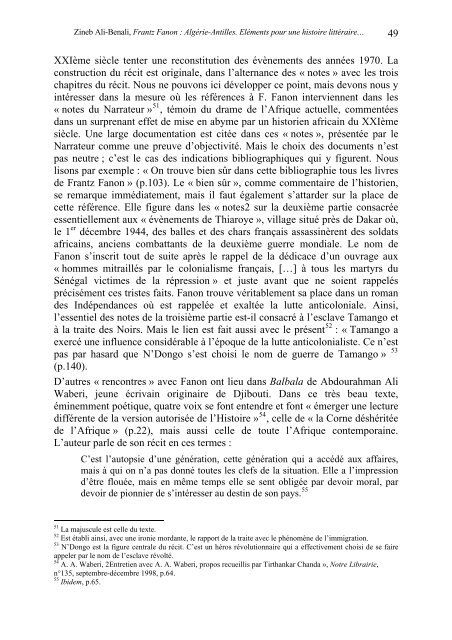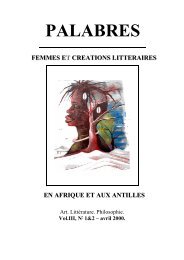Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Télécharger - Revue Palabres
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zineb Ali-Benali, Frantz Fanon : Algérie-Antilles. Eléments pour une histoire littéraire… 49<br />
XXIème siècle tenter une reconstitution des évènements des années 1970. La<br />
construction du récit est originale, dans l’alternance des « notes » avec les trois<br />
chapitres du récit. Nous ne pouvons ici développer ce point, mais devons nous y<br />
intéresser dans la mesure où les références à F. Fanon interviennent dans les<br />
« notes du Narrateur » 51 , témoin du drame de l’Afrique actuelle, commentées<br />
dans un surprenant effet de mise en abyme par un historien africain du XXIème<br />
siècle. Une large documentation est citée dans ces « notes », présentée par le<br />
Narrateur comme une preuve d’objectivité. Mais le choix des documents n’est<br />
pas neutre ; c’est le cas des indications bibliographiques qui y figurent. Nous<br />
lisons par exemple : « On trouve bien sûr dans cette bibliographie tous les livres<br />
de Frantz Fanon » (p.103). Le « bien sûr », comme commentaire de l’historien,<br />
se remarque immédiatement, mais il faut également s’attarder sur la place de<br />
cette référence. Elle figure dans les « notes2 sur la deuxième partie consacrée<br />
essentiellement aux « évènements de Thiaroye », village situé près de Dakar où,<br />
le 1 er décembre 1944, des balles et des chars français assassinèrent des soldats<br />
africains, anciens combattants de la deuxième guerre mondiale. Le nom de<br />
Fanon s’inscrit tout de suite après le rappel de la dédicace d’un ouvrage aux<br />
« hommes mitraillés par le colonialisme français, […] à tous les martyrs du<br />
Sénégal victimes de la répression » et juste avant que ne soient rappelés<br />
précisément ces tristes faits. Fanon trouve véritablement sa place dans un roman<br />
des Indépendances où est rappelée et exaltée la lutte anticoloniale. Ainsi,<br />
l’essentiel des notes de la troisième partie est-il consacré à l’esclave Tamango et<br />
à la traite des Noirs. Mais le lien est fait aussi avec le présent 52 : « Tamango a<br />
exercé une influence considérable à l’époque de la lutte anticolonialiste. Ce n’est<br />
pas par hasard que N’Dongo s’est choisi le nom de guerre de Tamango » 53<br />
(p.140).<br />
D’autres « rencontres » avec Fanon ont lieu dans Balbala de Abdourahman Ali<br />
Waberi, jeune écrivain originaire de Djibouti. Dans ce très beau texte,<br />
éminemment poétique, quatre voix se font entendre et font « émerger une lecture<br />
différente de la version autorisée de l’Histoire » 54 , celle de « la Corne déshéritée<br />
de l’Afrique » (p.22), mais aussi celle de toute l’Afrique contemporaine.<br />
L’auteur parle de son récit en ces termes :<br />
C’est l’autopsie d’une génération, cette génération qui a accédé aux affaires,<br />
mais à qui on n’a pas donné toutes les clefs de la situation. Elle a l’impression<br />
d’être flouée, mais en même temps elle se sent obligée par devoir moral, par<br />
devoir de pionnier de s’intéresser au destin de son pays. 55<br />
51<br />
La majuscule est celle du texte.<br />
52<br />
Est établi ainsi, avec une ironie mordante, le rapport de la traite avec le phénomène de l’immigration.<br />
53<br />
N’Dongo est la figure centrale du récit. C’est un héros révolutionnaire qui a effectivement choisi de se faire<br />
appeler par le nom de l’esclave révolté.<br />
54<br />
A. A. Waberi, 2Entretien avec A. A. Waberi, propos recueillis par Tirthankar Chanda », Notre Librairie,<br />
n°135, septembre-décembre 1998, p.64.<br />
55<br />
Ibidem, p.65.