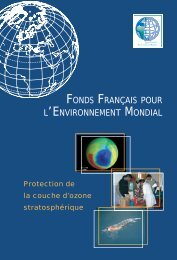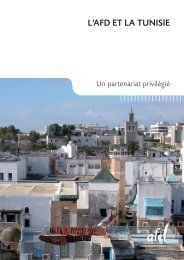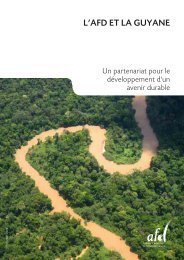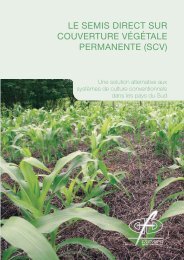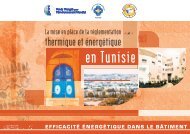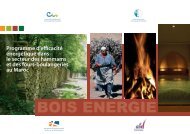Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Observatoire de la Guinée maritime – <strong>Rapport</strong> <strong>final</strong> – novembre 2006<br />
généralement depuis le talus côtier jusqu’aux chenaux en laissant souvent un rideau de<br />
Rhizophora entre le drain et la dernière rizière.<br />
Les plaines de front de mer sont considérées par les riziculteurs comme les plus<br />
propices à la mise en valeur. Résultant d’une sédimentation surtout marine, n’ayant<br />
généralement jamais porté de peuplement de Rhizophora, elles ne sont pas soumises au<br />
risque d’acidification. Cependant, elles présentent souvent, en particulier dans leur partie<br />
centrale, de mauvaises conditions de submersion/drainage, ce qui limite les surfaces<br />
cultivables. Leur mise en valeur commence par la mise en place d’une auréole de casiers<br />
entre les cordons sableux, puis s’étend en direction du littoral, où une bande d’Avicennia<br />
est maintenue en bord de mer. Dans le cas des grandes plaines, les cordons sont<br />
entièrement occupés par l'habitat rural, les cultures sèches et les peuplements d’arbres<br />
utiles. Dans certains cas, comme à Monchon, ces cordons servent aussi de parcs à<br />
bestiaux en saison sèche : certaines plaines servent en effet de pâturages en saison<br />
sèche pour le bétail transhumant.<br />
La côte est aussi parsemée de très nombreux débarcadères de pêche artisanale.<br />
Ils sont situés dans les estuaires ou sur de grands cordons fonctionnels en front de mer<br />
et dénotent, comme nous le verrons, l’importance de cette ressource dans les modes de<br />
gestion les plus littoraux.<br />
2.2 LA MISE EN VALEUR DU PIEMONT<br />
La mise en valeur du piémont est homogène depuis le talus côtier jusqu’aux<br />
contreforts du Fouta-Djalon et consiste en un essartage rizicole classique basé sur des<br />
jachères plus ou moins longues, sur l’action fertilisante des produits du brûlis, antiadventice<br />
et anti-parasitaire du feu.<br />
Contrairement aux terroirs de mangrove délimités par les systèmes de diguettes<br />
qui sont des marques foncières très nettes, le parcellaire n’est pas marqué clairement<br />
dans le paysage. Les terroirs villageois sont divisés en grandes parcelles sur lesquels<br />
s’effectuent des rotations sur des périodes de jachère de l’ordre de la décennie.<br />
Avant les premières pluies, un conseil convoqué par le doyen de la famille<br />
d’ascendance fondatrice et réunissant les chefs des grandes familles, choisit la zone à<br />
mettre en culture. Celle-ci est ensuite divisée en autant de subdivisions que de familles<br />
élargies, puis réparties entre foyers nucléaires au sein des familles.<br />
Après le défrichement, l’essart est mis à feu en une seule fois, labouré à plat à la<br />
daba 1 . Ces travaux sont collectifs et nécessitent de mobiliser une importante force de<br />
travail, nécessaire à leur réalisation, dans un laps de temps assez bref avant les pluies.<br />
Les parcelles sont semées à la volée. Une autre technique se fait jour dans la région du<br />
cap Verga : le semis en poquet. Il ne nécessite pas de labour complet de la parcelle,<br />
quelques grains sont enfouis dans un trou creusé à l’aide d’une petite daba particulière et<br />
la terre tassée d’un coup de talon. Selon les paysans, cette technique permet<br />
d’économiser à la fois temps de travail lors du labour et semences pour un rendement<br />
convenable. Les récoltes ont lieu dès le mois de septembre pour le riz précoce.<br />
1 Houe à manche court.<br />
14