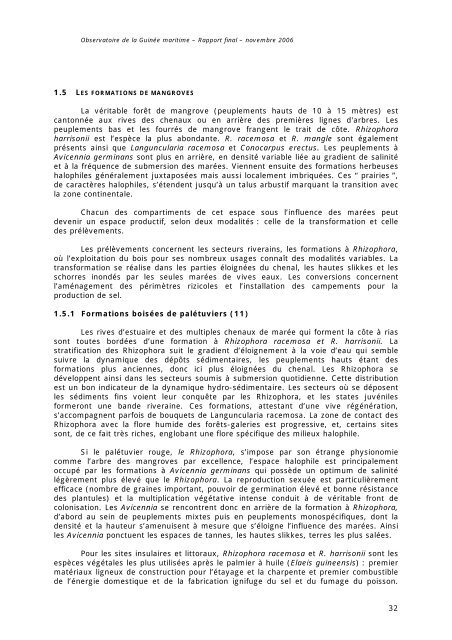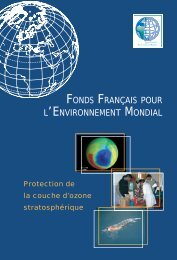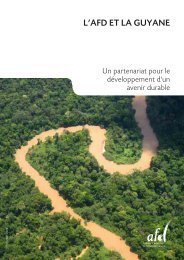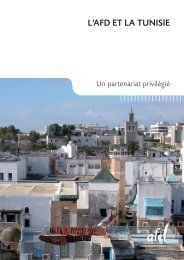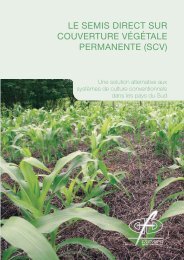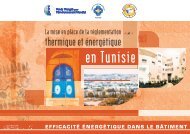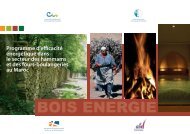Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
Rapport_final_OGM_nov2006.pdf - FFEM
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Observatoire de la Guinée maritime – <strong>Rapport</strong> <strong>final</strong> – novembre 2006<br />
1.5 LES FORMATIONS DE MANGROVES<br />
La véritable forêt de mangrove (peuplements hauts de 10 à 15 mètres) est<br />
cantonnée aux rives des chenaux ou en arrière des premières lignes d'arbres. Les<br />
peuplements bas et les fourrés de mangrove frangent le trait de côte. Rhizophora<br />
harrisonii est l’espèce la plus abondante. R. racemosa et R. mangle sont également<br />
présents ainsi que Languncularia racemosa et Conocarpus erectus. Les peuplements à<br />
Avicennia germinans sont plus en arrière, en densité variable liée au gradient de salinité<br />
et à la fréquence de submersion des marées. Viennent ensuite des formations herbeuses<br />
halophiles généralement juxtaposées mais aussi localement imbriquées. Ces “ prairies ”,<br />
de caractères halophiles, s’étendent jusqu’à un talus arbustif marquant la transition avec<br />
la zone continentale.<br />
Chacun des compartiments de cet espace sous l’influence des marées peut<br />
devenir un espace productif, selon deux modalités : celle de la transformation et celle<br />
des prélèvements.<br />
Les prélèvements concernent les secteurs riverains, les formations à Rhizophora,<br />
où l’exploitation du bois pour ses nombreux usages connaît des modalités variables. La<br />
transformation se réalise dans les parties éloignées du chenal, les hautes slikkes et les<br />
schorres inondés par les seules marées de vives eaux. Les conversions concernent<br />
l’aménagement des périmètres rizicoles et l’installation des campements pour la<br />
production de sel.<br />
1.5.1 Formations boisées de palétuviers (11)<br />
Les rives d’estuaire et des multiples chenaux de marée qui forment la côte à rias<br />
sont toutes bordées d’une formation à Rhizophora racemosa et R. harrisonii. La<br />
stratification des Rhizophora suit le gradient d’éloignement à la voie d’eau qui semble<br />
suivre la dynamique des dépôts sédimentaires, les peuplements hauts étant des<br />
formations plus anciennes, donc ici plus éloignées du chenal. Les Rhizophora se<br />
développent ainsi dans les secteurs soumis à submersion quotidienne. Cette distribution<br />
est un bon indicateur de la dynamique hydro-sédimentaire. Les secteurs où se déposent<br />
les sédiments fins voient leur conquête par les Rhizophora, et les states juvéniles<br />
formeront une bande riveraine. Ces formations, attestant d’une vive régénération,<br />
s’accompagnent parfois de bouquets de Languncularia racemosa. La zone de contact des<br />
Rhizophora avec la flore humide des forêts-galeries est progressive, et, certains sites<br />
sont, de ce fait très riches, englobant une flore spécifique des milieux halophile.<br />
Si le palétuvier rouge, le Rhizophora, s’impose par son étrange physionomie<br />
comme l’arbre des mangroves par excellence, l’espace halophile est principalement<br />
occupé par les formations à Avicennia germinans qui possède un optimum de salinité<br />
légèrement plus élevé que le Rhizophora. La reproduction sexuée est particulièrement<br />
efficace (nombre de graines important, pouvoir de germination élevé et bonne résistance<br />
des plantules) et la multiplication végétative intense conduit à de véritable front de<br />
colonisation. Les Avicennia se rencontrent donc en arrière de la formation à Rhizophora,<br />
d’abord au sein de peuplements mixtes puis en peuplements monospécifiques, dont la<br />
densité et la hauteur s’amenuisent à mesure que s’éloigne l’influence des marées. Ainsi<br />
les Avicennia ponctuent les espaces de tannes, les hautes slikkes, terres les plus salées.<br />
Pour les sites insulaires et littoraux, Rhizophora racemosa et R. harrisonii sont les<br />
espèces végétales les plus utilisées après le palmier à huile (Elaeis guineensis) : premier<br />
matériaux ligneux de construction pour l’étayage et la charpente et premier combustible<br />
de l’énergie domestique et de la fabrication ignifuge du sel et du fumage du poisson.<br />
32