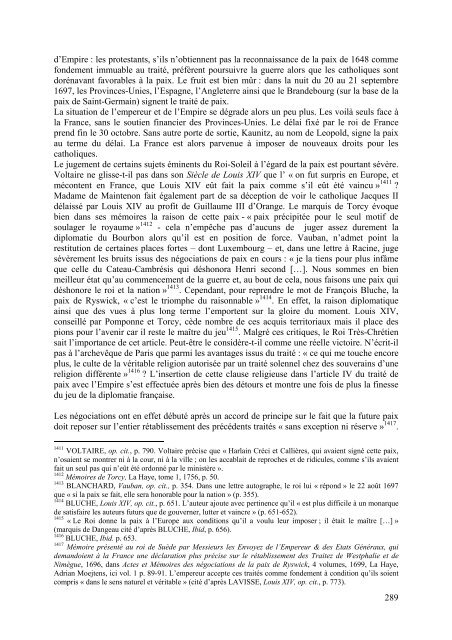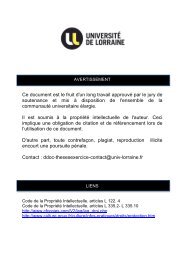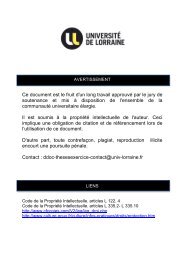- Page 1 and 2:
Laurent JALABERT CATHOLIQUES ET PRO
- Page 3 and 4:
REMERCIEMENTS. Cette étude est le
- Page 5 and 6:
INTRODUCTION GENERALE « Ce n’est
- Page 7 and 8:
constitution de l’identité confe
- Page 9 and 10:
cadre à l’introduction de la Ré
- Page 11 and 12:
catholicisme en terre luthérienne.
- Page 13 and 14:
marquée du sceau de la pluralité
- Page 16 and 17:
Carte 2 : les territoires rhénans
- Page 18 and 19:
18 Carte 4 : La rive gauche du Rhin
- Page 20 and 21:
Carte 6 : l’espace politique pala
- Page 22 and 23:
22 Carte 8 : le comté de Sarrewerd
- Page 24 and 25:
CARTE 10 : la partie orientale du d
- Page 26 and 27:
PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE POLIT
- Page 28 and 29:
1. LES QUESTIONS CONFESSIONNELLES A
- Page 30 and 31:
sujets d’adhérer à la doctrine
- Page 32 and 33:
nous y apportions ou permettions d
- Page 34 and 35:
point soumis à une telle entrepris
- Page 36 and 37:
11 avril 1644, accompagné de plusi
- Page 38 and 39:
luthérien est interdit, en 1626 le
- Page 40 and 41:
Chapitre 2 : Les questions religieu
- Page 42 and 43:
Au-delà de ces considérations, il
- Page 44 and 45:
entreprise. Nous devons interpréte
- Page 46 and 47:
conserver l’exercice libre de la
- Page 48 and 49:
landgraviats de Haute et de Basse-A
- Page 50 and 51:
depuis la Paix d’Augsburg de 1555
- Page 52 and 53:
envoyer leurs enfants à une école
- Page 54 and 55:
§52) 187 . Les deux blocs confessi
- Page 56 and 57:
Le rappel constant aux traités de
- Page 58 and 59:
« instruments de paix » 212 . Lor
- Page 60 and 61:
Chapitre 3 : reconstruction et conf
- Page 62 and 63:
desservent Schwabenheim se voient i
- Page 64 and 65:
Mayence est décimée de moitié en
- Page 66 and 67:
chiffres. Lothar K. Kinzinger 272 ,
- Page 68 and 69:
du Rhin. En effet, rappelons la pou
- Page 70 and 71:
pour la remise en valeur d’un cha
- Page 72 and 73:
maintenus dans tous les privileges,
- Page 74 and 75:
aisons religieuses : la contre-réf
- Page 76 and 77:
2. PRINCES, SEIGNEURS ET RELIGIONS
- Page 78 and 79:
luthériens, 3% de catholiques et 2
- Page 80 and 81:
aux fidèles de la confession d’A
- Page 82 and 83:
l’évêque de Worms dans la ville
- Page 84 and 85:
II de Nassau-Sarrebrück et Daniel
- Page 86 and 87:
l’influence de ce lieu de culte :
- Page 88 and 89:
Un regroupement progressif des droi
- Page 90 and 91:
espérer en ces lieux une homogén
- Page 92 and 93:
luthérienne a été introduite là
- Page 94 and 95:
*** Les accords obtenus à la suite
- Page 96 and 97:
pasteur Reichardi de Sarrebrück s
- Page 98 and 99:
1643 alors qu’il faut attendre 16
- Page 100 and 101:
un officier civil et plusieurs asse
- Page 102 and 103:
sont victimes les luthériens du Pa
- Page 104 and 105:
Le droit de collation reste aux mai
- Page 106 and 107:
Kirchenrat et la pasteur luthérien
- Page 108 and 109:
personnes des autres confessions (w
- Page 110 and 111:
confession, soit envoyer leurs enfa
- Page 112 and 113:
la doctrine calviniste - du catéch
- Page 114 and 115:
Chapitre 6 : minorités catholiques
- Page 116 and 117:
ou cinq catholiques », « le petit
- Page 118 and 119:
protestants 584 . Une légère majo
- Page 120 and 121:
Document n°2 : proportion (en %) d
- Page 122 and 123:
Document n°4 : la répartition con
- Page 124 and 125:
Une étude sur les familles de la p
- Page 126 and 127:
frontières politiques. La frontiè
- Page 128 and 129:
tirent même contre les maisons des
- Page 130 and 131:
comptant souvent parmi les plus pau
- Page 132 and 133:
§8 que le baptême et le mariage d
- Page 134 and 135:
contrats sont nuls et invalides »
- Page 136 and 137:
L’entrave mise à l’accession a
- Page 138 and 139:
subsister en raison de la structure
- Page 140 and 141:
DEUXIEME PARTIE : CHANGEMENTS PRINC
- Page 142 and 143:
en œuvre. Peu à peu, le catholici
- Page 144 and 145:
tardent pas à subir des contrainte
- Page 146 and 147:
s’agit respectivement de Hieronym
- Page 148 and 149:
desservis par les pasteurs de Fén
- Page 150 and 151:
En effet, la paix d’Osnabrück as
- Page 152 and 153:
militairement. Le comte ne se laiss
- Page 154 and 155:
centrale se voient également confi
- Page 156 and 157:
Palatinat. Tous les sujets catholiq
- Page 158 and 159:
ibliothèque, que l’on ne cherche
- Page 160 and 161:
guerre avec l’Espagne qui dure ju
- Page 162 and 163:
que des récriminations sur les sai
- Page 164 and 165:
nouvel évêque de Metz est ainsi r
- Page 166 and 167:
L’accueil est identique en d’au
- Page 168 and 169:
generosum comitem dominum suum qui
- Page 170 and 171:
1689, destiné à « Monseigneur de
- Page 172 and 173:
Carte 14 : les Réunions et la Prov
- Page 174 and 175:
) L’application de la législatio
- Page 176 and 177:
8.2. L’exercice du culte protesta
- Page 178 and 179:
de même que les moyens pour y parv
- Page 180 and 181:
Par contre, les protestants des nou
- Page 182 and 183:
Palatinat ? Ce n’est pas improbab
- Page 184 and 185:
Keller, couple de catholiques du vi
- Page 186 and 187:
Chapitre 9 : le temps des conversio
- Page 188 and 189:
Sa Ma té depuis la retraite du dit
- Page 190 and 191:
prêche sur les ruines à Ludweiler
- Page 192 and 193:
que Vous leur donniez des passeport
- Page 194 and 195:
hingraves, les pasteurs luthériens
- Page 196 and 197:
province de la Sarre et un moine au
- Page 198 and 199:
eligieuses. L’idée de la diffusi
- Page 200 and 201:
modèle aux protestants hésitants
- Page 202 and 203:
obtient pour réponse de la plupart
- Page 204 and 205:
Ceux qui se qualifient de « pauvre
- Page 206 and 207:
au Roy luy faire quelque charité e
- Page 208 and 209:
est ainsi largement soutenue par le
- Page 210 and 211:
Missions aux garnisons et aux petit
- Page 212 and 213:
CHAPITRE 10 : Les protestants face
- Page 214 and 215:
Premier point à noter afin de dres
- Page 216 and 217:
216 Carte 15 : la reconquête catho
- Page 218 and 219:
Dans l’archiprêtré de Hornbach,
- Page 220 and 221:
eligieuse familiale ? Certainement,
- Page 222 and 223:
d’inertie l’emporte peu à peu
- Page 224 and 225:
année » 1095 . Comme à Bouquenom
- Page 226 and 227:
procédure si le refus ne s’est p
- Page 228 and 229:
selon le catéchisme d’Augsbourg
- Page 230 and 231:
*** Les conversions de masse n’on
- Page 232 and 233:
que ce temple estoit une ancienne
- Page 234 and 235:
Holler répond que celles de l’é
- Page 236 and 237:
ailliage de Meisenheim, où le roi
- Page 238 and 239: Document 12 : le partage des lieux
- Page 240 and 241: donnée au simultaneum dans la gran
- Page 242 and 243: cadre de la guerre de la Ligue d’
- Page 244 and 245: morts ayant été bénis et réconc
- Page 246 and 247: dans la voutte ». Pour résumer, l
- Page 248 and 249: que « l’église est en mauvais e
- Page 250 and 251: Fin janvier-début février 1686, l
- Page 252 and 253: Chapitre 12 : le renouveau de l’e
- Page 254 and 255: convoque un synode général du cle
- Page 256 and 257: siècle pour donner une nouvelle ch
- Page 258 and 259: dresser un bilan plus juste à l’
- Page 260 and 261: de l’évêque de Metz pour obteni
- Page 262 and 263: seuls chacun un curé. Celui d’Ot
- Page 264 and 265: protestants, transfert qui a donné
- Page 266 and 267: Document n°15 : Les cures royales
- Page 268 and 269: L’argent pour financer ces cures
- Page 270 and 271: Hornbach à un prêtre venu de Pari
- Page 272 and 273: entreprise : le renouveau du cathol
- Page 274 and 275: leur couvent d’origine et l’ég
- Page 276 and 277: un villages visités de l’archipr
- Page 278 and 279: filiales de Ruppertsberg. A Forst,
- Page 280 and 281: église ne se ferait plus puisqu’
- Page 282 and 283: l’élément essentiel du renouvea
- Page 284 and 285: TROISIEME PARTIE : CATHOLIQUES ET P
- Page 286 and 287: mieux la définir. La coexistence e
- Page 290 and 291: Le comte d’Avaux, ambassadeur du
- Page 292 and 293: attendant ils jouïroient de la Pai
- Page 294 and 295: Que peut-on en dire aujourd’hui ?
- Page 296 and 297: catholique de cette clause dans son
- Page 298 and 299: curés, de leurs esglises dont ils
- Page 300 and 301: Provinces-unies et la Savoie, le 13
- Page 302 and 303: ainsi des affaires confessionnelles
- Page 304 and 305: données ; ce qui n’avoit presque
- Page 306 and 307: Document 16 : extrait de la liste d
- Page 308 and 309: fait que les Français ont justemen
- Page 310 and 311: pour arrêter les meneurs 1515 . La
- Page 312 and 313: économique et voient leurs moyens
- Page 314 and 315: la Déclaration de 1705 « n’est
- Page 316 and 317: De faire faire interdire par les mi
- Page 318 and 319: Document n°17 : état des lieux de
- Page 320 and 321: Après les acteurs, les méthodes.
- Page 322 and 323: colonel von Franckenberg pour y int
- Page 324 and 325: plaintes des protestants au corpus
- Page 326 and 327: seigneurs protestants sont contrain
- Page 328 and 329: Document 18 : nombre de plaintes ad
- Page 330 and 331: l’inspection de Bergzabern demand
- Page 332 and 333: catholiques, expulsés entre autres
- Page 334 and 335: - la reconnaissance de la liberté
- Page 336 and 337: essentielle pour expliquer le compo
- Page 338 and 339:
nommé Henri Pappe, à sortir de la
- Page 340 and 341:
prie si ie puis contraindre les che
- Page 342 and 343:
ne sait toujours pas comment s’en
- Page 344 and 345:
clauses des traités de paix ainsi
- Page 346 and 347:
corps évangélique. Celui-ci fait
- Page 348 and 349:
Dans le domaine du Palatinat 1696 ,
- Page 350 and 351:
Document n°19 : répartition confe
- Page 352 and 353:
simultaneum - c’est-à-dire l’u
- Page 354 and 355:
lorsque deux confessions partagent
- Page 356 and 357:
Carte 17 : paroisses et églises ca
- Page 358 and 359:
celle-ci est consacrée. Qui a fina
- Page 360 and 361:
son service mais il semble bien que
- Page 362 and 363:
simultaneum en 1684 ne donne pas li
- Page 364 and 365:
cloches 1780 . A Limbach, où le si
- Page 366 and 367:
symbolique entre les espaces destin
- Page 368 and 369:
Document 22 : l’église mixte de
- Page 370 and 371:
Le 6 juillet 1719, de Deux-Ponts, l
- Page 372 and 373:
fait rehausser l’autel, il en pro
- Page 374 and 375:
Dans le comté de Sarrewerden 1845
- Page 376 and 377:
Document n°25 : le cimetière de l
- Page 378 and 379:
croix situées aux carrefours 1866
- Page 380 and 381:
que des lieus circonvoisins, êtoie
- Page 382 and 383:
imaginer cette démonstration du ca
- Page 384 and 385:
femmes, garçons et enfants de Diem
- Page 386 and 387:
en raison de l’accroissement prog
- Page 388 and 389:
changements politiques, cette nouve
- Page 390 and 391:
*** Partager l’espace religieux n
- Page 392 and 393:
Molitor la moitié des revenus et a
- Page 394 and 395:
également de Mayence, de l’Eichs
- Page 396 and 397:
Document n°26 : origine géographi
- Page 398 and 399:
sur la rive gauche du Rhin 2005 . L
- Page 400 and 401:
Châtellier 2023 : au matin, prièr
- Page 402 and 403:
de la région et ailleurs 2037 . Ce
- Page 404 and 405:
catholique. Le bailli Johan Albrech
- Page 406 and 407:
pèlerinage détruit au cours de la
- Page 408 and 409:
Les communautés catholiques des fr
- Page 410 and 411:
marche 2085 . La traversée individ
- Page 412 and 413:
de confréries : en plus de celle d
- Page 414 and 415:
Document n°32 : les confréries d
- Page 416 and 417:
Ces confréries soulignent la parti
- Page 418 and 419:
418 c) La dévotion domestique. Apr
- Page 420 and 421:
usage de dire trois chapelets par c
- Page 422 and 423:
quelques intérieurs ruraux mais ne
- Page 424 and 425:
sanctuaires et de confréries. Invo
- Page 426 and 427:
fréquentent pas ou peu les sites m
- Page 428 and 429:
comportement des couples, partant d
- Page 430 and 431:
ural donnent-ils également l’ima
- Page 432 and 433:
1685-1750 70 60 50 Nombre de famill
- Page 434 and 435:
1686-1750 Nombre de familles 200 18
- Page 436 and 437:
Pour les hommes (document n°37), p
- Page 438 and 439:
Document n°37 : Les prénoms selon
- Page 440 and 441:
Document n°39 : Les prénoms selon
- Page 442 and 443:
1766-1790 E. Prénoms féminins Nbr
- Page 444 and 445:
grand scandal des Catholiques y dem
- Page 446 and 447:
soit 3,1% ; encore faut-il noter qu
- Page 448 and 449:
zulassen » 2255 : au pasteur luth
- Page 450 and 451:
à l’autre 2276 . Au-delà des di
- Page 452 and 453:
des messes et des dons. Le testamen
- Page 454 and 455:
siècle, l’école a seulement lie
- Page 456 and 457:
Les supports d’apprentissage luth
- Page 458 and 459:
historiettes, contes et chansons tr
- Page 460 and 461:
oire et jouer 2362 . Danse-t-on pou
- Page 462 and 463:
dudit lieu quelque piece de bois do
- Page 464 and 465:
Sarrebrück, il y a bien des cathol
- Page 466 and 467:
ville n’auraient jamais pu travai
- Page 468 and 469:
marché sarrebrückois. En 1789, un
- Page 470 and 471:
frontière religieuse pour se marie
- Page 472 and 473:
nécessaire repeuplement des Etats
- Page 474 and 475:
personnalités locales prend ici to
- Page 476 and 477:
ANNEXE 1 : « la liste de 1688 » o
- Page 478 and 479:
478
- Page 480 and 481:
480
- Page 482 and 483:
482
- Page 484 and 485:
484
- Page 486 and 487:
486
- Page 488 and 489:
488
- Page 490 and 491:
ANNEXE 2 : extraits de la biographi
- Page 492 and 493:
Traduction du texte précédent en
- Page 494 and 495:
ANNEXE 3 : récit de la conversion
- Page 496 and 497:
ANNEXE 4 : les prénoms confessionn
- Page 498 and 499:
3. Les « Anna » à Bouquenom de 1
- Page 500 and 501:
7. Prénoms composés féminins cat
- Page 502 and 503:
Eva Maria 2 Gertrud Elisabetha 1 He
- Page 504 and 505:
10. Prénoms composés féminins de
- Page 506 and 507:
D. Les prénoms masculins simples e
- Page 508 and 509:
14. Prénoms masculins composés à
- Page 510 and 511:
16. Les « Johann » composés à B
- Page 512 and 513:
18. Prénoms masculins protestants
- Page 514 and 515:
20. Prénoms composés masculins pr
- Page 516 and 517:
F. Les prénoms masculins simples e
- Page 518 and 519:
Lislin-Edme 1 Louis-Antoine 2 Mathi
- Page 520 and 521:
520 SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
- Page 522 and 523:
382 : correspondance du comte de Be
- Page 524 and 525:
SERIE H: H 1958: missions prêchée
- Page 526 and 527:
3 E 2367-2378 : actes notariés de
- Page 528 and 529:
3854: ein von den Katholiken auf de
- Page 530 and 531:
164/7 : édit du 21 décembre 1684
- Page 532 and 533:
Conversions : 5941 : réclamation d
- Page 534 and 535:
2530: Waldbott v; Bassenheim, Franz
- Page 536 and 537:
3425: die Haltung der katholische F
- Page 538 and 539:
649-650 : plaintes des réformés d
- Page 540 and 541:
B. SOURCES IMPRIMEES : Actes et mé
- Page 542 and 543:
VOLTAIRE, Œuvres historiques, éd.
- Page 544 and 545:
Répertoire des visites pastorales
- Page 546 and 547:
Marie-José LAPERCHE-FOURNEL, « Et
- Page 548 and 549:
Albert RUPPERSBERG, Geschichte des
- Page 550 and 551:
Jürgen LUH, Unheiliges Römisches
- Page 552 and 553:
colloque des 21-24 avril 1991 Wolfe
- Page 554 and 555:
Otto B. ROEGELE, « Ein Schulreform
- Page 556 and 557:
Christophe DUHAMELLE, « Le pèleri
- Page 558 and 559:
CONVERSIONS PRINCIERES : Friedrich
- Page 560 and 561:
Arno HERZIG, « Die Rekatholisierun
- Page 562 and 563:
Otto B. ROEGELE, « Damian Hugo von
- Page 564 and 565:
des Bischöflichen Pristerseminars
- Page 566 and 567:
Jacques SOLE, « La diplomatie de L
- Page 568 and 569:
Hans-Walter HERRMANN, Vom Werden un
- Page 570 and 571:
Bernhard H. BONKHOFF, « Kirchenges
- Page 572 and 573:
Karl HAMM, « Die kirchlichen Verh
- Page 574 and 575:
Paul WARMBRUNN, « Konfessionalisie
- Page 576 and 577:
Liste des abréviations utilisées
- Page 578 and 579:
Document n°20 Document n°21 paroi
- Page 580 and 581:
TABLE DES CARTES Carte 1 Espaces po
- Page 582 and 583:
2. Princes, seigneurs et religions
- Page 584 and 585:
a) Le rejet de la nouvelle religion
- Page 586 and 587:
Synthèse de la troisième partie.
- Page 588:
588