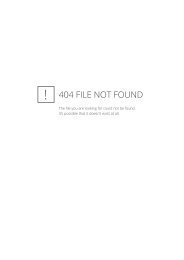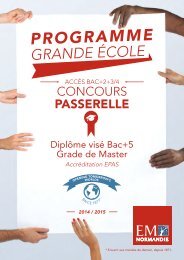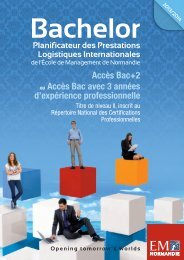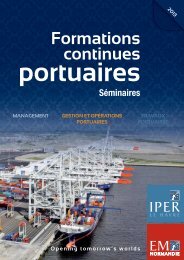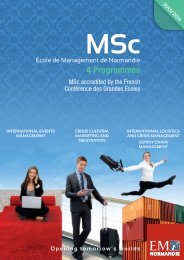L'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime - EM Normandie
L'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime - EM Normandie
L'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime - EM Normandie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
à mettre en œuvre (J.Hammer Hansen, président du conseil d'administration de l’AESM,<br />
préface du programme de travail de l'agence <strong>pour</strong> 2009, Article du 11.02.09).<br />
De manière plus analytique, dans <strong>la</strong> perspective de tester l’applicabilité de l’approche<br />
cognitive aux politiques maritimes, l’analyse des deux référentiels « sectoriels », européen et<br />
de l’industrie maritime, révèle deux constats. D’une part, l’UE, par le biais de l’AESM,<br />
coopère avec l’OMI <strong>pour</strong> améliorer <strong>la</strong> sécurité maritime ce qui fonde progressivement l’idée<br />
qu’il n’y a pas de désaccord entre ces deux instances. D’autre part, c’est le travail développé<br />
par l’AESM au cours de ses deux premières années d’existence qui a modifié les perceptions<br />
de l’industrie maritime à son égard. Nous nous sommes demandés si ces deux constats sont<br />
interdépendants. En d’autres termes, l’un a-t-il engendré l’autre?<br />
Pour une analyse fine, il convient de rapporter chaque référentiel au référentiel global. À<br />
partir du moment où l’industrie maritime accepte une intervention à échelle régionale en<br />
admettant que les travaux effectués par l’AESM sont efficaces (fin 2005), l’OMI est plus<br />
« contrainte » de coopérer avec l’UE car celle-ci représente alors une vision commune qui<br />
intègre le politique et l’industrie. Réciproquement, un blocage de l’OMI justifierait davantage<br />
<strong>la</strong> pertinence de l’AESM. Ainsi, en septembre 2006 lors de l’inauguration de l’AESM à<br />
Lisbonne, une coopération efficace est entérinée. Le rapport de force entre l’UE et l’OMI a<br />
été favorisé par le secteur de l’industrie maritime. Dans ce cas présent, <strong>la</strong> politique publique<br />
que constitue l’AESM a été générée non pas par un déca<strong>la</strong>ge entre le référentiel global et le<br />
référentiel sectoriel mais, par un troisième référentiel, celui de l’UE, induit par l’échelle<br />
d’action des politiques supranationales.<br />
Il apparaît donc important de considérer ici l’échelle de l’UE comme un référentiel <strong>pour</strong> saisir<br />
l’origine de <strong>la</strong> politique publique mais, surtout, son application. En fait, c’est le<br />
développement de cette politique autour de <strong>la</strong> création de l’AESM qui a modifié les<br />
représentations de l’industrie maritime à son égard et, de fait, engendré une modification de<br />
son référentiel. C’est le déca<strong>la</strong>ge entre le référentiel de l’UE et de l’industrie maritime, qui<br />
modifie ensuite l’échelle internationale.<br />
Page20<br />
Plus conceptuellement, il est pertinent de conclure sur l’apport du recours à des concepts plus<br />
politiques, telle l'approche de Müller, à l'étude des politiques maritimes.<br />
Les travaux sur les politiques publiques reconnaissent l'influence de jeux de pouvoir. Mais de<br />
cette reconnaissance, ils passent à l'identification des blocages induits par ces oppositions<br />
d'intérêts <strong>pour</strong> tendre à suggérer des zones de consensus potentiellement plus productives. En<br />
contraste, si l’on s'intéresse aux représentations des acteurs plutôt qu'à <strong>la</strong> mécanique des<br />
mesures qui sont, ou ne sont pas, mises en p<strong>la</strong>ce, les oppositions entre les parties prenantes<br />
peuvent être comprises comme des moteurs d'évolution. Autrement dit, les débats issus des<br />
confrontations constituent des arènes dans lesquelles les représentations entrent en contact et<br />
se transforment. Ainsi, <strong>pour</strong> les décideurs publics, cette perspective peut permettre de<br />
valoriser des progrès préa<strong>la</strong>bles, et probablement nécessaires (comme <strong>la</strong> reconnaissance des<br />
responsabilités et prérogatives de chacun), aux progrès quantifiables par rapport aux<br />
changements concrets que l'on cherche à induire par les politiques publiques (par exemple <strong>la</strong><br />
réduction du nombre de tonnes d'hydrocarbure à <strong>la</strong> mer). Pour les chercheurs, l'approche<br />
permet d'étudier une dimension de processus de création des politiques publiques dont<br />
l'influence a été jusqu'à maintenant <strong>la</strong>rgement sous-estimée dans l'étude de <strong>la</strong> sphère maritime.