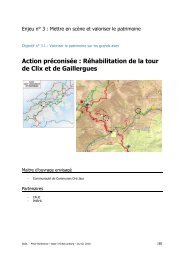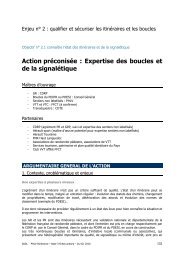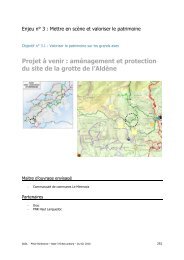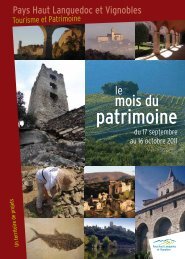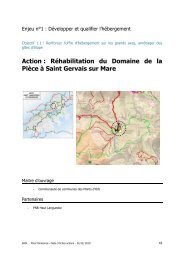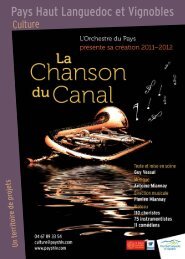Guide Méthodologique du Patrimoine - Pays Haut Languedoc et ...
Guide Méthodologique du Patrimoine - Pays Haut Languedoc et ...
Guide Méthodologique du Patrimoine - Pays Haut Languedoc et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Pays</strong> <strong>Haut</strong> <strong>Languedoc</strong> <strong>et</strong> Vignobles / Mission <strong>Patrimoine</strong> / <strong>Guide</strong> Méthodologique<br />
LE GOTHIQUE MERIDIONAL<br />
Caractéristiques de l’art gothique méridional<br />
Le gothique méridional désigne un courant de l'architecture gothique, développé dans le Midi de la France, qui se<br />
caractérise par l'austérité des constructions, l'utilisation de contreforts à la place d'arcs-boutants <strong>et</strong> des<br />
ouvertures rares <strong>et</strong> étroites. En outre, beaucoup des édifices ayant adopté ce style se contentent d'une nef unique<br />
<strong>et</strong> ont été couverts par des charpentes reposant sur des arcs diaphragmes. Eglises gothiques méridionales, à nef<br />
unique, basse, large <strong>et</strong> sombre.<br />
Sainte-Eulalie, une église fortifiée<br />
Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Narbonne, l’église fortifiée de Sainte-Eulaliede-Cruzy,<br />
est l’un des très rares sanctuaires ruraux de la région à avoir conservé ses vitraux<br />
anciens. Dans un pays où les guerres de religion ont détruit toute représentation figurative<br />
sculptée ou peinte, la présence de vitraux médiévaux n’en acquiert que plus d’intérêt. Ces<br />
fragments ont été classés Monument Historique dès 1911.<br />
La paroisse de Cruzy dépendait au Moyen Age <strong>du</strong> diocèse de Narbonne. C<strong>et</strong>te situation<br />
privilégiée explique probablement l’ampleur <strong>et</strong> la qualité architecturale <strong>du</strong> monument.<br />
Citée dans les textes dès le Xe siècle, rebâtie à l’époque romane, l’église Sainte-Eulalie a été<br />
entièrement reprise au XIIIe <strong>et</strong> XIVe siècles <strong>et</strong> fortifiée au cours des XVe <strong>et</strong> XVIe siècles. L’édifice<br />
gothique a toutefois conservé quelques vestiges de l’église romane qui était à trois nefs avec un<br />
p<strong>et</strong>it transept. Caractéristique <strong>du</strong> gothique méridional, l’église comporte une large nef unique<br />
de 17 mètres de portée sur laquelle on a lancé au début <strong>du</strong> XIVe siècle, une impressionnante<br />
voûte en berceau brisé, renforcée de doubleaux moulurés. C’est à la même époque qu’on<br />
construisit l’abside polygonale flanquée de deux p<strong>et</strong>ites chapelles carrées qui s’ouvrent<br />
directement sur la nef selon un dispositif fréquent dans l’architecture gothique méridionale.<br />
L’abside <strong>et</strong> les absidioles sont ajourées de longues <strong>et</strong> étroites fenêtres à deux formes avec meneau central <strong>et</strong> remplage trilobé.<br />
Même si toute la vitrerie de l’église a été refaite à la fin <strong>du</strong> XIXe siècle dans un style néogothique (grande figure de saints <strong>et</strong><br />
composition en grisaille), plusieurs fragments de vitraux gothiques ont été conservés dans les fenêtres <strong>du</strong> chev<strong>et</strong>.<br />
C’est dans la partie supérieure de la fenêtre de l’absidiole sud que se trouve le fragment le plus ancien, probablement l’œuvre<br />
des ateliers narbonnais travaillant pour la cathédrale. C<strong>et</strong>te scène d’arrestation d’un diacre (saint Etienne ou saint Laurent) peut<br />
être attribuée, par l’élégance de la composition, la vivacité des couleurs, l’expression des visages <strong>et</strong> les détails vestimentaires,<br />
au XIVe siècle.<br />
Le vitrail <strong>du</strong> martyr de sainte Eulalie est constitué de dix panneaux répartis sur les deux lanc<strong>et</strong>tes de la verrière centrale, six<br />
dans la partie supérieure, quatre à la base de la fenêtre, séparés par deux grandes figures de saints insérées là au XIXe siècle. Il<br />
relate selon les nombreux textes hagiographiques 18 <strong>du</strong> Moyen Age, la Passion <strong>et</strong> la mort de sainte Eulalie, son martyre de<br />
Mérida, en Catalogne, pendant la persécution de Dioclétien, dont le culte était largement répan<strong>du</strong> dans le Midi de la France.<br />
Les panneaux sont bordés verticalement d’une succession de p<strong>et</strong>its rectangles alternativement verts <strong>et</strong> jaunes, ces derniers<br />
étant parfois ornés de coronelles en grisaille. Les dix scènes sont encadrées par un motif d’architecture flamboyante (arc en<br />
accolade reposant sur des colonn<strong>et</strong>tes torsadées), traitées en camaïeu de jaune, elles se détachent sur un fond damassé de<br />
rinceaux vert ou viol<strong>et</strong> délicatement traités « au p<strong>et</strong>it bois ».<br />
En opposition très n<strong>et</strong>te avec l’encadrement précieux <strong>et</strong> raffiné des scènes, qui évoque l’enluminure, la simplicité des<br />
personnages, la sécheresse <strong>du</strong> dessin <strong>et</strong> le caractère réaliste des figures font penser au style vigoureux des xylographies <strong>du</strong> XVe<br />
siècle, époque à laquelle on peut attribuer le vitrail de sainte Eulalie.<br />
18 Histoire de la vie des Saints.<br />
Document de travail / Septembre 2011<br />
17